Projet de mine d'or Hardrock
Projet de Mine d'Or Hardrock – Rapport d'évaluation environnementale
Numéro de référence du document : 35
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Environnement et du Changement Climatique, 2018.
No de catalogue : En106-214/2018F-PDF
ISBN : 978-0-660-27869-8
Cette publication peut être reproduite sans autorisation pour usage personnel, à condition que la source en soit clairement indiquée. Toutefois, la reproduction multiple de cette publication en tout ou en partie à des fins commerciales ou de redistribution nécessite l'obtention au préalable d'une autorisation de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, Ottawa (Ontario) K1A 0H3 ou à ceaa.information.acee@canada.ca.
Le présent document est publié en anglais sous le titre: Hardrock Gold Mine Project –Environmental Assessment Report
Sommaire
Greenstone Gold Mines (le promoteur) propose la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture du projet de mine d'or Hardrock (le projet), qui comprend une mine d'or à ciel ouvert et une usine métallurgique sur le site, et qui est situé à environ cinq kilomètres au sud de Geraldton, en Ontario, à l'intersection de la route 11 (la route Transcanadienne) et du boulevard Michael Power. Selon la proposition, la mine et l'usine métallurgique auraient une capacité de production de minerai de 30 000 tonnes par jour, et une capacité d'admission de minerai de 30 000 tonnes par jour.
L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) [LCEE 2012]. Le projet est visé par la LCEE 2012, puisqu'il comprend les activités suivantes décrites à l'annexe du Règlement désignant les activités concrètes :
- Point 16b) : la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une nouvelle usine métallurgique d'une capacité d'admission de minerai de 4 000 t/jour ou plus
- Point 16c) : la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une nouvelle mine d'éléments des terres rares ou d'une nouvelle mine d'or, autre qu'un placer, d'une capacité de production de minerai de 600 t/jour ou plus.
Ce rapport d'évaluation environnementale (le rapport) résume l'évaluation menée par l'Agence, y compris les informations et l'analyse sur les effets environnementaux potentiels du projet pris en compte, et les conclusions de l'Agence canadienne quant à savoir si le projet est susceptible d'avoir des effets environnementaux négatifs importants, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation. L'Agence a établi ce rapport en s'appuyant sur les conseils d'experts des autorités fédérales : Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada, Ressources naturelles Canada, Santé Canada et Transports Canada. De plus, le rapport a été éclairé par les commentaires formulés par des groupes autochtones et par le public dans le cadre de l'évaluation environnementale.
Le promoteur a conclu une entente volontaire avec le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario pour soumettre son projet aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales de l'Ontario. L'Agence et le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario ont effectué les évaluations environnementales fédérales et provinciales en collaboration, dans toute la mesure du possible.
L'Agence a analysé les effets environnementaux, dans les domaines de compétence fédérale, en ce qui a trait à l'article 5 de la LCEE 2012, notamment les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs, l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones, la santé et les conditions socioéconomiques des Autochtones, le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, les constructions, les emplacements ou les choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural pour les Autochtones. L'Agence a également évalué les effets de changements environnementaux qui sont directement ou nécessairement liés à des décisions fédérales que pourraient devoir prendre Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada et Ressources naturelles Canada dans le cadre du projet. L'évaluation tenait aussi compte des effets transfrontaliers, en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre directes.
Ce rapport expose plusieurs droits ancestraux ou issus de traités, protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, détenus par les Premières nations et les Métis susceptibles d'être touchés par le projet, notamment la chasse, le piégeage, la pêche, la récolte des plantes ainsi que l'utilisation de sites et de zones d'importance culturelle pour l'exercice des droits.
Voici les principaux effets environnementaux résiduels du projet, eu égard à l'article 5 de la LCEE 2012 :
- effets de mortalité sur les poissons et leur habitat, et effets sur la santé des poissons, particulièrement en ce qui concerne le déplacement des résidus historiques ainsi que la perte et la détérioration de leur habitat;
- effets sur les oiseaux migrateurs en raison de l'exposition aux contaminants dans les eaux libres, du risque accru de collisions avec les véhicules, et de la perte de leur habitat;
- effets sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones, en raison de la réduction de la qualité et de la disponibilité des ressources, de la perte ou de la modification de l'accès aux lieux utilisés, et de la réduction de la qualité de l'expérience de ces peuples;
- effets sur la santé et les conditions socioéconomiques des peuples autochtones en raison de l'exposition aux contaminants de l'air et de l'eau et de la réduction de la capacité de récolter des aliments dans la nature;
- effets sur le patrimoine physique et culturel par la perte ou la modification de l'habitat de nidification des pygargues à tête blanche.
Des mesures d'atténuation seront mises en œuvre afin de prévenir ou de réduire les effets négatifs potentiels du projet. L'Agence a établi des principales mesures d'atténuation et des exigences relatives à un programme de suivi dont devra tenir compte la ministre de l'Environnement et du Changement climatique lorsqu'elle fixera des conditions dans sa déclaration de décision en vertu de la LCEE 2012. Les conditions seraient juridiquement contraignantes pour le promoteur si la ministre de l'Environnement et du Changement climatique publiait une déclaration de décision permettant la mise en œuvre du projet.
Au moment de définir les principales mesures du programme d'atténuation et de suivi, l'Agence s'est appuyée sur les engagements du promoteur dans le document « Addendum to the Environmental Impact Statement - Mitigation, Monitoring and Commitment List » disponible en anglais sur le site internet du Registre canadien d'évaluation environnementale, les conseils d'experts d'autorités fédérales et de ministères provinciaux, ainsi que les commentaires de groupes autochtones et du public. Les principales mesures d'atténuation et programmes de suivi comprennent la mise en œuvre d'un plan de compensation pour les dommages graves aux poissons, la gestion de la qualité des effluents et des eaux de surface pour respecter les normes de qualité de l'eau applicables, notamment par la gestion des résidus historiques, la limitation des infiltrations de l'installation de gestion des résidus, la surveillance et la dissuasion de l'utilisation des eaux ouvertes par les oiseaux migrateurs, la réduction à un niveau minimal des émissions de poussières diffuses et de contaminants atmosphériques, la réduction à un niveau minimal des effets des changements environnementaux causés par le projet sur l'usage des terres et des ressources à des fins traditionnelles, la fourniture d'un accès aux terres dans la mesure où celui-ci est sécuritaire et sans danger pour la santé, la protection des nids d'aigles occupés, ainsi que la réhabilitation progressive des espèces indigènes et des plantes importantes pour les peuples autochtones.
L'Agence s'est efforcée de choisir les principales mesures d'atténuation et de suivi pour traiter les effets sur les peuples autochtones, qui serviraient également de mesures d'accommodement des droits ancestraux et issus de traités protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Lorsque des mesures d'évitement ou d'atténuation n'ont pu être définies, le promoteur s'est engagé à négocier des ententes avec différents groupes autochtones. Pour tenir compte des répercussions potentielles sur l'usage courant et les droits, l'Agence recommande, aux fins d'inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur soit tenu d'établir des comités consultatifs sur l'environnement pour maintenir le dialogue et valider les prévisions de l'évaluation environnementale. En plus des engagements du promoteur et des mesures définies par l'Agence comme étant les principales mesures d'atténuation et de suivi, celle-ci est d'avis que les répercussions potentielles du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités des groupes autochtones ont été correctement déterminées, et convenablement atténuées ou accommodées, dans le cadre de la prise de décision en vertu de la LCEE 2012.
L'Agence conclut que le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants, compte tenu de la mise en œuvre des principales mesures d'atténuation et de programme de suivi.
Table des matières
- Sommaire
- Table des matières
- Liste des tableaux
- Liste des figures
- Liste des abréviations et acronymes
- Glossaire
- 1. Introduction
- 2. Aperçu du projet
- 3. Raisons d'être du projet et solutions de rechange
- 4. Activités de consultation et conseils reçus
- 5. Cadre géographique
- 6. Modifications prévues de l'environnement
- 7. Effets prévus sur les composantes valorisées
- 7.1 Poissons et habitat du poisson
- 7.2 Oiseaux migrateurs
- 7.3 Peuples autochtones – usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles
- 7.4 Peuples autochtones – santé et conditions socioéconomiques
- 7.5 Peuples autochtones – patrimoine physique ou culturel
- 7.6 Effets transfrontaliers – émissions de gaz à effet de serre
- 7.7 Autres effets liés aux décisions fédérales
- 8. Autres effets pris en compte
- 9. Effets sur les droits ancestraux ou issus de traités
- 10. Conclusion
- 11. Annexes
- Annexe A – Critères d'évaluation des effets environnementaux
- Annexe B – Résumé de l'évaluation des effets environnementaux
- Annexe C – Liste des principales mesures d'atténuation, de surveillance et de suivi considérés par l'Agence
- Annexe D – Résumé de la consultation des groupes autochtones par la Couronne
- Annexe E – Sommaire des observations sur le rapport provisoire d'évaluation environnementale
Liste des tableaux
- Tableau 1 – Décisions qui pourraient devoir être prises en vertu d'autres lois fédérales avant que le projet puisse être réalisé
- Tableau 2 – Composantes valorisées sélectionnées par l'Agence
- Tableau 3 – Zones d'évaluation locales et régionales
- Tableau 4 – Fonds attribués aux participants des groupes autochtones par le Programme d'aide financière
- Tableau 5 – Zones de mélange prévues pour les paramètres des eaux de surface dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis
- Tableau 6 – Estimation de la perte d'habitat en hautes terres et en milieu humide dans la zone de développement du projet et la zone d'évaluation locale
- Tableau 7 – Perte de plans d'eau et de cours d'eau en raison de la construction des éléments du projet.
- Tableau 8 – Perte prévue de l'habitat propice aux oiseaux migrateurs dans la zone d'évaluation régionale
- Tableau 9 – Émissions de gaz à effet de serre prévues découlant du projet
- Tableau 10 – Espèces en péril susceptibles d'être touchées par le projet
- Tableau 11 – Projets futurs compris dans l'évaluation des effets cumulatifs
- Tableau 12 – Critères d'évaluation de l'importance
- Tableau 13 – Description des cotes d'ampleur
- Tableau 14 – L'arbre décisionnel du promoteur pour déterminer l'importance d'un effet résiduel
Liste des figures
- Figure 1 – Zone de développement du projet
- Figure 2 – Zone d'évaluation locale pour la qualité d'air, les conditions sanitaires et socioéconomiques des peuples autochtones et l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones
- Figure 3 – Zone d'évaluation régionale pour la qualité d'air, les conditions sanitaires et socioéconomiques des peuples autochtones et l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones
- Figure 4 – Limites spatiales relatives au bruit et aux vibrations
- Figure 5 – Limites spatiales relatives aux peuplements végétaux
- Figure 6 – Limites spatiales relatives aux eaux souterraines
- Figure 7 – Limites spatiales relatives aux eaux de surface
- Figure 8 – Emplacement du projet
- Figure 9 – Empreinte limite du plan du site
- Figure 10 – Plan du site – Détails de la zone de l'usine de traitement
- Figure 11 – Carte des sous-bassins hydrographiques
- Figure 12 – Emplacement des collectivités autochtones
- Figure 13 – Emplacements des plans d'eau et des cours d'eau qu'on propose d'enlever et mesures de compensation proposées
- Figure 14 – Activités concrètes passées, présentes et futures situées près du projet
Liste des abréviations et acronymes
- L'Agence
- L'Agence canadienne d'évaluation environnementale
- La ministre
- La ministre de l'Environnement et du Changement climatique
- LCEE 2012
- La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
- Le projet
- Le projet de mine d'or Hardrock
- Le promoteur
- Greenstone Gold Mines
- Le rapport, ce rapport
- Le rapport d'évaluation environnementale
- Utilisation autochtone
- L'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, tel que décrit dans l'alinéa 5(1)c) de LCEE 2012
Glossaire
- Anciens ouvrages souterrains
- Puits et excavations souterraines des anciens activités minières souterraines aux anciennes mines MacLeod-Mosher et Hardrock, qui sont trouvés dans la partie nord de la zone de développement du projet.
- Composante valorisée
- Caractéristiques biophysiques ou humaines de l'environnement qui sont importantes en raison du rôle qu'elles jouent dans l'écosystème et de la valeur qu'on leur attribue.
- Construction
- La phase du projet au cours de laquelle on entreprend les activités physiques liées au défrichage de la végétation, à l'aménagement des lieux et à la construction ou à l'installation des composantes du projet préalables à l'exploitation.
- Cyanuration
- Technique d'extraction de l'or des minerais pauvres au moyen d'une réaction chimique impliquant une solution de cyanure.
- Désaffectation
- La phase du projet suivant la fin définitive de la production commerciale. Au cours de cette phase, on enlève l'infrastructure du projet liée à l'exploitation et on commence à remettre le site minier en état. Dans l'étude d'impact environnemental du promoteur, on y fait référence en tant que phase de « fermeture active » (active closure).
- Drainage rocheux acide
- Certaines roches, généralement celles qui sont riches en minéraux sulfureux, peuvent libérer une eau plus acide que le milieu naturel environnant lorsqu'elles sont exposées à l'eau et à l'air. On associe souvent ce phénomène à la lixiviation des métaux.
- Eau de contact
- Eau entrée en contact avec ou infiltré au travers des composantes du site minier et leur infrastructure connexe.
- Eau de procédé
- Eau ajoutée au minerai concassé au cours de l'extraction de l'or à l'installation de traitement du minerai.
- Effluent
- Eau de contact qui est collecté et traité à l'installation de traitement de l'eau.
- Étude d'impact environnemental
- Document préparé par le promoteur qui identifie et évalue les effets sur l'environnement du projet, et les mesures proposées pour atténuer ces effets, conformément aux lignes directrices relatives à l'étude d'impact environnemental fournies par l'Agence.
- Eutrophisation
- Excès chronique de substances nutritives dans un cours d'eau, qui cause des touffes de végétation aquatique, et la mort de la vie animale dû au manque d'oxygène.
- Exploitation
- La phase du projet au cours de laquelle a lieu la production commerciale.
- Fermeture
- La phase du projet ayant lieu après la fin des activités de désaffectation. Cette phase se divise en deux stades: le premier stade dure jusqu'à ce que la fosse à ciel ouvert soit remplie d'eau; le deuxième stade correspond au dernier stade de la remise en état qui commence une fois que la fosse à ciel ouvert est remplie. Dans l'étude d'impact environnemental du promoteur, on y fait référence en tant que phase post-désaffectation.
- Lac de kettle
- Le lac qui sera créé en remplissant la fosse à ciel ouvert après l'exploitation.
- Lignes directrices relatives à l'étude d'impact environnemental
- Document élaboré par l'Agence qui établit les exigences relatives à la préparation de l'étude d'impact environnemental. Ce document précise la nature, la portée et l'étendue des renseignements exigés du promoteur à l'égard du projet.
- Lixiviation des métaux
- La libération des métaux des roches exposées à l'eau et à l'air, qui peut augmenter la concentration de ces métaux dans l'eau de contact. On associe souvent ce processus au drainage rocheux acide.
- Matières particulaires de moins de 10 micromètres de diamètre (PM10)
- Particules d'un diamètre de 10 micromètres ou moins.
- Matières particulaires fines (PM2,5)
- Particules d'un diamètre de 2,5 micromètres ou moins.
- Mort-terrain
- Matériau qui recouvre le gisement de minerais, y compris la roche et le sol, ainsi que d'autres matériaux non consolidés (libres).
- Programme de suivi
- Programme, dont les éléments sont décrits par l'Agence, les autorités responsables et d'autres ministères fédéraux experts, destiné à vérifier l'exactitude des conclusions de l'évaluation environnementale et à jauger l'efficacité des mesures d'atténuation.
- Résidus historiques
- Résidus miniers des anciens projets MacLeod-Mosher et Hardrock, qui sont enterrés dans la partie nord de la zone de développement du projet.
- Résidus miniers
- Mélange de minerai, d'eau et de résidus chimiques, après l'extraction de l'or du minerai dans l'usine de traitement du minerai. Les matières solides des résidus miniers sont normalement de la taille de grains de sable ou plus petites.
- Site de rejet d'effluents traités
- Le site où l'effluent de l'installation de traitement de l'eau serait rejeté pendant la construction et les opérations.
- Stériles
- Les types de résidus produits par les activités minières (p. ex. morts-terrains, roche minière, minerai pauvre et résidus miniers).
- Zone de développement du projet
- Aire géographique touchée par l'ensemble des éléments du projet (p. ex., la fosse à ciel ouvert, l'installation de gestion des résidus, les zones pour le stockage de stériles, l'aire de stockage du minerai, le bassin de polissage et l'usine de traitement du minerai). L'aire couvre 2 200 hectares (22 kilomètres carrés).
- Zone d'évaluation locale
- Aire étudiée pour chaque composante valorisée qui correspondent aux endroits où les effets s'étendant au-delà de la zone de développement du projet devraient se produire. Voir également « zone d'évaluation régionale ».
- Zone d'évaluation régionale
- Aire étudiée pour chaque discipline environnementale afin de très bien comprendre les conditions de référence, de saisir les effets cumulatifs à l'échelle régionale et de tenir compte de l'étendue géographique des effets potentiels. Voir également « zone d'évaluation locale ».
1. Introduction
1.1 Objet du rapport d'évaluation environnementale
Le présent rapport d'évaluation environnementale (le rapport) résume l'évaluation menée par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence), notamment les renseignements et les analyses pris en considération et les conclusions de l'Agence quant à savoir sir la réalisation du projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation. La ministre de l'Environnement et du Changement climatique (la ministre) tiendra compte du rapport et des observations reçues de la part des groupes autochtones et du public dans la décision qu'elle prendra en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) sur l'importance de tout effet environnemental négatif du projet et dans l'établissement des conditions à inclure dans sa déclaration de décision, si le projet est permis de procéder.
Greenstone Gold Mines (le promoteur) propose la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture du projet de mine d'or Hardrock (le projet), qui comprend une mine d'or à ciel ouvert et une usine métallurgique sur le site, et qui est situé à environ cinq kilomètres au sud de Geraldton, en Ontario, à l'intersection de la route 11 (la route Transcanadienne) et du boulevard Michael Power. Selon la proposition, la mine aurait une capacité de production de minerai de 30 000 tonnes par jour et l'usine métallurgique, une capacité d'admission de minerai de 30 000 tonnes par jour.
Le promoteur est une coentreprise à parité constituée le 9 mars 2015 entre Premier Gold Mines Inc. et Centerra Gold Inc. pour planifier, construire, exploiter, puis désaffecter et fermer le projet.
1.2 Portée de l'évaluation environnementale
1.2.1 Exigences en matière d'évaluation environnementale
Le projet est soumis à une évaluation environnementale menée par l'Agence en vertu de la LCEE 2012, puisqu'il comprend des activités décrites à l'annexe du Règlement désignant les activités concrètes. Le projet comprend la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une mine d'or et d'une usine métallurgique. Ces éléments respectent les descriptions et les seuils établis aux alinéas 16b) et 16c) de l'annexe du Règlement désignant les activités concrètes :
- 16b) La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une nouvelle usine métallurgique d'une capacité d'admission de minerai de 4 000 t/jour ou plus;
- 16c) La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une nouvelle mine d'éléments des terres rares ou d'une nouvelle mine d'or, autre qu'un placer, d'une capacité de production de minerai de 600 t/jour ou plus.
Le 23 avril 2014, le promoteur a soumis une description de projet, à partir de laquelle l'Agence a amorcé un examen préalable du projet pour déterminer si une évaluation environnementale était requise. Le 28 avril 2014, l'Agence a invité le public et les groupes autochtones à formuler des observations concernant le sommaire de la description de projet. Le 12 juin 2014, l'Agence a déterminé qu'une évaluation environnementale du projet était requise, et cette dernière a officiellement été lancée le 13 juin 2014. Le 5 août 2014, l'Agence a publié les lignes directrices relatives à l'étude d'impact environnemental afin d'établir la nature, la portée et l'étendue des renseignements exigés de la part du promoteur.
Exigences relatives aux évaluations environnementales coopératives
Outre l'obligation d'évaluation environnementale sous le régime de la LCEE 2012, le promoteur a conclu une entente volontaire avec le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario pour soumettre le projet aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales de la province, sous le régime de laquelle il a effectué une évaluation distincte. Le promoteur a mené des études et a consulté les groupes autochtones et le public afin de répondre aux exigences provinciales et fédérales. L'Agence et la province de l'Ontario, représentée par le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario, ont coordonné le plus possible la réalisation des évaluations fédérale et provinciale afin de simplifier les efforts de tous les intéressés. Elles ont ainsi coordonné les consultations auprès du public et des Autochtones, ainsi que l'examen par des experts techniques fédéraux et provinciaux.
1.2.2 Éléments examinés
En considération de l'article 19 de la LCEE 2012, les éléments suivants ont été pris en compte dans l'évaluation environnementale :
- les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à celle d'autres activités concrètes, passées, présentes ou futures, est susceptible de causer à l'environnement;
- l'importance de ces effets;
- les observations du public;
- les mesures d'atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux négatifs importants du projet;
- les exigences du programme de suivi du projet;
- les raisons d'être du projet;
- les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs effets environnementaux;
- tout changement susceptible d'être apporté au projet du fait de l'environnement;
- les effets hors frontières, y compris ceux qui sont liés directement aux émissions de gaz à effet de serre;
- les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones.
L'évaluation environnementale fédérale a également pris en considération les effets négatifs du projet sur les espèces sauvages inscrites à la liste de la Loi sur les espèces en péril et leur habitat essentiel et sur les espèces désignées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada.
1.2.3 Décisions fédérales qui pourraient devoir être prises
Plusieurs décisions fédérales pourraient être nécessaires avant que le projet ne puisse être réalisé (tableau 1). Par conséquent, conformément au paragraphe 5(2) de la LCEE 2012, l'évaluation environnementale a pris en considération ce qui suit :
- les changements autres que ceux mentionnés aux alinéas 5(1)a) et b) qui risquent d'être causés à l'environnement et qui sont directement liés ou nécessairement accessoires aux attributions que l'autorité fédérale doit exercer pour permettre l'exercice en tout ou en partie de l'activité ou la réalisation en tout ou en partie du projet;
- les répercussions autres que celles mentionnées à l'alinéa 5(1)c) des changements mentionnés ci-dessus qui risquent d'être causés à l'environnement, sur les plans sanitaire et socioéconomique, sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.
| Décision fédérale éventuellement requise | Élément ou activité visés du projet |
|---|---|
|
Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants en vertu de la Loi sur les pêches Modification de l'annexe 2 |
Utilisation des plans d'eau où vivent des poissons à des fins d'évacuation des déchets miniers |
|
Loi sur les pêches Article 35 – Autorisation |
Dommages sérieux aux poissons (y compris la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat) |
|
Loi sur les explosifs Article 7 – Licences et permis |
Installations de fabrication et de stockage d'explosifs |
1.2.4 Sélection des composantes valorisées
Les composantes valorisées désignent les caractéristiques environnementales et socioéconomiques de l'environnement susceptibles d'être touchées par le projet et qui sont jugées préoccupantes par le promoteur, les organismes gouvernementaux, les groupes autochtones ou le public. Les composantes valorisées sélectionnées par l'Agence pour orienter l'évaluation environnementale et l'analyse connexe sont présentées au tableau 2.
Conformément au paragraphe 5(1) de la LCEE 2012, l'évaluation environnementale a pris en considération l'importance des effets environnementaux négatifs potentiels sur les composantes environnementales relevant de la compétence fédérale, dont :
- les effets sur les poissons et leur habitat;
- les effets sur les oiseaux migrateurs;
- les effets hors frontières;
- les répercussions sur les peuples autochtones liées aux changements qui risquent d'être causés à l'environnement en matière sanitaire et socioéconomique, sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.
| Composante valorisée | Justification |
|---|---|
| Effets déterminés selon le paragraphe 5(1) de la LCEE 2012 | |
| Poissons et leur habitat | Les changements liés au projet de la quantité et de la qualité de l'eau, du niveau de bruit et des vibrations peuvent avoir une incidence sur les poissons et leur habitat. |
| Oiseaux migrateurs | Les changements liés au projet du niveau de bruit et la perturbation de l'habitat terrestre, aquatique et humide peuvent avoir une incidence sur la mortalité et le comportement des oiseaux migrateurs. |
| Conditions sanitaire et socio-économique des peuples autochtones | Les changements liés au projet des environnements atmosphériques, terrestres et aquatiques et la modification des aliments prélevés dans la nature peuvent avoir une incidence sur la santé et les conditions socioéconomiques des peuples autochtones. |
| Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones | Les changements liés au projet des environnements atmosphériques, aquatiques et terrestres peuvent avoir une incidence sur l'usage des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones. |
| Patrimoine naturel et patrimoine culturel, et toute construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural pour les peuples autochtones | Les changements liés au projet des environnements terrestres et atmosphériques et les changements de l'accès aux terres peuvent avoir une incidence sur les ressources naturelles et culturelles des peuples autochtones ou sur les lieux ou constructions historiques ou archéologiques. |
| Environnement transfrontalier | Les émissions de gaz à effet de serre liées au projet peuvent contribuer aux changements climatiques. |
| Effets déterminés selon le paragraphe 5(2) de la LCEE 2012 | |
| Milieux humides | Les changements liés au projet de la quantité d'eau et la perturbation de l'habitat terrestre, peuvent avoir des effets négatifs sur les milieux humides qui jouent un rôle important dans l'écosystème et qui sont difficiles à restaurer. |
| Effets déterminés selon le paragraphe 79(2) de la Loi sur les espèces en péril | |
| Espèces en péril | La perturbation liée au projet des environnements terrestres et aquatiques peut avoir une incidence sur les espèces en péril et leur habitat essentiel. |
1.2.5 Limites spatiales et temporelles
Le promoteur a proposé des limites spatiales et temporelles qui définissent la zone et le délai dans lesquels le projet peut interagir avec l'environnement et causer des effets environnementaux. Ceci tient compte de plusieurs limites spatiales :
- Zone de développement du projet. Aire géographique touchée par l'ensemble des éléments du projet (p. ex., la fosse à ciel ouvert, l'installation de gestion des résidus, les zones pour le stockage de stériles, l'aire de stockage du minerai, le bassin de polissage et l'usine de traitement du minerai). L'aire couvre 2 200 hectares (22 kilomètres carrés).
- Zones d'évaluation locales. Aires étudiées pour chaque composante valorisée qui correspondent aux endroits où les effets s'étendant au-delà de la zone de développement du projet devraient se produire.
- Zones d'évaluation régionales. Aires étudiées pour chaque discipline environnementale afin de très bien comprendre les conditions de référence, de saisir les effets cumulatifs à l'échelle régionale et de tenir compte de l'étendue géographique des effets potentiels.
L'Agence a examiné les zones d'évaluation du promoteur et a déterminé qu'elles étaient conformes aux composantes valorisées à évaluer en vertu de la LCEE 2012. Ces zones sont décrites au tableau 3. La zone de développement du projet correspond à la zone en violet à la figure 1.
| Composante valorisée | Zone d'évaluation locale | Zone d'évaluation régionale |
|---|---|---|
|
Conditions sanitaires et socioéconomiques des peuples autochtones, usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones Cette zone comprend les zones pour la qualité de l'air (figures 2 et 3), le bruit et les vibrations (figure 4) ainsi que les peuplements végétaux (figure 5) |
Un rectangle de 27 kilomètres sur 28 kilomètres placé au centre de la zone de développement du projet (figure 2). | Un cercle d'un rayon de 50 kilomètres placé au centre de la zone de développement du projet (figure 3). |
|
Poissons et leur habitat Cette zone comprend les zones d'eau souterraine (figure 6) et d'eau de surface (figure 7) |
Le lac Kenogamisis, les ruisseaux et les cours d'eau qui se déversent du côté nord-ouest du bras sud-ouest du lac Kenogamisis (y compris le ruisseau Goldfield et ses affluents), le lac Goldfield, le lac Marron, le lac Mosher, le lac A-320, le lac A-321, le lac Begooch Zaagi'igan (lac A-322) et le lac A-323. |
La zone de drainage en amont de la baie Barton et la zone de drainage en amont du bras sud-ouest du lac Kenogamisis. La zone comprend tout le lac Kenogamisis et s'étend en aval le long de la rivière Kenogamisis jusqu'au réservoir créé par le bassin de retenue de Kenogami, et vers le sud le long de la rivière Kenogamisis jusqu'au chemin Crib. |
|
Oiseaux migrateurs |
À 0,5 kilomètre des limites de la zone de développement du projet. |
Les bassins versants de la rivière Burrows, de la rivière Kenogamisis et du lac Kenogamisis. |
| Patrimoine naturel et patrimoine culturel, et toute construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural pour les Autochtones | À 0,8 kilomètre des limites de la zone de développement du projet. | Les bassins versants de la rivière Burrows, de la rivière Kenogamisis et du lac Kenogamisis. |
| Environnement transfrontalier | Un rectangle de 27 kilomètres sur 28 kilomètres placé au centre de la zone de développement du projet. | Mondial. |
|
Milieux humides (effets déterminés conformément au paragraphe 5(2) de la LCEE 2012) La zone comprend les zones pour les peuplements végétaux (figure 5) |
La combinaison des zones suivantes : la zone s'étendant à 30 mètres des limites de la zone de développement du projet; la zone où le prélèvement d'eau souterraine devrait être de 0,5 mètre ou plus, et les zones où le débit de l'eau de surface devrait changer en raison des modifications apportées en matière de drainage dans la zone de développement du projet pendant la construction. | Les bassins versants de la rivière Burrows, de la rivière Kenogamisis et du lac Kenogamisis. |
Les limites temporelles indiquent à quel moment un effet associé à des activités précises du projet risque de se produire. En général, ces limites reposent sur une seule phase du projet, ou sur une combinaison de phases, correspondant à la durée des activités du projet susceptibles d'avoir des effets négatifs sur l'environnement pour des composantes valorisées. Le projet compte quatre phases :
- Construction (3 ans). Phase au cours de laquelle on entreprend les activités physiques liées au défrichage de la végétation, à l'aménagement des lieux et à la construction ou à l'installation des éléments du projet, avant l'exploitation.
- Exploitation (15 ans). Phase où la production commerciale a lieu.
- Désaffectation (environ 5 ans). Phase suivant la fin définitive de la production commerciale, au cours de laquelle les éléments du projet liées à l'exploitation sont démantelées et la remise en état de la zone de développement du projet commence.
- Fermeture (environ 16 ans). Phase suivant l'achèvement des activités de désaffectation, y compris la période pendant laquelle la fosse à ciel ouvert est inondée et durant laquelle les activités de surveillance se poursuivent.
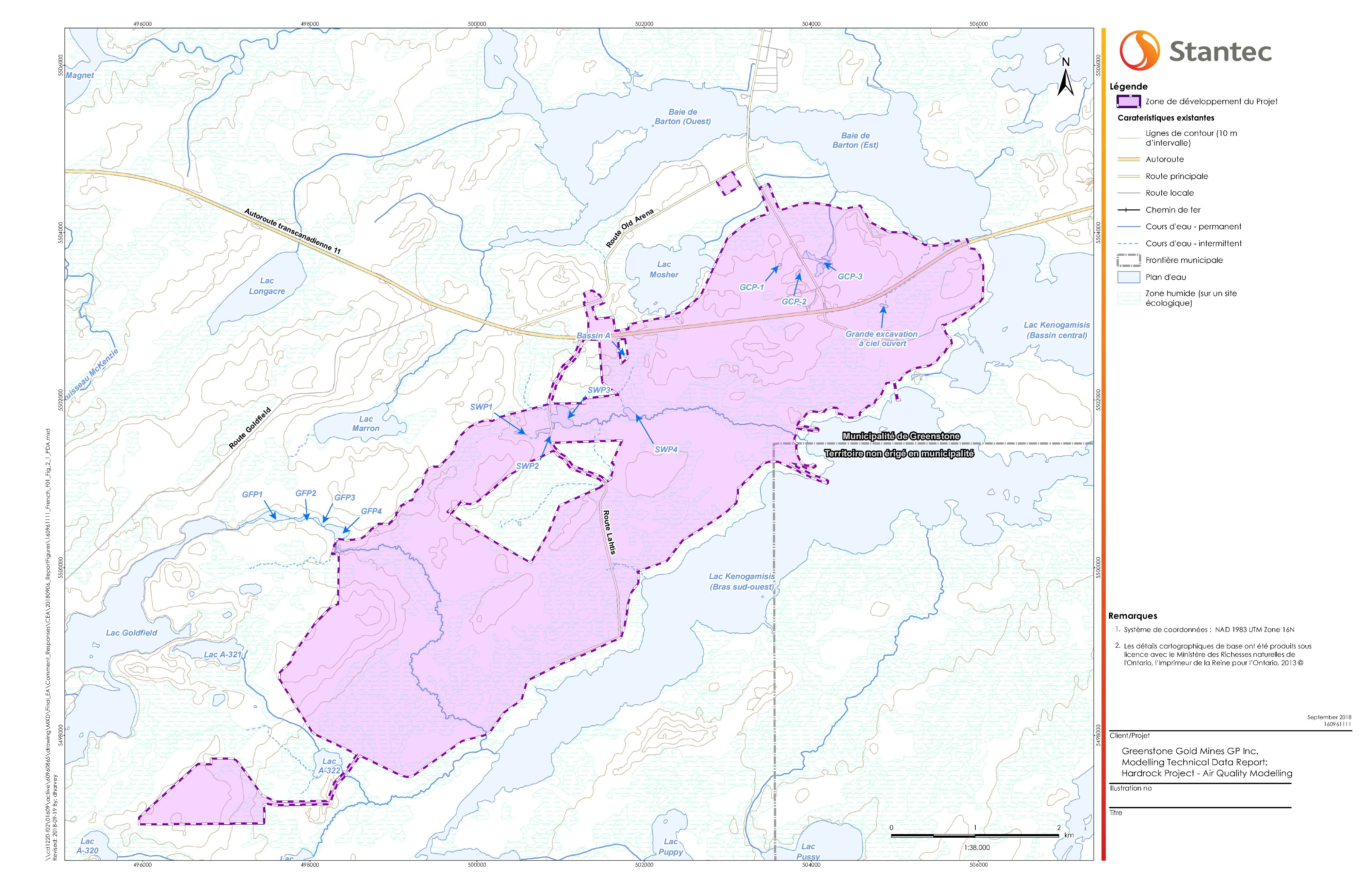
Source : Stantec, septembre 2018
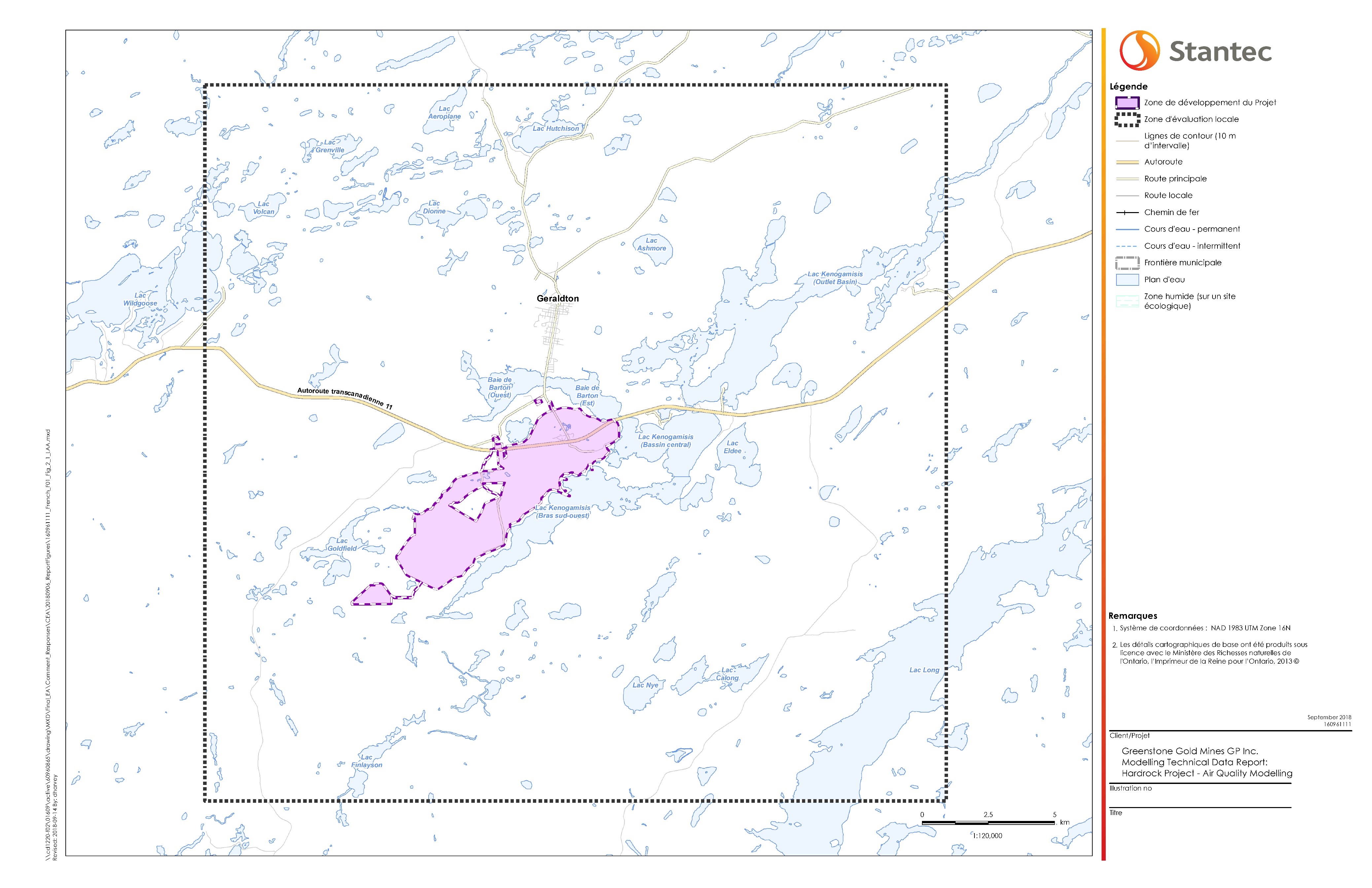
Source : Stantec, septembre 2018
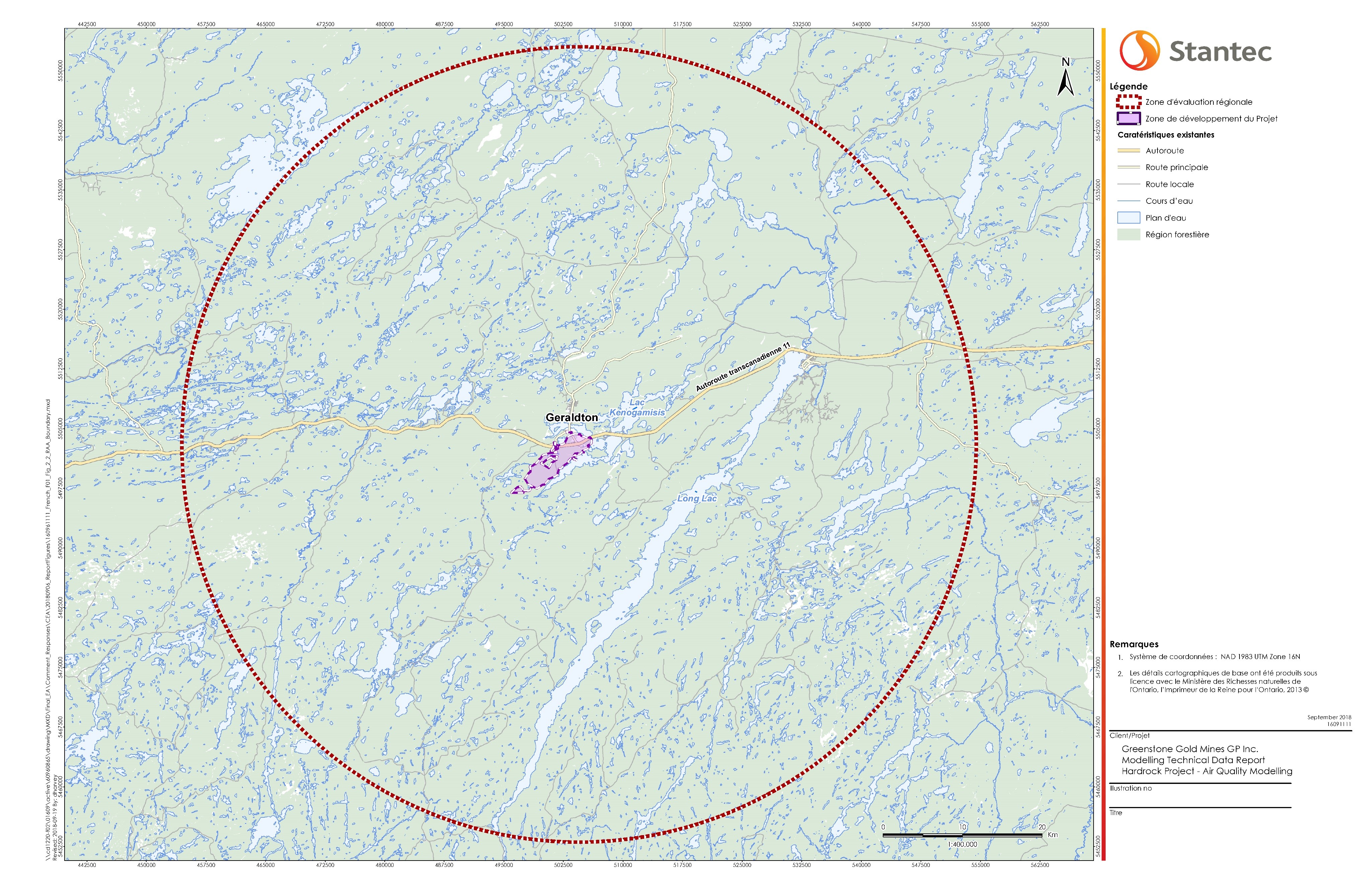
Source : Stantec, septembre 2018
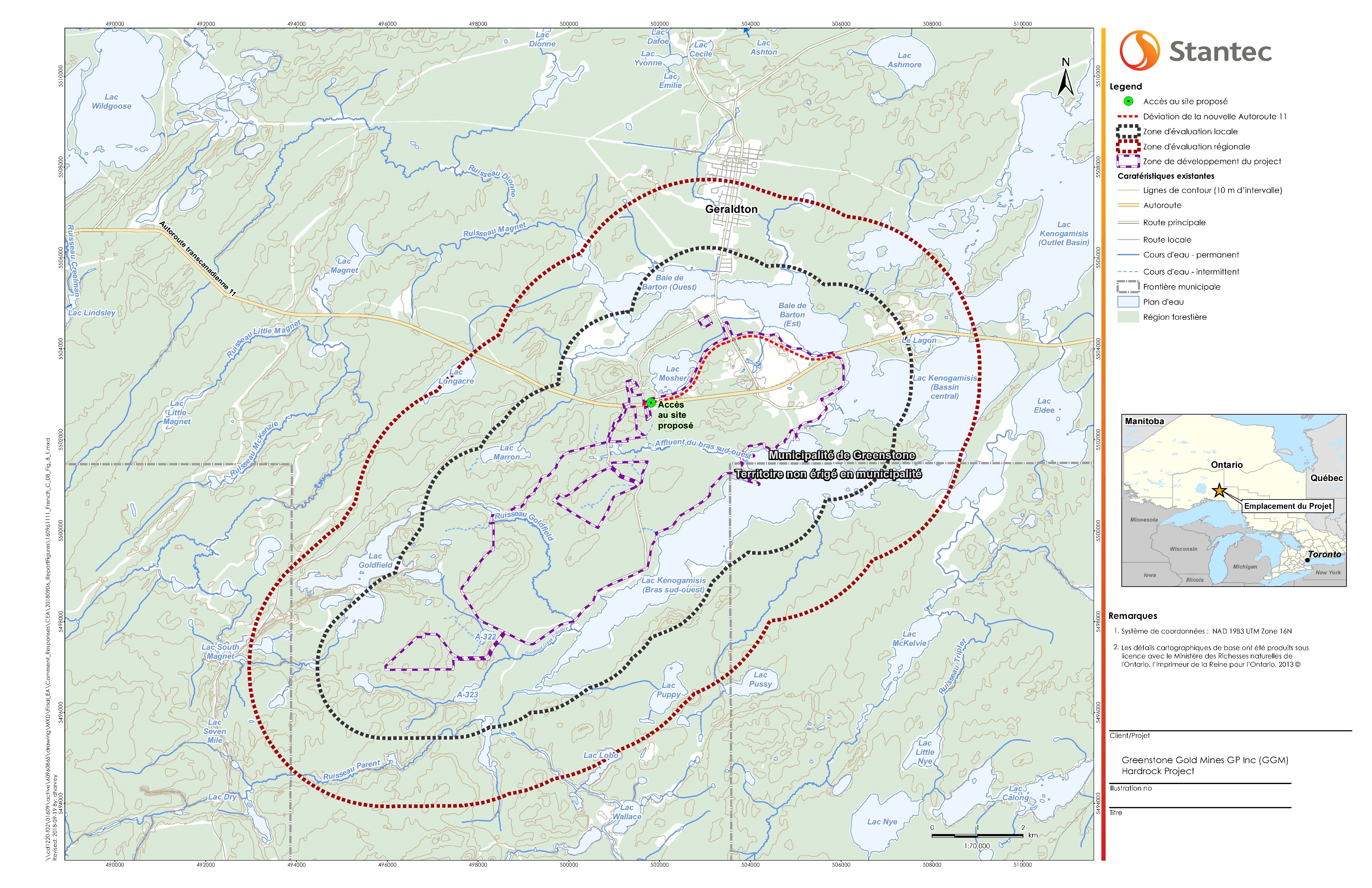
Source : Stantec, septembre 2018
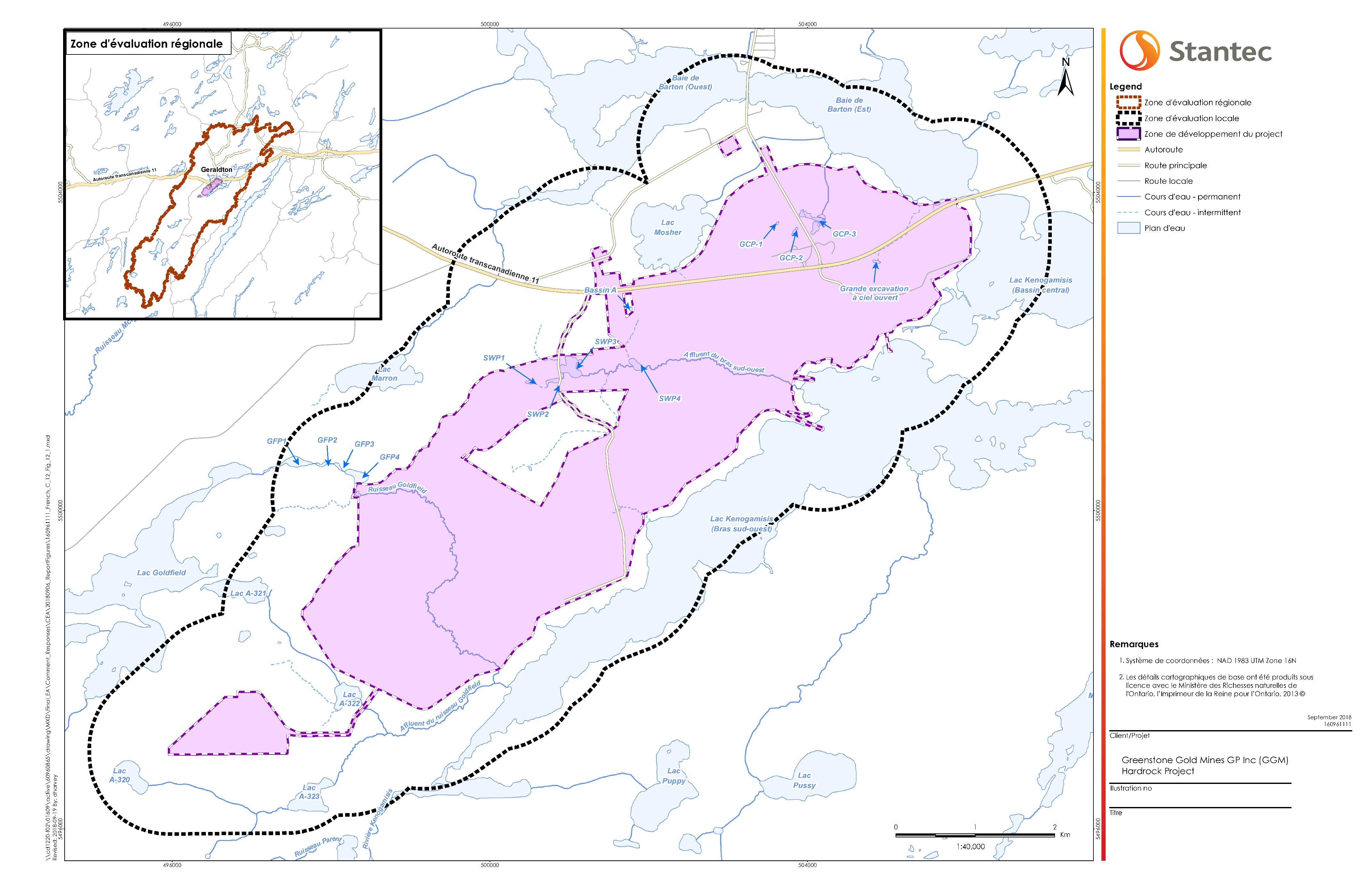
Source : Stantec, septembre 2018
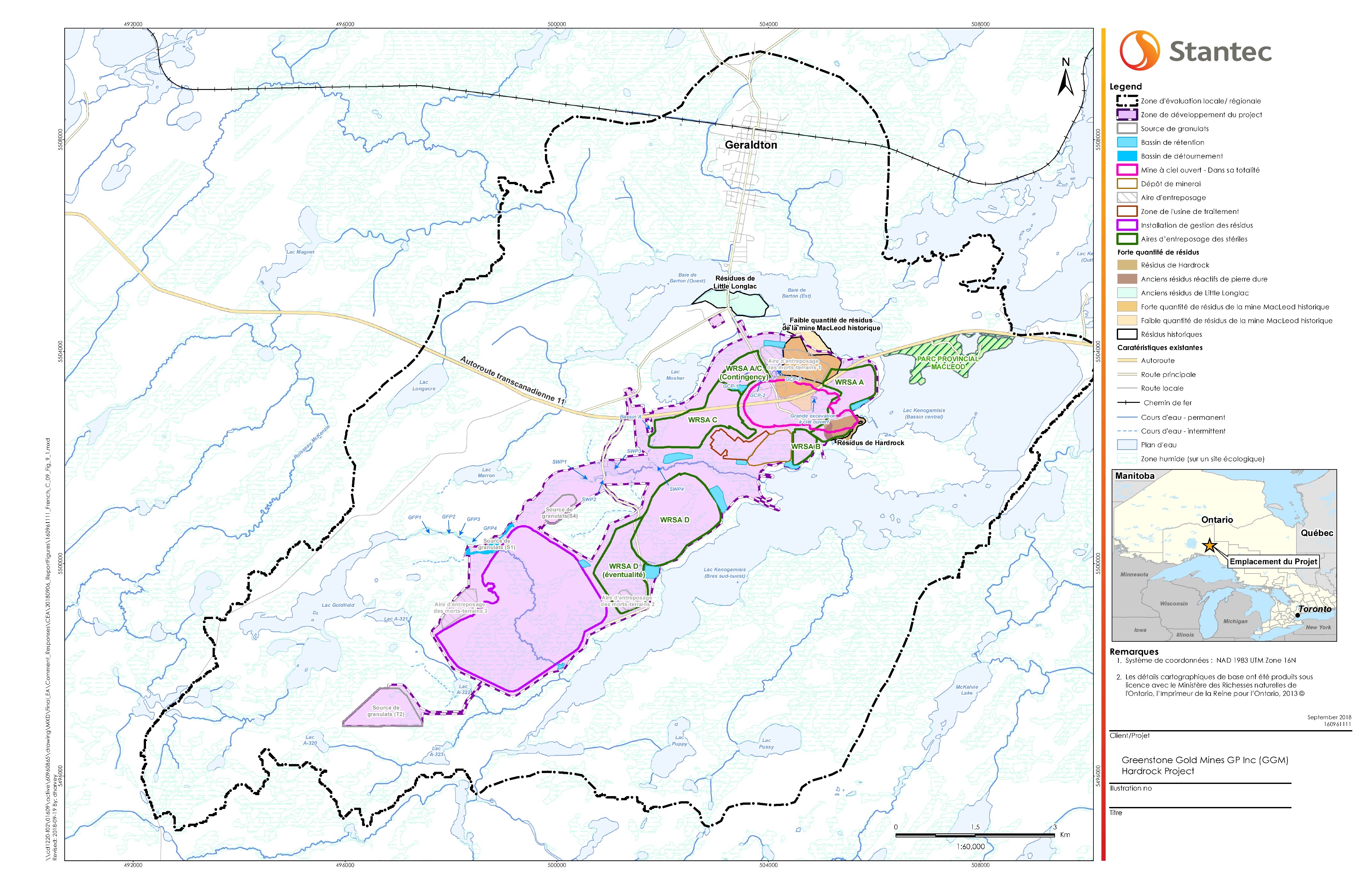
Source : Stantec, septembre 2018
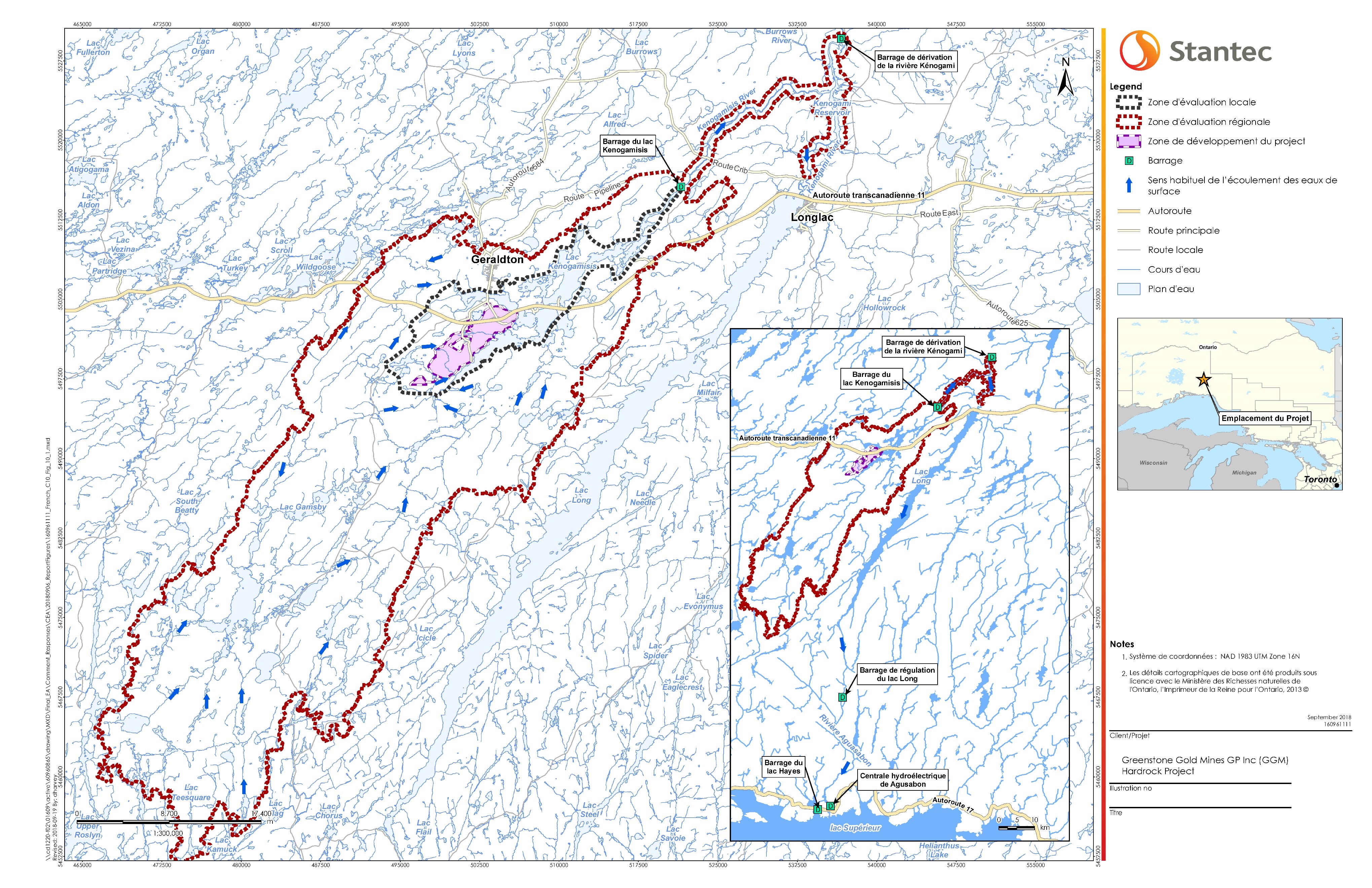
Source : Stantec, septembre 2018
1.2.6 Méthodes et approche
L'Agence a examiné diverses sources de renseignements dans son analyse, notamment :
- l'étude d'impact environnemental soumise par le promoteur en juillet 2017;
- les renseignements additionnels fournis par le promoteur au cours de l'évaluation environnementale sous forme de réponses aux demandes de renseignements de l'Agence lors son examen de l'étude d'impact environnemental;
- les conseils des examinateurs du gouvernement;
- les observations formulées par les membres du public et les groupes autochtones.
L'Agence a évalué l'importance des effets négatifs sur chaque composante valorisée à la suite de l'application des mesures d'atténuation, conformément à l'Énoncé de politique opérationnelle Déterminer la probabilité qu'un projet désigné entraîne des effets environnementaux négatifs importants en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)Note de bas de page 1. Elle a caractérisé les effets négatifs résiduels sur les composantes valorisées selon les critères d'évaluation suivants :
- Ampleur. Gravité de l'effet négatif.
- Étendue géographique. Portée spatiale de l'effet négatif.
- Durée. Période pendant laquelle une composante valorisée serait touchée par l'effet négatif.
- Moment. Critère appliqué à une composante valorisée le cas échéant (p. ex. saison de reproduction des espèces, caractère saisonnier des pratiques spirituelles et culturelles autochtones).
- Fréquence. Taux de récurrence de l'effet négatif.
- Réversibilité. Mesure dans laquelle les conditions environnementales peuvent se rétablir après l'effet négatif.
L'Agence a également tenu compte du contexte écologique et social pour toutes les composantes valorisées et pour l'ensemble des critères énumérés ci-dessus. Le contexte renvoie généralement à l'état actuel de la composante valorisée et de sa sensibilité et de sa résilience aux changements causés par le projet.
L'annexe A (tableaux 12 et 13) présente les définitions et les limites utilisées pour attribuer le niveau d'effet pour chaque critère d'évaluation. L'Agence a utilisé une grille (tableau 14) qui combine le degré prévu d'incidence après examen des mesures d'atténuation pour déterminer l'importance des effets résiduels sur les composantes valorisées. L'annexe B résume l'évaluation des effets résiduels pour toutes les composantes valorisées pendant toutes les phases du projet. Les analyses et conclusions de l'Agence à propos de l'importance des effets environnementaux négatifs sur les composantes valorisées sont présentées au chapitre 7.
L'étude d'impact environnemental du promoteur aborde les effets aux composantes environnementales relevant de la compétence fédérale, tels que présentés dans la section 1.2.4, et aussi autres composantes environnementales tels que le travail et l'économie, les services communautaires, les ressources de patrimoine, et les impacts au parc provincial MacLeod.
2. Aperçu du projet
2.1 Emplacement du projet
Le projet est situé dans la municipalité de Greenstone, dans le nord de l'Ontario (figure 8), à environ cinq kilomètres au sud du district de Geraldton, le long de la route 11 (la route Transcanadienne). Il est situé à environ 275 kilomètres au nord-est de Thunder Bay. Le projet est situé dans la région de l'Ontario visée par le Traité no 9, connu sous le nom de Traité de la baie James de 1905-1906. Le projet est aussi situé dans la zone désignée par la Nation métisse de l'Ontario comme la zone de récolte traditionnelle et de consultation de Lakehead, Nipigon et Michipicoten.
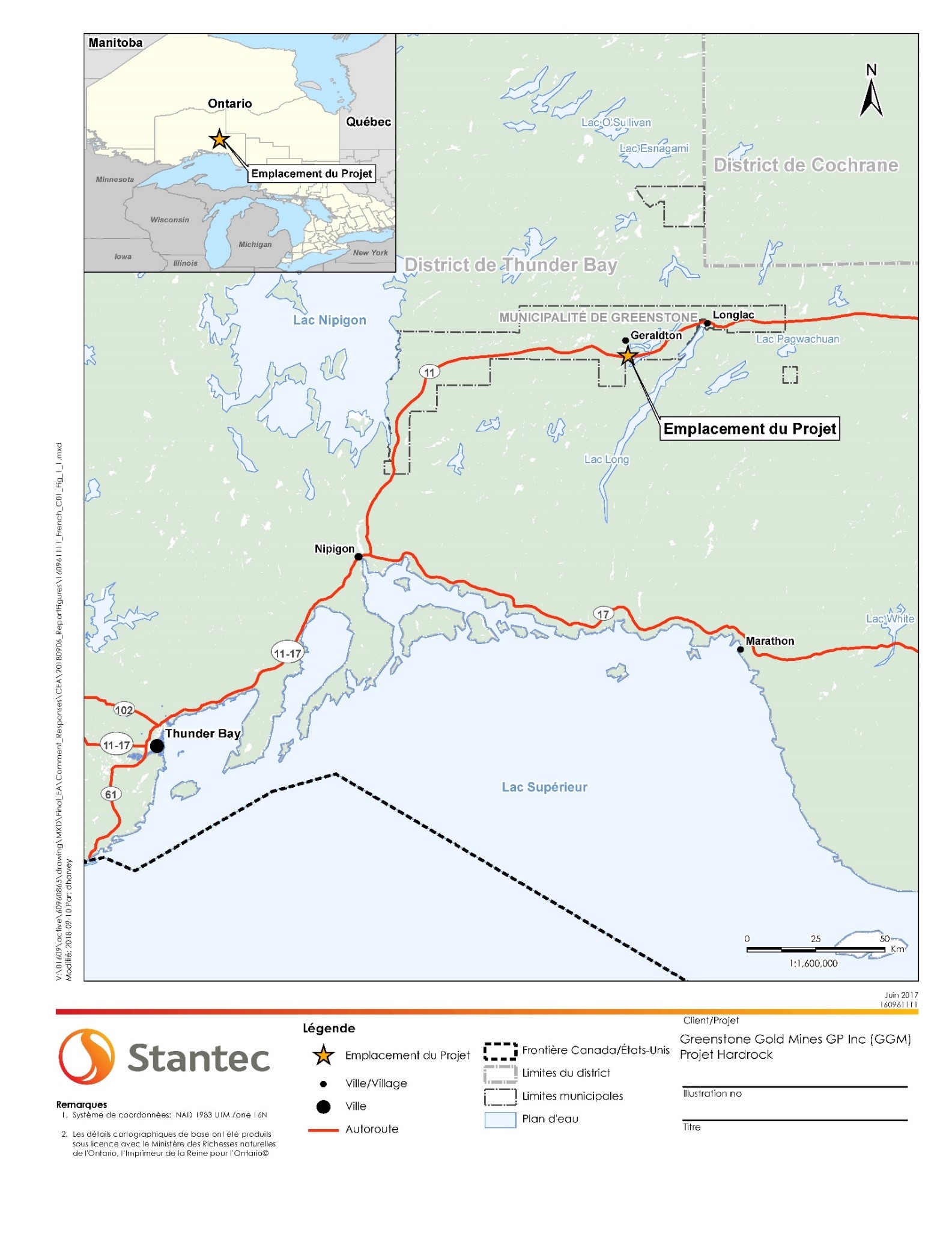
Source : Stantec, septembre 2018
2.2 Éléments du projet projet
Le projet proposé prévoit les éléments suivants, tels qu'ils sont décrits dans le plan du site à la figure 9 et dans le plan détaillé de la zone entourant l'usine de traitement à la figure 10.
- Fosse à ciel ouvert. L'aire de la fosse à ciel ouvert serait d'environ 168 hectares (2 100 mètres de longueur et 800 mètres de largeur), et sa profondeur, de 570 mètres. Le remblayage de la fosse aurait lieu à la voie de prolongement est de la fosse à ciel ouvert au cours des années 6 et 7 de l'exploitation. À la fin de l'exploitation, les dimensions totales de la fosse à ciel ouvert seraient réduites pour créer une superficie d'environ 120 hectares (1 500 mètres de longueur et 800 mètres de largeur) et de 570 mètres de profondeur.
- Installation de gestion des résidus miniers. Environ 140 millions de tonnes de résidus miniers seraient stockées dans deux cellules adjacentes (nord et sud), situées à quatre kilomètres au sud-ouest de l'usine de traitement, couvrant une superficie d'environ 518 hectares. La hauteur limite du barrage serait d'environ 35 mètres. Les résidus de l'usine de traitement seraient pompés par un pipeline depuis de récupération à partir de l'usine de traitement jusqu'à l'installation de gestion.
- Zones pour le stockage de stériles (A, B, C et D). Environ 530,8 millions de tonnes de stériles seraient produites, dont la majeure partie serait stockée dans trois aires de stockage de stériles (désignées A, B et C) autour de la fosse à ciel ouvert et dans l'aire de stockage de stériles D au sud de l'affluent du bras sud-ouest. Ces quatre zones occuperaient 421 hectares et seraient situées à une altitude de 65 à 100 mètres. Environ 73,5 millions de tonnes de stériles seraient stockées à l'intérieur de la partie est de la fosse à ciel ouvert, comme voie de prolongement de l'aire de stockage de stériles A. Deux aires de stockage de stériles d'urgence sont proposées : l'une serait située entre les aires de stockage de stériles A et C, et l'autre, entre l'installation de gestion des résidus miniers et l'aire de stockage de stériles D.
- Zones pour le stockage de la couche arable enlevée et des morts-terrains. Les morts-terrains et la couche arable enlevée seraient empilés au nord de la fosse à ciel ouvert, des aires de stockage temporaires supplémentaires étant situées dans la zone d'urgence pour l'aire de stockage de stériles D, et adjacentes à l'installation de gestion des résidus miniers.
- Stockage du minerai. Une aire de stockage du minerai serait installée au sud de la fosse à ciel ouvert, reliée à l'installation de concassage, et pourrait contenir environ 33,6 millions de tonnes. L'accumulation du minerai commencerait pendant la construction, avant l'affectation de l'usine.
- Installation de concassage et aire d'entreposage du minerai d'alimentation. Les composants utilisés pour le concassage du minerai extrait seraient situés entre l'usine de traitement et l'aire de stockage du minerai. Le concassage se ferait au moyen d'un concasseur giratoire principal et d'un concasseur conique secondaire. Le minerai concassé serait conservé dans l'aire d'entreposage du minerai d'alimentation, pouvant contenir environ 27,5 millions de tonnes avant le traitement.
- Usine de traitement. La récupération de l'or se ferait au moyen d'une combinaison de séparation par gravité et de cyanuration. La détoxification du cyanure dans l'usine se ferait par mélange gazeux de dioxyde de soufre et d'air. L'usine de traitement serait située au sud-ouest de la fosse à ciel ouvert.
- Canal de dérivation du ruisseau Goldfield. Le canal de dérivation du ruisseau Goldfield réglerait le problème du chevauchement du ruisseau et d'autres plus petits plans d'eau. Le canal de dérivation proposé comprend : le bassin de dérivation de 7,5 ha du ruisseau, à l'interface entre le ruisseau actuel et le nouveau canal de dérivation; un nouveau ruisseau Goldfield de 2,7 kilomètres entre le bassin de dérivation et l'actuel cours d'eau de l'affluent du bras sud-ouest SWP1; la reconstruction du canal actuel de l'affluent du bras sud-ouest entre SWP2 et SWP3 afin d'accueillir des débits plus importants et de faciliter le remplacement du passage actuel du chemin Lahtis; et la construction de deux ouvrages de régulation du niveau sur l'affluent du bras sud-ouest actuel pour retenir et atténuer les débits.
- Installations de gestion des eaux. Le drainage de la zone de l'usine de traitement, de l'aire d'entreposage du minerai d'alimentation, de l'aire de stockage des morts-terrains et des aires de stockage de stériles se ferait par une série de fossés de collecte de l'eau de contact qui recueilleraient les eaux de ruissellement et d'infiltration et les dirigeraient vers une série de bassins collecteurs. L'eau serait pompée à partir des bassins collecteurs, et de l'assèchement des anciens ouvrages souterrains et de la fosse à ciel ouvert, et acheminée vers le bassin M1. L'installation de gestion des résidus miniers serait munie d'un système intégré de collecte des eaux d'infiltration pour recueillir les eaux de ruissellement et d'infiltration, qui seraient retournées par pompage vers l'installation de gestion des résidus miniers. L'eau recyclée serait puisée au moyen de conduites à partir du bassin de récupération et du bassin M1 de l'installation de gestion des résidus miniers pour la plupart des procédés; pour les procédés qui requièrent de l'eau de traitement, l'eau serait extraite des effluents traités de l'installation de traitement des effluents ou du lac Kenogamisis par l'intermédiaire d'une prise d'eau située dans le bras sud-ouest si l'eau de l'installation de traitement des effluents ne convient pas à cette utilisation.
- Installations de traitement de l'eau. Il y aurait deux installations : une station mobile qui servirait pendant la construction pour faciliter l'assèchement des résidus historiques, et une installation statique qui serait située à proximité de l'usine de traitement. Pendant la construction, l'installation mobile de traitement des effluents serait située à proximité des travaux de terrassement. Cette installation traiterait les effluents provenant de l'assèchement des anciens ouvrages souterrains, des résidus historiques et de la zone de l'usine de traitement. L'emplacement de l'installation mobile peut changer en fonction des besoins du projet. Pendant l'exploitation, tout excédent d'eau du bassin M1 serait dirigé vers l'installation statique de traitement des effluents située près de l'usine de traitement pour l'enlèvement des métaux et la réduction du total des solides en suspension avant le rejet dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis.
- Conduites sur le site. Des conduites d'eau, de résidus et de gaz naturel seraient nécessaires dans toute la zone de développement du projet. Les conduites d'eau seraient situées à la surface, sauf lorsqu'elles doivent traverser des routes, et des parties de la conduite de l'installation de gestion des résidus miniers. Les conduites sont décrites avec les éléments du projet qu'elles desservent.
- Franchissements de cours d'eau. Des franchissements de cours d'eau seraient nécessaires pour la construction de la route d'accès, de la route de transport, de la conduite de récupération de l'installation de gestion des résidus miniers, de la modification du tracé de la ligne de transport et de la ligne de distribution.
- Routes du site. Les routes du site comprennent la route d'accès, les routes de transport, les routes d'accès pour la construction et d'autres routes plus petites près des aires de stockage de stériles.
- Route 11 et entrepôt de sel. Il serait nécessaire de modifier le tracé d'une partie de la route 11 pour permettre la fosse à ciel ouvert et d'autres éléments du projet. Le tracé de la route 11 serait modifié au nord de la zone de développement du projet, et une nouvelle intersection avec le boulevard Michael Power donnerait accès à Geraldton, ce qui nécessiterait de modifier d'environ 600 mètres le tracé du boulevard Michael Power. Le nouveau tracé de la route traverserait environ 1,2 kilomètre des résidus historiques de la mine MacLeod (figure 9). Après la construction, l'exploitation et l'entretien de la nouvelle route 11 relèveraient du ministère des Transports de l'Ontario. On déménagerait l'entrepôt de sel actuel du ministère des Transports de l'Ontario à l'ouest de l'aire de stockage de stériles C.
- Poste de transformation, lignes de transport et de distribution d'Hydro One. Le poste de transformation existant de Longlac et le poste de service connexe seraient déménagés à environ deux kilomètres à l'ouest de leur emplacement actuel, de même que la ligne de transport et les lignes de distribution sortantes. Une nouvelle route d'accès reliant la route 11 serait construite pour donner accès au nouveau poste de transformation de Longlac. Après la construction, Hydro One serait responsable de l'exploitation et de l'entretien de la route d'accès.
- Sources d'agrégats. En plus des stériles provenant de la fosse à ciel ouvert, une combinaison de sources d'agrégats locales existantes et nouvelles serait utilisée pour répondre aux besoins de construction du projet. Les sources d'agrégats S1 et S4 se trouveraient au nord de l'installation de gestion des résidus miniers, tandis que la source d'agrégats T2 au sud-ouest servirait à fournir des labours acceptables pour la construction des barrages de l'installation de gestion des résidus miniers.
- Approvisionnement en eau de service et infrastructure connexe. La zone de développement du projet, y compris le camp temporaire, serait reliée au système municipal d'alimentation en eau afin de fournir de l'eau potable et l'eau de service aux bâtiments. Les effluents des anciens ouvrages souterrains ou les effluents traités fourniraient de l'eau pour combattre les incendies; l'eau serait stockée dans un réservoir prévu à cette fin dans la zone de développement du projet.
- Camp temporaire. Un camp modulaire temporaire serait construit sur le côté sud du chemin Old Arena, à l'ouest de l'intersection du boulevard Michael Power, pour loger les ouvriers pendant la construction et au début de l'exploitation alors que certaines activités de construction pourraient être en cours. L'occupation varierait au fil du temps; on prévoit une moyenne de 450 lits, qui pourrait atteindre jusqu'à environ 600 lits pendant la période de pointe de la construction.
- Traitement des eaux usées. Les eaux usées du camp temporaire seraient initialement expédiées hors site. Dès l'amélioration proposée du réseau des égouts de la municipalité de Greenstone, le camp temporaire y serait connecté. Durant l'exploitation, un ensemble d'installations de traitement des eaux usées modulaire seraient construites près de l'usine de traitement pour desservir les bureaux du site de la mine, le bâtiment-vestiaire et l'usine de traitement. Au besoin, des toilettes portatives seront également utilisées au camp temporaire pendant la construction.
- Alimentation électrique et infrastructure connexe. L'alimentation électrique pour la construction proviendrait d'un raccordement temporaire au réseau par l'intermédiaire du réseau de distribution local qui dessert actuellement la région de Geraldton. L'électricité nécessaire pour l'exploitation serait générée sur place par une centrale alimentée au gaz naturel. Une petite usine de production de gaz naturel liquéfié serait installée près d'une ligne de distribution de gaz naturel pour faciliter le raccordement. Avant l'ouverture de l'usine, le gaz naturel liquéfié pourrait être transporté par camion jusqu'au site du projet selon les besoins à partir de la source de gaz naturel liquéfié commerciale la plus proche, située à Hagar, en Ontario.
- Installation pour les explosifs. Les explosifs seraient préparés et stockés dans une installation consacrée à la fabrication d'explosifs située soit près de la route de transport ou près de la route d'accès au site.
- Stockage et transport des matières dangereuses et des carburants. Le poste de ravitaillement en carburant pour l'équipement et les véhicules lourds serait situé près de l'usine de traitement. Il y aurait six réservoirs de stockage de diesel hors sol à double paroi, un réservoir de stockage d'urée liquide et un réservoir de stockage d'essence. Les réactifs utilisés dans le traitement du minerai seraient stockés sur place dans une zone de confinement en béton près de l'usine de traitement.
- Bâtiments. Les bâtiments situés près de l'usine de traitement au sud-ouest de la fosse à ciel ouvert comprendraient un bâtiment pour les bureaux administratifs et les vestiaires, un atelier de réparation de camions, un entrepôt, des bureaux et une installation de recyclage et de tri.
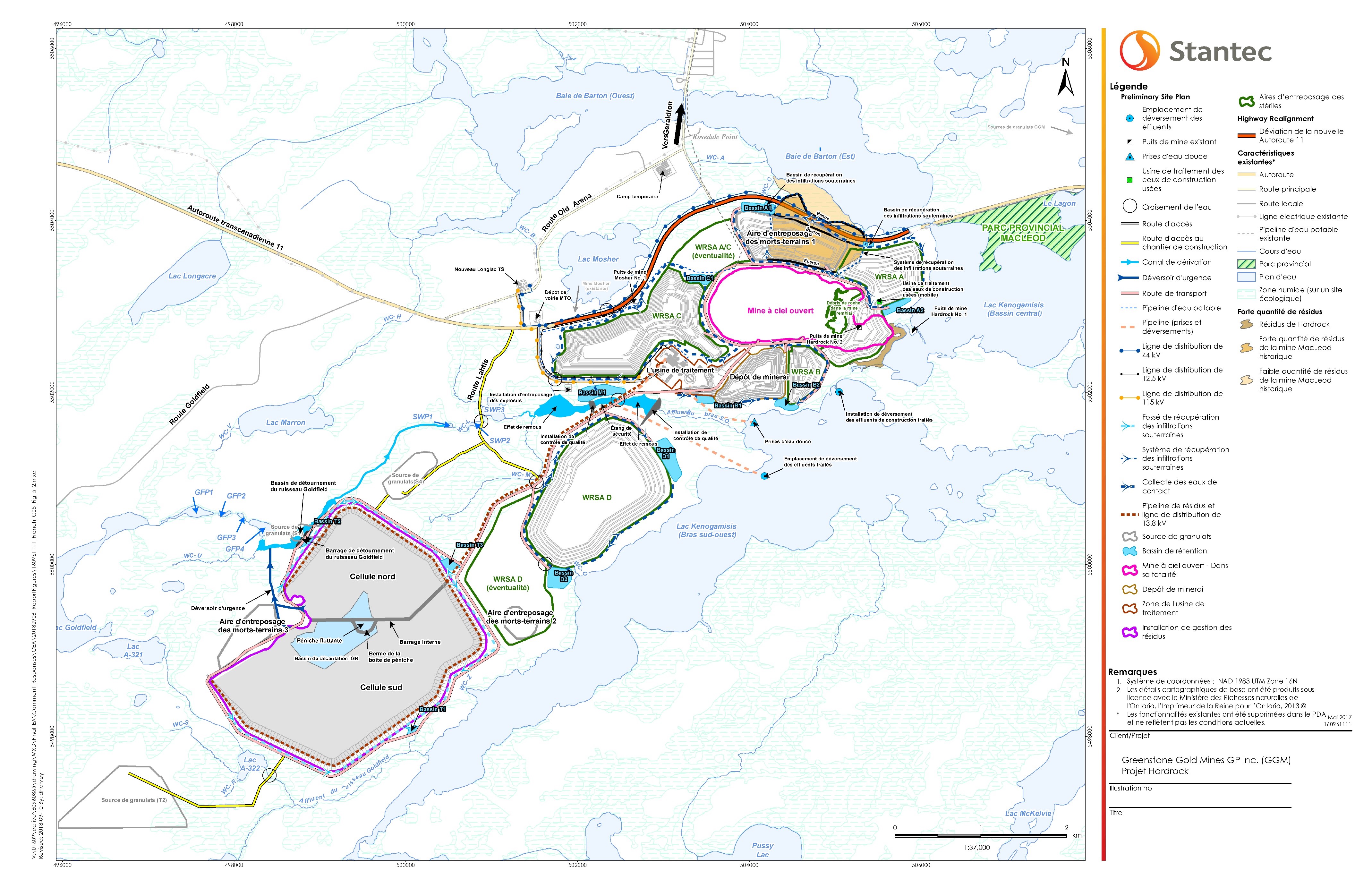
Source : Stantec, septembre 2018
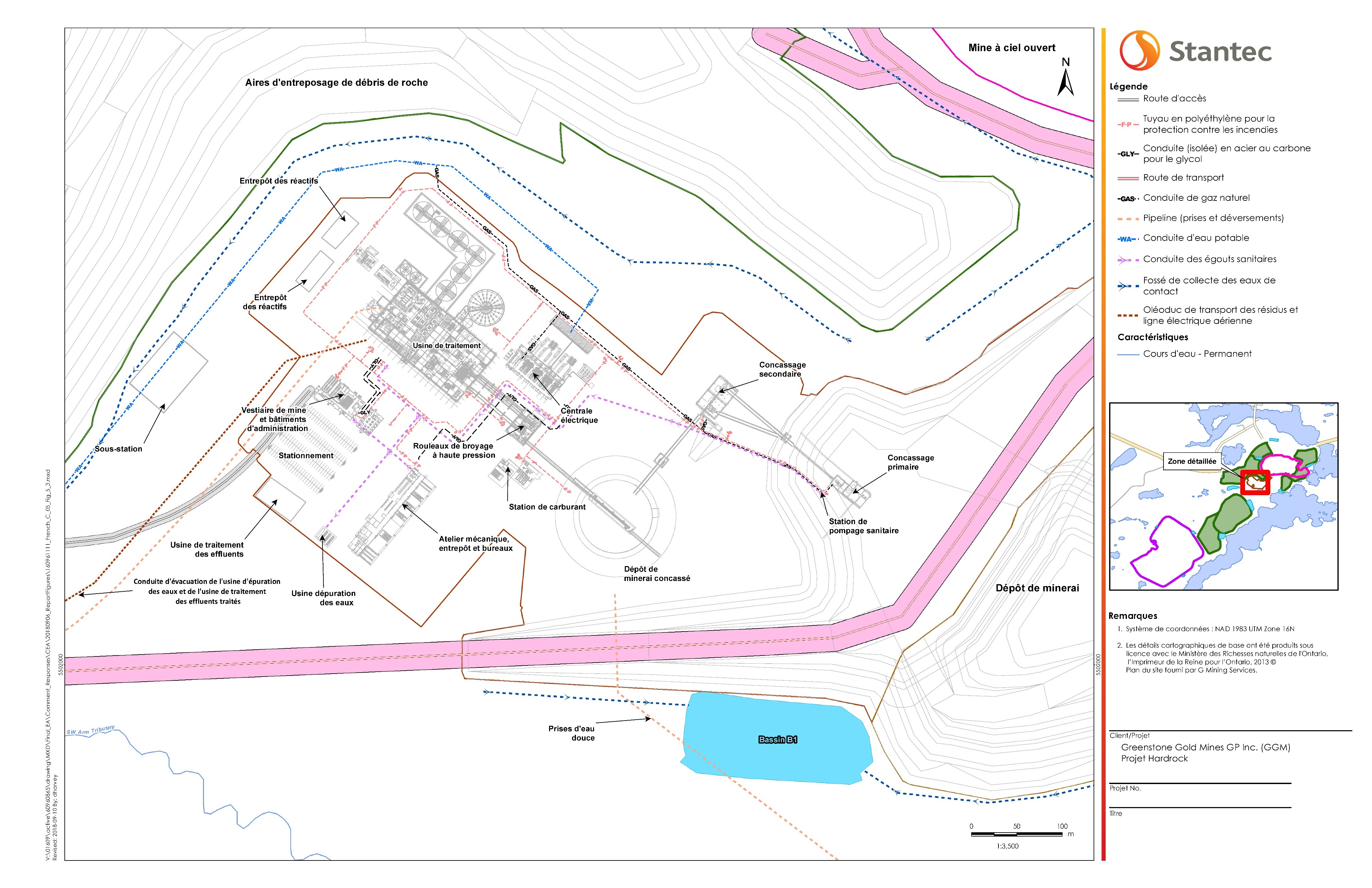
Source : Stantec, septembre 2018
2.3 Activités et calendrier du projet
Le promoteur prévoit les phases suivantes pour le projet :
- Construction : de l'année -3 à l'année -1;
- Exploitation : de l'année 1 à l'année 15 (avec intensification progressive au cours des années 1 et 2, puis pleine exploitation au cours des années 3 à 15);
- Désaffectation : de l'année 16 à l'année 20;
- Fermeture : de l'année 21 à l'année 36.
La construction pourrait débuter une fois les processus d'évaluation environnementale des gouvernements fédéral et provincial achevés et que les approbations réglementaires et les permis applicables auront été délivrés au promoteur.
2.3.1 Construction
Les activités de construction se dérouleraient principalement le jour. Les activités du projet durant la construction comprendraient ce qui suit :
- la modification du tracé de la route 11;
- les produits d'excavation de certaines parties des résidus historiques de la mine MacLeod (situés dans l'empreinte de la fosse à ciel ouvert) et de la mine Hardrock (jusqu'à la marge de recul de 30 mètres de la marque des hautes eaux du lac Kenogamisis) seront entreposés temporairement dans la halde de stériles C et près des résidus anciens de la mine MacLeod;
- le déménagement du poste de transformation, des lignes de transport et de distribution d'Hydro One;
- la préparation du site, ce qui comprend l'enlèvement progressif des infrastructures existantes, la récolte du bois, le défrichage et l'essouchement, le décapage du sol, le nivellement, le dynamitage et le nivellement de la zone de développement du projet, ainsi que l'enlèvement de la terre végétale et des morts-terrains;
- la mise en œuvre de l'installation de traitement des effluents de construction afin de rejeter les effluents dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis;
- la construction et la mise en œuvre d'installations de gestion des eaux, de franchissements de cours d'eau et du canal de dérivation du ruisseau Goldfield;
- la construction et l'installation des bâtiments et de l'équipement associé à l'exploitation minière;
- l'extraction à partir de sources d'agrégats;
- la construction d'installations linéaires (p. ex. routes, conduites et canalisations sur place, lignes de transport et de distribution et sous-stations) et d'installations auxiliaires (p. ex. approvisionnement, stockage et distribution de carburant);
- la phase initiale d'aménagement de la fosse à ciel ouvert et de stockage du minerai;
- la construction de l'usine de traitement vers la fin de la construction.
2.3.2 Exploitation
Les activités d'exploitation se dérouleraient 24 heures sur 24, 365 jours par année. Les activités du projet durant l'exploitation comprendraient ce qui suit :
- la construction et l'exploitation de la fosse à ciel ouvert, y compris le forage, le dynamitage, le chargement et le transport du minerai et des stériles vers les zones désignées;
- la destruction de la végétation, le nettoyage, l'enlèvement de morts-terrains et le transport des stériles vers les zones désignées, progressivement, à mesure que la fosse à ciel ouvert s'agrandit;
- le broyage et le traitement du minerai et le traitement du minerai, y compris la production de barres aurifères à la fin du processus; cela se produirait en deux phases : la phase 1 (années 1 et 2), dont le taux de production pourrait atteindre jusqu'à 24 000 tonnes par jour de minerai, et la phase 2 (années 3 à 15), dont le taux de production pourrait augmenter progressivement jusqu'à 30 000 tonnes par jour;
- le pompage des résidus de l'usine de traitement jusqu'à l'installation de gestion des résidus miniers;
- le placement des parties déblayées des résidus historiques dans la nouvelle installation de gestion des résidus miniers au cours des années 2 à 4 de l'exploitation, après la mise en place d'une couche de deux mètres de nouveaux résidus miniers;
- la revégétalisation, dans la mesure du possible, des zones de l'installation de gestion des résidus miniers et des aires de stockage de stériles.
2.3.3 Désaffectation
Après l'exploitation, la zone de développement du projet serait remise en état, et le projet progresserait vers la désaffectation. Les activités du projet durant la désaffectation se dérouleraient principalement au cours des cinq premières années après l'achèvement de l'exploitation, et comprendraient ce qui suit :
- l'enlèvement des bâtiments et des éléments du projet, y compris les conduites, les routes d'accès, les ponceaux et les lignes de transport d'électricité, puisqu'ils ne seront plus nécessaires pour appuyer la surveillance ou le remplissage de la fosse à ciel ouvert;
- la construction d'une clôture à rochers ou d'une berme adaptée autour du périmètre de la fosse à ciel ouvert afin d'y empêcher l'accès accidentel;
- la couverture et la revégétalisation des aires de stockage de stériles et de la surface de l'installation de gestion des résidus miniers afin d'améliorer l'esthétique, de réduire le risque d'érosion de surface ainsi que l'infiltration d'eau;
- la revégétalisation des autres zones perturbées dans la zone de développement du projet au moyen d'espèces non envahissantes afin de favoriser la revégétalisation naturelle;
- le remplissage de la fosse à ciel ouvert par le pompage de l'eau de l'installation de gestion des résidus miniers, des bassins collecteurs d'eau de contact et des anciens ouvrages souterrains pour former une couche d'eau dense au fond de la fosse à ciel ouvert, suivie d'une couche d'eau douce du bras sud-ouest du lac Kenogamisis pour permettre le développement d'une couche supérieure d'eau douce;
- les activités de surveillance et d'entretien seraient menées tout au long de la désaffectation.
2.3.4 Fermeture
Après la désaffectation, le projet continuerait d'être surveillé pendant le remplissage de la fosse à ciel ouvert pour former un lac de kettle. Le promoteur estime que la qualité de l'eau du lac de kettle respecterait les normes de qualité de l'eauNote de bas de page 2 environ cinq ans après sa création. La plupart des restrictions d'accès seront levées après la désaffectation; toutefois, une clôture à rochers sera maintenue autour de la fosse à ciel ouvert à des fins de sécurité. Les activités du projet durant la fermeture comprendraient ce qui suit :
- le remplissage de la fosse à ciel ouvert, principalement à partir du bras sud-ouest du lac Kenogamisis, jusqu'à ce que le niveau de l'eau atteigne une hauteur d'environ 331 m; le remplissage complet de la fosse à ciel ouvert devrait prendre environ 16 ans à partir du début de la désaffectation, pour se terminer vers la 11eannée de la fermeture;
- la construction d'un canal reliant la partie sud-est du lac de kettle rempli au bras sud-ouest du lac Kenogamisis;
- la surveillance continue de la qualité de l'eau des effluents et de la stabilité physique du remblai et des pentes de la fosse à ciel ouvert jusqu'à ce qu'il soit démontré que la qualité de l'eau dans le lac de kettle est stabilisé et respecte les normes de qualité de l'eau.
3. Raisons d'être du projet et solutions de rechange
3.1 Raisons d'être du projet
Le projet vise à extraire l'or à l'emplacement d'une friche industrielle (où se trouvait le complexe MacLeod-Mosher) pour le vendre sur le marché. Le promoteur prévoit que le projet procurera un taux raisonnable de rendement du capital investi aux actionnaires et des avantages pour l'économie locale et pour la région, dont une augmentation des revenus locaux et régionaux et des profits d'entreprise grâce auxquels on pourra investir dans les services sociaux, les infrastructures des collectivités, le développement des entreprises et le renforcement des capacités.
3.2 Solutions de rechange
Selon la LCEE 2012, l'évaluation environnementale d'un projet doit prendre en compte les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique de même que leurs effets environnementaux. L'Énoncé de politique opérationnelle concernant les « Raisons d'être » et « solutions de rechange » en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)Note de bas de page 3 présente les exigences générales et l'approche à l'égard des solutions de rechange sous le régime de la LCEE 2012. Le promoteur a déterminé des solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique pour les principaux éléments du projet et leurs effets sur l'environnement, et a justifié le choix de la solution privilégiée. Le présent chapitre examine les éléments du projet les plus importants.
Le promoteur a indiqué que, compte tenu de la nature du gisement, la seule technique économiquement viable d'exploitation minière est l'exploitation à ciel ouvert. Le contenu d'or dans le minerai était trop bas pour que l'exploitation minière souterraine soit viable.
3.2.1 Évaluation des solutions de rechange
Installation de gestion des résidus miniers et élimination des résidus miniers
Le promoteur a examiné diverses combinaisons de sites de gestion des résidus miniers, de méthodes d'élimination et de méthodes de construction de barrages. Quatre emplacements possibles décrits ci-dessous ont été désignés pour l'installation de gestion des résidus miniers. Un emplacement au sud-ouest de la fosse à ciel ouvert et au nord-ouest du bras sud-ouest du lac Kenogamisis a été choisi par le promoteur comme solution privilégiée, avec retenue conventionnelle et la construction d'un barrage en aval. Cette approche entraînerait la perte de la plus petite quantité de terres boisées (et des habitats associés) et réduirait la fragmentation de l'habitat en raison de la construction des routes de transport et des conduites. Par contre, cette approche entraînerait aussi la perte d'un milieu humide et le chevauchement du ruisseau Goldfield. Cela laisserait une quantité relativement faible de résidus miniers exposés, ce qui exigerait le placement d'une couverture moins importante après l'exploitation. L'installation se trouverait relativement près de la fosse à ciel ouvert, ce qui produirait moins de poussière en raison du transport et de résidus chassés par le vent. L'emplacement permettrait de réduire les risques d'infiltration et d'écoulement en raison de la longueur relativement courte de la conduite. Les matériaux de fondation devraient résister aux infiltrations, et la topographie naturelle limiterait la hauteur et la longueur du barrage.
- au sud-ouest de la fosse à ciel ouvert au nord-ouest du bras sud-ouest du lac Kenogamisis;
- au sud-ouest de la fosse à ciel ouvert, sur un relief relativement élevé donnant sur le lac Goldfield;
- à l'ouest de la fosse à ciel ouvert au sud-est du lac Wildgoose;
- au sud-ouest de la fosse à ciel ouvert, au sud-ouest du bras sud-ouest du lac Kenogamisis, dans une zone entourée de plans d'eau et de cours d'eau.
Deux solutions de rechange ont été envisagées pour la fermeture de l'installation de gestion des résidus miniers, tout en assurant la stabilité physique à long terme des barrages de stériles et d'autres ouvrages de retenue, ainsi que la qualité des effluents : couverture et végétation ou et couverture aqueuse. Une couverture aqueuse exigerait l'inondation de l'installation de gestion des résidus miniers pour maintenir les résidus dans un état saturé, et nécessiterait des barrages plus élevés et renforcés ainsi qu'un entretien et une surveillance continus de la qualité de l'eau et de la stabilité. La solution privilégiée par le promoteur consiste à couvrir l'installation de gestion des résidus miniers avec des matières à faible perméabilité, puis de végétation au moyen d'espèces végétales indigènes. Cette solution de rechange permettrait de réduire les coûts, l'infiltration des précipitations par les résidus et la production de poussière. De plus, la végétation fournirait un habitat terrestre à la faune.
Élimination des stériles et aires de stockage de stériles
Quatre méthodes possibles d'élimination des stériles sont indiquées ci-dessous. La combinaison de stockage en surface et en fosse des stériles non séparés a été choisie comme la seule solution de rechange réalisable sur les plans économique et technique pour l'élimination des stériles. Une partie des stériles serait stockée dans la partie est de la fosse à ciel ouvert, et il y aurait suffisamment de terrain disponible pour stocker le reste des stériles de façon fiable. Cette solution permettrait également de réduire à la fois les effets environnementaux et l'empreinte du projet.
- combinaison de stockage en surface et en fosse des stériles non séparés;
- stockage en fosse à ciel ouvert de tous les stériles;
- coélimination des stériles et des résidus miniers;
- séparation des stériles attribuable au drainage rocheux acide et au potentiel de lixiviation des métaux.
Quatre aménagements possibles des aires de stockage de stériles ont été envisagés et répondaient aux mêmes critères préliminaires décrits pour l'installation de gestion des résidus miniers. Tous les aménagements envisagés comprenaient trois zones de stockage autour de la fosse à ciel ouvert, et une quatrième zone de stockage située au sud de la fosse à ciel ouvert. Bien qu'il soit situé plus loin de la fosse à ciel ouvert, l'aménagement privilégié par le promoteur chevaucherait une aire relativement petite de terres boisées, une étendue réduite des terres et des ressources utilisées à des fins traditionnelles, des étendues plus courtes de plans d'eau et la moins grande superficie de terres humides, et n'exigerait pas une dérivation de cours d'eau.
Modification du tracé de la route 11
Le promoteur a repéré quatre tracés possibles qui respectent les distances de séparation adéquates par rapport à la fosse à ciel ouvert et au lac Kenogamisis. Le tracé choisi offre une courbe optimale et plus sécuritaire entre le lac Mosher et le boulevard Michael Power, fournissant ainsi une intersection plus droite au boulevard Michael Power. Les considérations de sécurité et de faisabilité technique de cette solution de rechange l'ont emporté sur la perte légèrement plus importante de terres humides et d'habitats fauniques qu'offraient les autres tracés possibles.
Emplacement de l'usine de traitement, récupération de l'or et approvisionnement en eau de traitement
La seule solution de rechange possible pour l'emplacement de l'usine de traitement était sur place, puisqu'un emplacement hors site ne serait pas réalisable sur le plan technique ou économique. Son emplacement à l'ouest de la fosse à ciel ouvert a été choisi pour des raisons d'efficacité opérationnelle et de compatibilité avec d'autres installations.
Trois méthodes de récupération de l'or ont été envisagées : la cyanuration, la récupération par flottation et la séparation gravitaire. La solution privilégiée par le promoteur était une combinaison de séparation gravitaire (efficace pour récupérer de 5 à 35 % de l'or) et de récupération des cyanures (la méthode la plus efficace pour récupérer l'or et la norme pour l'industrie), car elle a été trouvée la plus efficace tout en limitant la quantité de cyanure et les effets environnementaux potentiels.
Trois sources d'approvisionnement en eau de traitement ont été envisagées : le recyclage de l'eau provenant de l'installation de gestion des résidus miniers et du système de collecte de l'eau de contact; le prélèvement d'eau dans les anciens ouvrages souterrains et le prélèvement d'eau douce dans le lac Kenogamisis. La solution privilégiée comprend le recyclage de l'eau comme source primaire d'eau, tout en dirigeant les écoulements d'eau souterraine provenant de la fosse à ciel ouvert ainsi que du ruissellement pluvial et de surface vers les anciens ouvrages souterrains qui servent de réservoirs de stockage pour les besoins secondaires en eau. De petits volumes d'eau douce seraient également puisés du bras sud-ouest du lac Kenogamisis pour les étapes de traitement pour lesquelles l'eau récupérée ne conviendrait pas.
Stockage du minerai, installation de concassage et aire d'entreposage du minerai d'alimentation
La seule solution de rechange réalisable sur les plans technique et économique trouvée pour le stockage du minerai, l'installation de concassage et l'aire d'entreposage du minerai d'alimentation se trouvait sur le site, à proximité de l'usine de traitement. Transporter le matériel hors site pour l'entreposage et le concassage temporaires serait inefficace et coûteux et entraînerait l'augmentation des émissions de poussière et de gaz à effet de serre. L'emplacement à l'ouest de la fosse à ciel ouvert a été choisi pour des raisons d'efficacité opérationnelle et de compatibilité avec d'autres installations sur le site.
Canal de dérivation du ruisseau Goldfield
Plusieurs solutions de rechange ont été envisagées pour le canal de dérivation du ruisseau Goldfield, y compris une option au nord-est de l'installation de gestion des résidus miniers. Cette solution a été jugée préférable, car il nécessiterait moins de changements aux chenaux existantes, et enlèverait moins d'habitats fauniques.
Résidus historiques et autres sols contaminés
Étant donné l'emplacement de la fosse à ciel ouvert et du nouveau tracé de la route 11, il est nécessaire de déplacer les résidus des anciennes activités minières associées aux mines MacLeod et Hardrock. L'enlèvement de tous les résidus historiques de la mine MacLeod et de Hardrock dans la zone de développement du projet jusqu'à la nouvelle installation de gestion des résidus n'a pas été jugé réalisable sur le plan économique en raison du volume de matériaux et du calendrier des activités du projet, d'autant plus que le nouveau tracé de la route 11 devrait être terminé avant la construction de la nouvelle installation de gestion des résidus. L'enlèvement de portions des résidus miniers dans la zone de développement du projet avec élimination dans la nouvelle installation de gestion des résidus miniers est la seule solution qui a été considérée comme étant réalisable sur le plan économique pour gérer la zone qui sera perturbée. Le promoteur a considéré cette solution comme ayant un effet positif net sur le lac Kenogamisis, en réduisant les charges polluantes en métaux (principalement l'arsenic) en provenance des anciennes sources vers le lac Kenogamisis.
Collecte, traitement et rejet de l'eau de contact
La pratique courante pour la gestion de l'eau de contact dans la fosse à ciel ouvert (apport d'eau souterraine, précipitations et ruissellement) consisterait à pomper l'eau de contact directement dans les bassins de surface aux fins de traitement. Le projet offre une autre solution réalisable sur le plan technique, étant donné que l'eau de contact de la fosse à ciel ouvert peut être acheminée vers les anciens ouvrages souterrains. Cette solution a été retenue, car elle offre l'avantage d'utiliser les anciens ouvrages souterrains pour le stockage temporaire de l'eau pendant les périodes de pointe de précipitations et de ruissellement. L'excès d'eau dans les anciens ouvrages souterrains serait envoyé directement à l'installation de traitement des effluents ou rejeté dans le bassin M1, puis dans le milieu récepteur.
Pour l'eau de contact d'autres éléments du projet (y compris les haldes de stériles, les aires de stockage des morts-terrains, l'usine de traitement et l'aire de stockage du minerai), la seule solution de rechange réalisable sur le plan technique et économique consiste à diriger l'eau de contact vers les bassins de surface locaux, puis vers l'installation de traitement des effluents.
L'utilisation d'un seul site de rejet d'effluents traités plutôt que de plusieurs sites a été jugée plus réalisable et simple. Les sites potentiels de rejet d'effluents traités comprenaient le tributaire du bras sud-ouest, le lac Mosher, la baie Barton, le bras sud-ouest du lac Kenogamisis et le bassin central du lac Kenogamisis. Compte tenu de la proximité du rivage, de la profondeur de l'eau, de la nature du débit et de l'évitement des zones vulnérables de frai et d'alimentation des poissons, il a été déterminé que le meilleur endroit se trouvait au sud de l'embouchure de l'affluent du bras sud-ouest, à environ 100 mètres au large. Les effets potentiels sur l'usage des terres et des ressources à des fins traditionnelles étaient considérées pour chaque site potentiel, et n'a pas été un élément déterminant car des effets ont été identifiés à chaque site potentiel.
Source d'énergie et infrastructure connexe
Bien qu'une ligne de distribution traverse actuellement la zone de développement du projet, le raccordement au réseau de transport existant ne serait pas réalisable sur le plan technique, car le réseau n'aurait pas la capacité de fournir toute l'énergie nécessaire au projet pendant l'exploitation. L'établissement d'une centrale au gaz naturel a été désigné comme la seule solution de rechange possible pour une source d'énergie primaire pour le projet. Le gaz naturel serait fourni par un court pipeline de distribution exploité par Union Gas.
Deux options ont été envisagées pour fournir l'énergie avant la mise en service de la centrale au gaz naturel, pendant la construction et le début de l'exploitation. Des génératrices diesel temporaires fourniraient de l'énergie fiable et souple sur le site, mais ne seraient pas réalisables sur les plans économique et technique comme source d'énergie primaire en raison de l'augmentation des émissions atmosphériques, y compris les émissions de gaz à effet de serre, et de l'augmentation des coûts de construction et de carburant. La capacité de la ligne de distribution existante serait suffisante pour les activités initiales. Bien qu'elle puisse être vulnérable aux pannes causées par des phénomènes météorologiques violents, elle permettrait de réduire les coûts et de limiter les effets environnementaux. Le promoteur a déterminé qu'une combinaison des deux solutions serait la solution de rechange la plus fiable pour l'alimentation temporaire et de secours du projet.
Remplissage de la fosse à ciel ouvert après l'exploitation
Trois solutions de rechange ont été envisagées pour le remplissage de la fosse à ciel ouvert après l'exploitation : le remplissage naturel avec de l'eau, le remplissage amélioré avec de l'eau et le remblayage au moyen de stériles. Le remplissage amélioré a été retenu parce qu'il réduirait le temps nécessaire pour remplir la fosse à ciel ouvert (environ 16 ans, comparativement à environ 147 ans pour le remplissage naturel). Le remplissage amélioré ajouterait de l'eau de contact provenant du projet, de l'eau recyclée provenant de l'installation de gestion des résidus miniers et du bassin M1, et de l'eau douce provenant du bras sud-ouest du lac Kenogamisis. Cette option réduirait les variations de la qualité de l'eau en réduisant la lixiviation des métaux et les conditions génératrices d'acide dans la fosse à ciel ouvert, et permettrait également à la faune d'accéder plus tôt à l'habitat remis en état. Le prélèvement d'eau à partir du bras sud-ouest du lac Kenogamisis ne devrait pas avoir d'effet sur les niveaux d'eau globaux du lac.
Analyse et conclusion de l'Agence
L'évaluation des solutions de rechange du promoteur a permis d'examiner la rentabilité, l'applicabilité technique et la fiabilité des autres options choisies, les effets sur les composantes valorisées sélectionnées et les observations des groupes autochtones. D'après son examen de l'analyse, l'Agence est d'avis que le promoteur a suffisamment évalué les solutions de rechange réalisables pour le projet aux fins de l'évaluation des effets environnementaux du projet sous le régime de la LCEE 2012.
4. Activités de consultation et conseils reçus
Les observations formulées par les groupes autochtones et les participants du public pendant l'évaluation environnementale ont été prises en compte par l'Agence dans son analyse et ses conclusions du projet. Les connaissances locales et traditionnelles relatives à l'emplacement du projet ont également été prises en compte pour déterminer les effets possibles sur l'environnement.
Les avis reçus des autorités fédérales et les renseignements clés échangés entre l'Agence et la province de l'Ontario ont alimenté et appuyé davantage l'examen du projet par l'Agence. Comme l'Agence et la province de l'Ontario ont mené de concert les évaluations environnementales fédérale et provinciale, dans la mesure du possible, les gouvernements ont également tenu des réunions conjointes avec certains groupes autochtones et transmis de l'information reçue du public et des participants autochtones tout au long des processus simultanés.
L'Agence a offert au public, aux groupes autochtones et aux examinateurs gouvernementaux quatre occasions de participer au processus d'évaluation environnementale. Ces activités de consultation publique ont été annoncées sur le site Web du Registre canadien d'évaluation environnementale. Au cours de ces consultations, l'Agence a sollicité des observations sur les enjeux suivants :
- la nécessité d'effectuer ou pas une évaluation environnementale (du 28 avril 2014 au 20 mai 2014);
- la version provisoire des lignes directrices sur l'étude d'impact environnemental (du 13 juin 2014 au 13 juillet 2014);
- l'étude d'impact environnemental du promoteur (du 21 août 2017 au 6 octobre 2017);
- une version provisoire de ce rapport et des conditions possibles (du 1er octobre 2018 au 1er novembre 2018).
Après avoir pris en considération les observations du public, des groupes autochtones et des examinateurs gouvernementaux, l'Agence a finalisé le rapport d'évaluation environnementale et l'a communiqué à la ministre fédérale de l'Environnement et du Changement climatique pour qu'elle rende sa décision sur le projet.
4.1 Participation du public
4.1.1 Participation du public dirigée par l'Agence
Durant la période d'examen de l'étude d'impact environnemental, l'Agence a participé à des assemblées publiques avec le promoteur et des représentants des autorités fédérales et des ministères provinciaux. Ces réunions ont eu lieu à Longlac et à Geraldton le 13 septembre 2017 et à Thunder Bay le 16 septembre 2017. Les membres du public ont ainsi reçu de l'information sur le processus d'évaluation environnemental, le projet et l'étude d'impact environnemental du promoteur et ont pu formuler leurs observations à cet égard. L'Agence a également reçu des lettres de plusieurs groupes d'affaires du Nord-Ouest de l'Ontario indiquant qu'ils appuient le projet.
4.1.2 Participation du public dirigée par le promoteur
Le promoteur a consulté les résidents de la municipalité de Greenstone (Geraldton, Longlac, Beardmore et Nakina) et de la ville de Thunder Bay au sujet du projet, de ses effets potentiels et des mesures d'atténuation possibles. De plus, le promoteur a consulté d'autres intervenants susceptibles d'être touchés ou intéressés, notamment des utilisateurs des terrains locaux, des organismes communautaires, des associations d'entreprises et des organismes gouvernementaux.
Les activités de consultation publique et de participation organisées par le promoteur incluaient la tenue de réunions, l'organisation d'assemblées publiques et de visites des lieux, ainsi que l'élaboration et la diffusion de documents rédigés en langage clair (p. ex. des fiches techniques et des bulletins) pour partager des renseignements et recevoir une rétroaction à propos du projet.
4.2 Consultations de la Couronne et mobilisation des groupes autochtones
4.2.1 Consultations de la Couronne dirigées par l'Agence
La Couronne a l'obligation de consulter les groupes autochtones et, s'il y a lieu, de prendre des mesures d'adaptation lorsque la conduite proposée pourrait avoir une incidence négative sur les droits ancestraux et issus de traités protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982Note de bas de page 4. Les consultations de la Couronne constituent, de façon générale, un élément important de la bonne gouvernance, de l'élaboration rigoureuse de politiques et d'une prise de décisions adéquate.
Pour les besoins de l'évaluation environnementale fédérale, l'Agence fait office de coordonnateur des consultations de la Couronne afin de faciliter une approche de consultation pangouvernementale. Les groupes autochtones qui ont été invités à participer aux consultations comprenaient ceux qui s'intéressent au projet parce que le projet pouvait nuire aux droits ancestraux et issus de traités.
Afin de respecter les obligations de consultation de la Couronne, l'Agence a consulté les Autochtones de façon intégrée dans le cadre de l'évaluation environnementale. Tout au long de l'évaluation, l'Agence a offert à ces groupes des occasions de parler de leurs préoccupations, par des appels téléphoniques, de la correspondance et des réunions. L'Agence a régulièrement fait le point auprès des groupes autochtones afin de les tenir informés des principaux progrès et demander leurs avis. De plus, les groupes ont été invités à participer aux quatre consultations officielles mentionnées ci-dessus.
Par son Programme d'aide financière aux participants, l'Agence administre des fonds destinés à appuyer la participation des groupes autochtones au processus d'évaluation environnementale. Au total, l'Agence a alloué 363 617 $, comme l'indique le tableau 4, pour appuyer la participation de onze groupes autochtones à l'évaluation environnementale.
| Groupe autochtone | Montant alloué |
|---|---|
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek | 62 350,00 $ |
| Première Nation d'Aroland | 62 150,00 $ |
| Biigtigong Nishnaabeg | 9 600,00 $ |
| Première Nation de Constance Lake | 10 497,00 $ |
| Première Nation d'Eabametoong | 10 500,00 $ |
| Première Nation de Ginoogaming | 62 295,00 $ |
| Première Nation de Long Lake no 58 | 62 350,00 $ |
| Première Nation de Marten Falls | 10 500,00 $ |
| Nation métisse de l'Ontario | 52 375,00 $ |
| Première Nation de Pays Plat | 10 500,00 $ |
| Nation indépendante des Métis de Red Sky | 10 500,00 $ |
| Total | 363 617,00 $ |
Trois autres groupes autochtones (Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek, Bingwi Neyaashi Anishinaabek et la Première Nation de Pic Mobert) participent au processus d'évaluation environnementale, mais n'ont pas présenté de demande de financement.
L'Agence a participé à une assemblée de la Première Nation de Ginoogaming en août 2014. L'Agence a rencontré des représentants de la Première Nation d'Aroland en janvier 2016 et en mars 2016, de la Nation métisse de l'Ontario en février 2016 et de la Première Nation de Long Lake no 58 en mars 2016 pour discuter de la version provisoire de l'étude d'impact environnemental du promoteur. L'Agence a également tenu des assemblées en mai 2016 avec la Première Nation de Long Lake no 58 et ses experts-conseils, ainsi qu'avec des représentants d' Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, de la Première Nation d'Aroland et de la Nation métisse de l'Ontario. Pour les membres de ces groupes autochtones, ces réunions étaient l'occasion d'assister à des présentations portant sur le processus d'évaluation environnementale et les conclusions de l'étude d'impact environnemental du promoteur, et de formuler des observations à cet égard.
Au cours de la période de consultation publique sur la version définitive de l'étude d'impact environnemental, l'Agence a offert des réunions de consultation en personne à tous les groupes susceptibles d'être les plus touchés par le projet. En septembre 2017, l'Agence a tenu des assemblées et des journées portes ouvertes avec trois groupes autochtones : Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation de Ginoogaming et la Première Nation de Long Lake no 58. Une assemblée prévue avec la Première Nation d'Aroland a été annulée à la demande de cette collectivité. Des représentants d'Environnement et Changement climatique Canada et de Santé Canada ont assisté à ces réunions.
L'Agence a tenu des réunions de consultation en personne avec Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland, la Première Nation de Ginoogaming, et la Nation métisse d'Ontario, et a tenu une réunion par téléconférence avec la Première Nation de Long Lake no 58 pendant la période de consultation sur la version provisoire de ce rapport et des conditions potentielles.
Les principaux problèmes soulevés par les groupes autochtones au cours de l'évaluation environnementale comprennent les suivants :
- l'aménagement et l'emplacement de l'installation de gestion des résidus miniers et l'élimination des résidus historiques;
- les changements à la qualité de l'eau et les effets potentiels sur les poissons et leur habitat;
- les effets sur l'élan d'Amérique et sa présence;
- les effets sur l'utilisation courante, la santé humaine et le bien-être culturel.
Dans l'ensemble, les groupes autochtones appuient le projet, mais ont soulevé des points précis relatifs aux questions techniques dans des observations écrites et dans des réunions avec l'Agence. L'Agence a tenu compte de toutes les observations pour élaborer le rapport. Les effets potentiels sur les peuples autochtones sont abordés plus en détail aux sections 7.3, 7.4 et 7.5 du rapport, tandis que les répercussions possibles du projet sur les droits ancestraux et issus de traités sont abordées au chapitre 9.
4.2.2 Mobilisation des groupes autochtones dirigée par le promoteur
Le promoteur a mobilisé tous les groupes autochtones désignés par l'Agence pour discuter des enjeux en organisant des réunions, des assemblées publiques et des visites des lieux, et en élaborant et en diffusant des documents rédigés en langage clair (p. ex. des fiches de renseignement et des bulletins d'information) dans le but de communiquer des renseignements et de recevoir des observations. La mobilisation a été continue tant avant que durant le processus d'évaluation environnementale.
Le promoteur a fourni de l'aide financière aux collectivités pour retenir les services d'experts techniques, afin d'examiner l'étude d'impact environnemental et d'autres documents, pour réaliser des études concernant les connaissances traditionnelles et l'usage traditionnel des terres et des ressources, pour obtenir des services de conseillers professionnels et juridiques, et pour l'appui de la collectivité, au besoin. Le promoteur a conclu une entente avec la Première Nation de Long Lake no 58, est arrivé à une entente en principe avec Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland, la Première Nation de Ginoogaming, et continue à négocier avec la Nation métisse de l'Ontario.
4.3 Participation d'experts fédéraux et autres
Conformément à l'article 11 de la LCEE 2012, les autorités fédérales qui possèdent des renseignements ou des connaissances spécialisées ou encore une expertise relative au projet ont fourni des conseils afin que l'on détermine si une évaluation environnementale fédérale était nécessaire. Conformément à l'article 20 de la LCEE 2012, les autorités fédérales ont participé à l'examen des Lignes directrices relatives à l'étude d'impact environnemental et de l'étude d'impact environnemental du promoteur, et ont donné leur avis pour l'établissement du présent rapport.
Les autorités fédérales suivantes ont apporté leur collaboration à chaque phase du processus d'évaluation environnementale sur la base d'informations ou de connaissances spécialisées ou émanant d'experts :
- Pêches et Océans Canada : concernant les poissons, et leur habitat, qui font l'objet d'une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou qui la soutiennent, et concernant les dispositions sur les passes migratoires et le débit;
- Environnement et Changement climatique Canada : concernant la qualité de l'air, la méthode et le lieu d'élimination des déchets miniers quand les plans d'eau fréquentés par le poisson sont empiétés, les rejets d'effluents liés à la gestion des déchets miniers, la géochimie, la qualité de l'eau et son volume, les espèces non aquatiques en péril, les oiseaux migrateurs, la météorologie, les changements climatiques, les accidents et les défaillances;
- Ressources naturelles Canada : sur la géochimie et la gestion des matériaux miniers, la quantité d'eaux souterraines, les interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface;
- Transports Canada : sur la navigation;
- Santé Canada : concernant les effets potentiels sur la santé des Autochtones en rapport avec les aliments prélevés dans la nature, la qualité de l'eau, le bruit et la qualité de l'air.
Les ministères provinciaux suivants ont également fourni des conseils à l'Agence : le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs; le ministère de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines; le ministère des Richesses naturelles et des Forêts; le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport; le ministère des Transports; le ministère des Affaires municipales et du Logement et Hydro One.
5. Cadre géographique
D'importantes activités d'exploitation aurifère ont lieu depuis les années 1930 dans la région près de Geraldton, activités qui ont culminé dans les années 1940. Le projet se trouve en partie dans un secteur activement exploité entre les années 1930 et 1970 par la mine souterraine MacLeod-Mosher (anciennement MacLeod-Cockshutt et Mosher-Long Lac) et l'ancienne mine Hardrock. Les travaux de remise en état à l'usine de traitement et aux sites de gestion des résidus miniers ont été achevés entre 1997 et 1999. Les résidus des anciennes mines sont présents dans la zone de développement du projet – les résidus historiques de l'ancienne mine MacLeod sont situés au nord-est de l'intersection actuelle de la route 11 et du boulevard Michael Power, alors que les résidus de l'ancienne mine Hardrock sont situés au sud du périmètre urbain de Hardrock.
5.1 Milieu naturel
Le projet est situé dans la ceinture de Beardmore-Geraldton Greenstone. La topographie de la zone de développement du projet et de la région environnante varie de relativement plate à légèrement ondulée, sans caractéristiques topographiques distinctes. L'inclinaison de la surface du sol passe de zones élevées topographiques locales, principalement des affleurements rocheux, à des zones basses caractérisées par des marécages et des étangs présentant à faible drainage dans l'ensemble de la zone.
Atmosphère (air, bruit et lumière)
La qualité de l'air est principalement influencée par le district de Geraldton et la circulation sur la route 11. Les concentrations mesurées de dioxyde d'azote, de dioxyde de soufre, de particules totales en suspension et de composés organiques volatils sont bien inférieures aux Critères de qualité de l'air ambiant de l'Ontario. Les conditions sonores actuelles dans la zone sont caractéristiques d'un environnement acoustique où domine le « bourdonnement urbain » ou le bruit de circulation durant le jour, alors que le son de l'environnement naturel domine l'environnement nocturne.
Eau (eau souterraine et de surface)
L'écoulement des eaux souterraines à proximité de la zone de développement du projet a tendance à suivre la topographie, généralement vers le sud-est vers le lac Kenogamisis, avec une recharge à des altitudes plus élevées et un écoulement dans les ruisseaux, les rivières, les terres humides et les lacs situés à faible élévation, ce qui donne lieu à des zones d'écoulement localisées. Certains paramètres de qualité des eaux souterraines, comme l'arsenic, sont élevés par rapport aux normes de qualité de l'eau provinciaux en raison des anciennes pratiques minières, la minéralisation naturelle et des processus géochimiques dans la zone de développement du projet, ce qui est typique des eaux souterraines en Ontario.
La zone de développement du projet se trouve dans le bassin versant de la rivière Kenogamisis, à proximité du lac Kenogamisis (figure 11). Le lac est long, étroit et peu profond et comprend quatre bassins principaux : le bras sud-ouest, le bassin de la baie Barton, le bassin central et le bassin versant. L'affluent principal du lac Kenogamisis est la rivière Kenogamisis, qui se jette dans bras sud-ouest. Les cours du bras sud-ouest et le bras de la baie Barton se déversent dans le bassin central où, après s'être mélangés dans le bassin central, ils passent sous le pont de la route 11 jusqu'au bassin versant. Les cours sont régulés au barrage du lac Kenogamisis, à la sortie du lac dans le bassin versant, et se déversent dans la partie inférieure de la rivière Kenogamisis.
Les eaux du lac Kenogamisis et des ruisseaux et des lacs avoisinants sont généralement modérément dures avec un pH à peu près neutre, un total de solides dissous et des concentrations relativement faibles de solides en suspension. La qualité de l'eau dans le lac Kenogamisis s'est améliorée au cours des dernières décennies après les activités de réhabilitation, bien que les concentrations d'arsenic soient demeurées relativement constantes au cours des 40 dernières années dû aux anciennes pratiques minières dans la région.
Peuplements végétaux
La zone de développement du projet se situe dans le plateau central, le long de la limite sud de la région de la forêt boréale, dans le nord de l'Ontario. Le couvert forestier typique est composé d'un mélange de feuillus et de conifères sur un terrain élevé ainsi que de terres humides de marécages à conifères; les communautés végétales prédominantes sont des conifères avec quelques espèces à caducifoliées associées. En raison des anciennes activités d'exploitation minière et forestière, la zone de développement du projet présente une variété de végétation qui va de communautés de succession en début de croissance dans des sites à ciel ouvert ayant subi des perturbations à des forêts de conifères et de feuillus matures naturalisés.
Faune aquatique et terrestre
Le bassin hydrographique de la rivière Kenogamisis abrite de nombreuses espèces de poissons pour la pêche sportive ou de subsistance, ainsi que d'autres espèces de poissons de petite taille, avec une diversité et une abondance supérieures dans les lacs et les cours d'eau plus grands. Les lacs locaux fournissent un habitat pour les espèces d'eau froide, y compris un habitat de frai pour le brochet et la perche commune. Ces habitats offrent également une frayère et un habitat d'alimentation importants à certains poissons comme le doré jaune et le grand corégone où la rivière Kenogamisis et le ruisseau Magnet se jettent dans le lac Kenogamisis. La faune observée dans la région comprend divers mammifères, oiseaux, sauvagine, reptiles et amphibiens, qui sont généralement communs et abondants dans la région boréale.
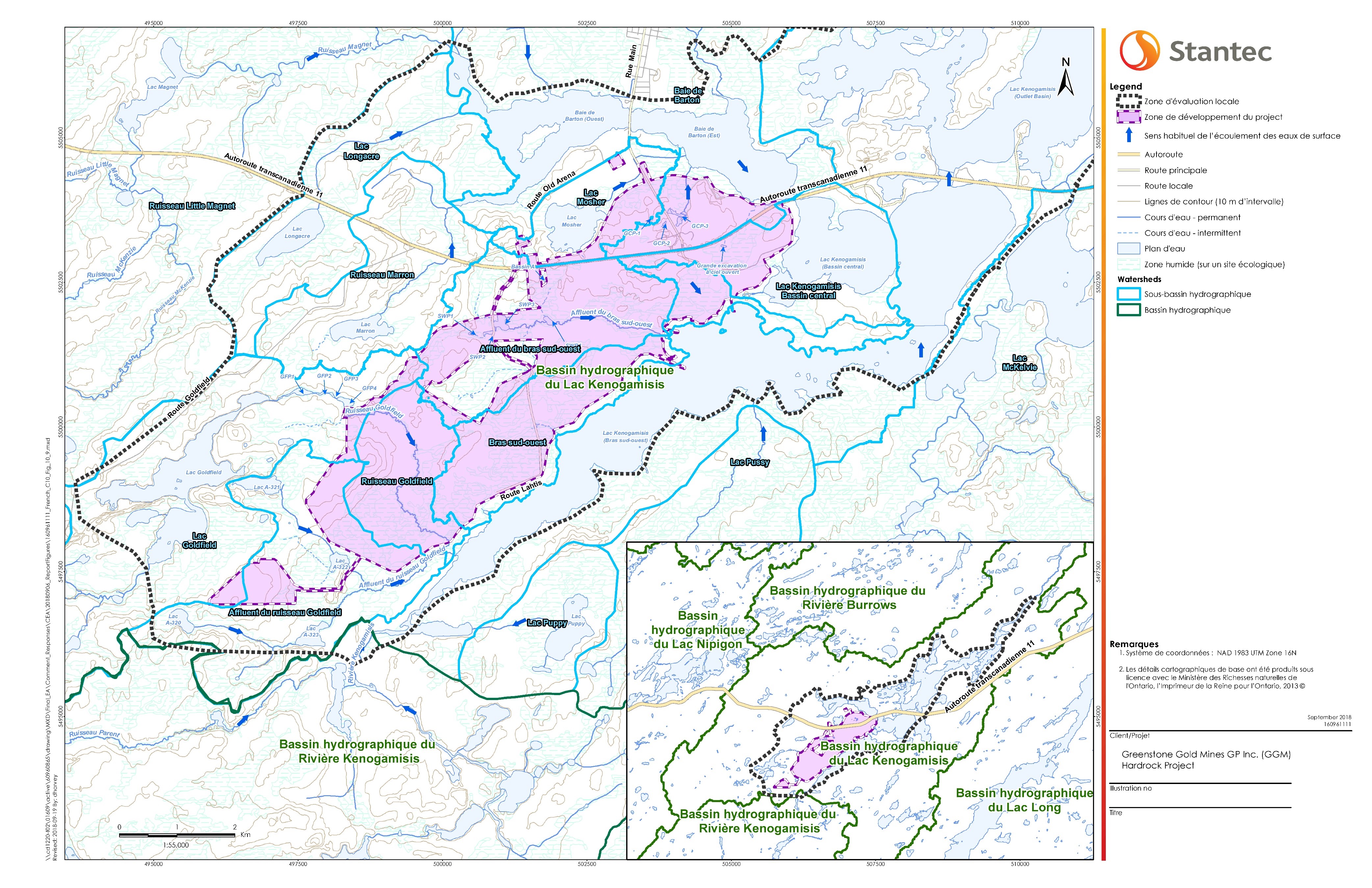
Source : Stantec, septembre 2018
5.2 Milieu humain
Le projet est situé dans la municipalité de Greenstone (4 636 habitants, selon le recensement de 2016), à environ cinq kilomètres au sud du district de Geraldton (1 828 habitants), et à 275 kilomètres au nord-est de Thunder Bay (121 596 habitants). Le cœur du projet se situe à proximité de l'intersection de la route 11 (la route Transcanadienne) avec le boulevard Michael Power, qui donne accès à Geraldton.
Usage général du territoire et des ressources
La zone de développement du projet se trouve sur une friche industrielle comprenant des résidus historiques et puits des anciennes mines, de deux piles de sciures de bois au bout du chemin Lahtis résultant des anciennes activités forestières, ainsi que divers chemins miniers et forestiers qui peuvent être désaffectés. L'ancien chevalement du puits MacLeod-Mosher et le centre d'interprétation Discover Geraldton, situés à l'intersection de la route 11 avec le boulevard Michael Power, sont des attractions touristiques locales. Le club de golf de Kenogamisis est situé sur le boulevard Michael Power, juste au nord de la route 11. Le parc provincial MacLeod est situé de l'autre côté du bassin central du lac Kenogamisis et offre des activités comme le camping, la randonnée, la pêche, la natation, la navigation de plaisance, le canotage, le vélo, les pique-niques et l'observation des oiseaux. Les activités commerciales liées aux ressources comprennent le piégeage, la récolte de poissons-appâts, les visites guidées, l'exploration minière et forestière.
Usage du territoire et des ressources par les Autochtones
Le projet est situé dans le territoire visé par le Traité de la baie James no 9, qui offre des droits de chasse, de piégeage et de pêche ainsi qu'une protection à ses signataires dans l'ensemble de la zone du traité. Le territoire visé par le Traité Robinson-Lac Supérieur est situé à l'ouest, au sud et à l'est du projet. La figure 12 illustre l'emplacement du projet par rapport à ces traités.
La réserve de Ginoogaming est la réserve autochtone la plus près, située à 22 kilomètres à l'est du projet. La réserve Première Nation de Long Lake no 58 est située à 28 kilomètres à l'est du projet, et la réserve de l'établissement indien d'Aroland est située à 90 kilomètres au nord du projet. Le bureau administratif de Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek est actuellement situé à Beardmore, à 80 kilomètres à l'ouest du projet. La réserve de la collectivité du lac Nipigon est en cours de développement et sera située à environ 24 kilomètres à l'ouest du projet. La Nation métisse de l'Ontario indique qu'il existe une communauté métisse historique au nord du lac Supérieur et dans la région de Nipigon en particulier, composée des populations métisses interconnectées du lac Nipigon, du lac Long et de la rivière Pic et d'autres endroits dans la région.
La chasse, le piégeage, la pêche, la cueillette de plantes et d'autres pratiques culturelles ont toujours lieu dans toute la zone d'évaluation régionale de l'usage actuel des terres et des ressources à des fins traditionnelles (figure 3). La Nation métisse de l'Ontario exerce ses droits de chasse, de pêche et de cueillette sur les territoires traditionnels de Lakehead, Nipigon et Michipicoten. Le chemin Lahtis donne accès aux zones à proximité du bras sud-ouest du lac Kenogamisis et aux environs. Les sites culturels (y compris les sentiers et les voies de circulation), les lieux sacrés, les lieux de rassemblement communautaires et les lieux d'habitation sont utilisés par les groupes autochtones dans l'ensemble de la zone d'évaluation régionale pour l'usage actuel des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Les groupes autochtones ont identifié des sites culturels dans la zone de développement du projet et dans la zone d'évaluation locale pour l'usage actuel des terres et des ressources à des fins traditionnelles, et continuent d'utiliser les lieux de rassemblement traditionnels pour se réunir à des fins de socialisation, de récolte ou de cérémonie.
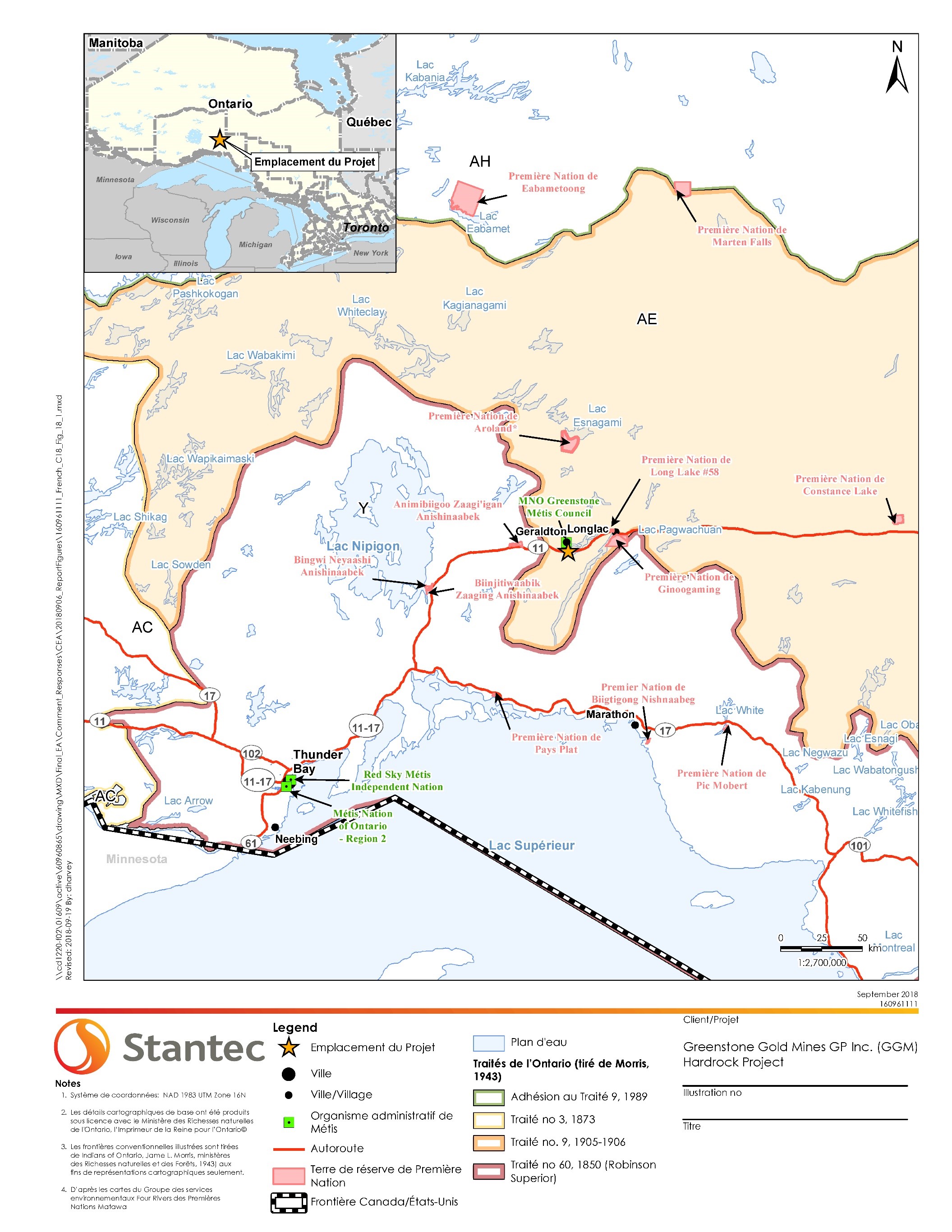
Source : Stantec, septembre 2018
6. Modifications prévues de l'environnement
6.1 Environnement atmosphérique
Le projet pourrait causer à l'environnement atmosphérique des effets résiduels par :
- l'augmentation des concentrations de contaminants dans l'air ambiant;
- l'augmentation du niveau de bruit ambiant;
- l'augmentation de la vibration causée par les activités de dynamitage près du lac Kenogamisis.
Le résumé de l'évaluation du promoteur sur les modifications de l'environnement atmosphérique établi par l'Agence a tenu compte des points de vue exprimés par les ministères fédéraux et provinciaux ainsi que par les groupes autochtones. L'Agence a utilisé ce résumé dans son analyse des effets sur les poissons et leur habitat (section 7.1), les utilisations par les Autochtones (section 7.3) et la santé humaine (section 7.4), y compris les mesures d'atténuation et de programme de suivi.
Description de l'environnement actuel
Les zones d'évaluation locale et régionale pour la qualité de l'air, le bruit et la vibration sont présentées à la section 1.2.5. Les concentrations actuelles de particules totales, incluant les matières particulaires de moins de 10 micromètres de diamètre (PM10) et les matières particulaires fines (PM2,5), de dioxyde d'azote, de dioxyde de soufre, de monoxyde de carbone et de métaux sont inférieures aux normes fédérales applicablesNote de bas de page 5. Les concentrations actuelles de benzène et de benzo(a)pyrène étaient supérieures aux normes provinciales applicablesNote de bas de page 6. Le niveau actuel de bruit est inférieur aux valeurs des normes provinciales applicablesNote de bas de page 7. Le niveau actuel de vibration n'a pas été mesuré, car aucune source de vibration existante n'a été relevée dans la zone d'évaluation locale.
6.1.1 Augmentation des concentrations de contaminants dans l'air ambiant
Évaluation des effets environnementaux par le promoteur et mesures d'atténuation et de surveillance proposées
Les émissions atmosphériques ont été modélisées à l'aide d'hypothèses prudentes pour la construction et l'exploitation. Les hypothèses étaient fondées sur une période au cours de chaque phase du projet où la masse la plus élevée de matières a été déplacée.
Des émissions de particules et de métaux issus de la poussière, ainsi que des émissions oxydes d'azote, du dioxyde de soufre, du monoxyde de carbone et des composés organiques volatils issus des émissions de gaz d'échappement au cours de la construction résulteront de la modification du tracé de la route 11; de l'excavation de résidus historiques; de l'aménagement des haldes de minerai, des dépôts des morts-terrains, des installations de gestion des stériles et de l'installation de gestion des résidus; de l'excavation de la fosse à ciel ouvert; de la manutention des matières; et de l'utilisation de routes non asphaltées. Les activités de dynamitage entraîneront également des émissions de dioxyde d'azote et de monoxyde de carbone.
Des émissions de particules et de métaux issus de la poussière au cours de l'exploitation résulteront des activités dans la fosse à ciel ouvert (dynamitage, forage et excavation); de la manutention et du transport des matières; de la gestion du minerai et des stériles sur place et l'empilement; du traitement du minerai (déchargement, concassage et fonte); et du déplacement des résidus historiques. Le dynamitage entraînera aussi des émissions, notamment du dioxyde d'azote et du monoxyde de carbone. La destruction du cyanure utilisé dans le raffinage émettra du dioxyde de soufre. La combustion du diesel au cours des premières années de l'exploitation entraînera également des émissions de produits de combustion (dioxyde d'azote, dioxyde de soufre, monoxyde de carbone).
Les dépassements peu fréquents (jusqu'à 0,3 % du temps, ou un jour par année) des normes de qualité de l'air applicables sont prévus dans certaines parties de la zone d'évaluation locale pour les concentrations moyennes sur 24 heures des particules totales en suspension et des PM10. Ces dépassements se produiraient pendant l'exploitation, à l'est de la zone de développement du projet, en face de la fosse à ciel ouvert. Les concentrations de PM2,5 et de dioxyde d'azote devraient également augmenter dans certaines parties de la zone d'évaluation locale pendant la construction et l'exploitation, mais ne dépasseraient pas les normes de qualité de l'air applicables. Bien que des dépassements des concentrations moyennes annuelles de benzène ainsi que des concentrations moyennes de 24 heures et annuelles de benzo(a)pyrène soient prévus, ces derniers résultent des concentrations de fond moyennes qui sont déjà au-dessus des normes de qualité de l'air applicables; l'augmentation des concentrations de benzène est d'environ 11 % par rapport à la norme et l'augmentation des concentrations de benzo(a)pyrène est d'environ 30 % par rapport à la norme. Une analyse de l'incidence que les variations de la qualité de l'air pourraient avoir sur l'utilisation par les Autochtones se trouve à la section 7.3, tandis que l'analyse de l'incidence sur la santé humaine est présentée à la section 7.4.
Les mesures visant à réduire les changements de la qualité de l'air comprennent celles-ci :
- Contrôler les émissions fugitives de poussière provenant des routes, des aires de manutention et des dépôts, haldes et installations de gestion des résidus et stériles à l'aide de pulvérisations d'eau, de suppresseurs chimiques, de balayages de la poussière, de l'épandage de gravier, de stations de lavage des roues des camions et de confinement des sources de poussière;
- Utiliser des dépoussiérants (p. ex. de l'eau) pour réduire la poussière en suspension dans l'air, y compris arroser les routes non asphaltées lorsqu'elles sont sèches;
- Utiliser un épurateur sur le four à induction pour contrôler les émissions;
- Imposer des limites de vitesse jusqu'à 65 kilomètres par heure sur les routes non asphaltées et réduire les itinéraires de transport à destination de la zone de développement du projet et à l'intérieur de cette dernière, afin de réduire la poussière émise par les véhicules;
- Équiper les concasseurs de systèmes de dépoussiérage (filtre à sacs ou l'équivalent) pour contrôler les émissions fugitives pendant le concassage et le transfert du minerai;
- Isoler l'aire d'entreposage du minerai d'alimentation afin de contrôler les émissions de poussière;
- Couvrir ou mouiller les matières transportées, y compris les granulats, les emprunts et les résidus historiques, afin de réduire la production de poussière fugitive.
La surveillance de l'air ambiant comprendra l'échantillonnage des particules totales en suspension à quatre ou cinq endroits à proximité de la zone de développement du projet, et la surveillance en temps réel des PM10 à un endroit en amont et à deux endroits en aval dans la zone d'évaluation locale, près de la zone de développement du projet. Les concentrations de métaux seraient surveillées à partir des filtres qui ont recueilli les particules totales en suspension au cours de la première année de l'exploitation, et l'échantillonnage continu des métaux devrait être évalué après la première année. L'échantillonnage de la poussière des routes validerait les hypothèses formulées au sujet de la teneur en limon des routes et confirmerait les prévisions relatives à la formation de particules.
Opinions exprimées
Les Premières Nations d'Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, d'Aroland et de Ginoogaming ont indiqué que le promoteur doit surveiller les concentrations de particules de métaux traces dans la poussière liée au projet afin de comprendre les risques associés à l'inhalation ou au dépôt de poussière liée au projet. Le promoteur a indiqué que les concentrations de métaux traces seraient déterminées par l'analyse d'échantillons prélevés de particules ambiantes ou de retombées de poussières, et que les métaux seraient analysés jusqu'à ce qu'on ait recueilli suffisamment de renseignements confirmant que les concentrations de métaux ambiants sont inférieures aux critères applicables.
Environnement et Changement climatique Canada et le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario ont soulevé des questions au sujet du caractère conservateur des hypothèses formulées au sujet de l'efficacité du contrôle (degré de poussière capturé par le dépoussiérant) et de la teneur en limon (portion de particules trop fines pour être captées par l'eau) de la poussière produite par le trafic sur les routes de transport. Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada ont aussi soulevé la nécessité de surveiller les niveaux de dioxyde d'azote pendant toutes les phases du projet, pour vérifier les prédictions de l'évaluation environnementale et l'efficacité des mesures d'atténuation, et pour assurer que ces niveaux demeurent au-dessous des normes canadiennes de qualité de l'air ambiant annoncés en novembre 2017. Le promoteur a indiqué que les hypothèses sont conformes aux ensembles de données examinés par des pairs de l'Environmental Protection Agency des États-Unis et à d'autres évaluations environnementales minières en Ontario. Le promoteur a accepté de surveiller la teneur en limon dans le cadre de son programme de surveillance de la qualité de l'air, et appliquera des mesures d'atténuation additionnelles au besoin.
6.1.2 Augmentation du niveau de bruit ambiant
Évaluation des effets environnementaux par le promoteur et mesures d'atténuation et de surveillance proposées
Le modèle de bruit était prudent et supposait que tout l'équipement fonctionnerait simultanément à un débit de 100 %, et que le dynamitage à ciel ouvert se ferait près de la surface pour maximiser la propagation du bruit. Les émissions de bruit pendant l'exploitation résulteront du roulage des matières sur place; de l'utilisation d'excavatrices et de bouteurs; de l'empilement de minerai pauvre et de stériles; des activités de l'usine de transformation et d'autres installations; de la gestion des déchets miniers, notamment les installations de gestion des stériles et des résidus; des activités de production d'énergie; et du dynamitage.
Des dépassements des valeurs des normes de bruit provinciales7 sont prévus dans un rayon de 0,5 kilomètre de la zone de développement du projet, en particulier à l'est et au sud de la fosse à ciel ouvert, et le long de la rive ouest du lac Kenogamisis. Le bruit provenant du dynamitage devrait demeurer dans les limites des normes de bruit provinciales pour le dynamitageNote de bas de page 8 à l'extérieur de la zone de développement du projet. Une analyse de l'incidence que les variations du niveau de bruit pourraient avoir sur l'utilisation par les Autochtones se trouve à la section 7.3.
Les mesures visant à réduire les changements au niveau de bruit comprennent ce qui suit :
- Les principales activités de construction auront lieu pendant le jour (soit entre 7 h et 19 h), dans la mesure du possible, afin d'éviter les périodes nocturnes sensibles.
- Informer les résidents avoisinants des principales activités génératrices de bruit et mettre en œuvre une procédure de réponse aux plaintes liées au bruit, le cas échéant.
- Dans la mesure du possible, faire du dynamitage entre 10 h et 16 h sur les jours de semaine, en évitant les jours fériés.
- Installer des mesures de réduction du bruit (p. ex. des silencieux) sur l'équipement et entretenir régulièrement l'équipement mobile.
- Utiliser des portes offrant un indice de transmission du son (ITS) de 20 ou plus dans les bâtiments abritant de l'équipement générateur de bruit, et garder les portes fermées lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Utiliser des silencieux d'admission et d'évacuation de l'air pour les cheminées d'échappement associées aux génératrices fonctionnant au diesel ou au gaz naturel.
Un programme de surveillance du bruit ambiant serait mené pour les activités de construction pendant les mois d'été et pendant la première année de phase 1 et de phase 2 de l'exploitation (section 2.3.2). Le programme de surveillance serait conçu pour respecter les exigences réglementaires provinciales. Le bruit de dynamitage serait mesuré à l'aide d'un outil capable de consigner le niveau de pression acoustique de pointe aux endroits et à la fréquence à déterminer.
6.1.3 Augmentation de la vibration causée par le dynamitage près du lac Kenogamisis
Le dynamitage dans la fosse à ciel ouvert serait la seule source de vibration. Les normes fédéralesNote de bas de page 9 de vibration pourraient être enfreintes lorsque le dynamitage se produit à moins de 275 mètres de la rive du bassin central du lac Kenogamisis. On prévoit que le niveau de vibration aux points de réception indiqués demeurera conforme aux normes provincialesNote de bas de page 10. La section 7.1 traite de la façon dont les variations du niveau de vibration pourraient affecter l'habitat des poissons.
Pendant la construction et l'exploitation, les activités de dynamitage seraient surveillées conformément aux exigences fédérales et provinciales. Les mesures visant à réduire les changements au niveau de vibration comprennent ce qui suit :
- Informer les résidents avoisinants des principales activités génératrices de bruit et mettre en œuvre une procédure de réponse aux plaintes liées au bruit, le cas échéant.
- Les principales activités de construction auront lieu pendant le jour (soit entre 7 h et 19 h), dans la mesure du possible, afin d'éviter les périodes nocturnes sensibles.
- Dans la mesure du possible, faire du dynamitage entre 10 h et 16 h sur les jours de semaine, en évitant les jours fériés.
6.2 Quantité d'eau
Le projet pourrait causer à la quantité d'eau des effets résiduels par :
- la diminution du débit annuel moyen dans le ruisseau Goldfield;
- l'augmentation du débit annuel moyen dans l'affluent du bras sud-ouest.
Le résumé de l'évaluation du promoteur sur les modifications de la quantité d'eau établi par l'Agence a tenu compte des points de vue exprimés par les ministères fédéraux et provinciaux ainsi que par les groupes autochtones. L'Agence a utilisé ce résumé dans l'analyse des poissons et de leur habitat (section 7.1), y compris les mesures d'atténuation et de suivi du programme.
Description de l'environnement actuel
Les zones d'évaluation locale et régionale pour les eaux souterraines et de surface sont présentées à la section 1.2.5. Les eaux souterraines sont l'une des principales sources d'écoulement vers les plans d'eau de surface dans la zone de développement du projet, y compris le ruisseau Goldfield et l'affluent du bras sud-ouest. L'écoulement des eaux souterraines est contrôlé par la topographie, s'effectuant généralement vers le sud-est en direction du lac Kenogamisis, avec un déversement dans les ruisseaux, les rivières, les milieux humides et les lacs situés à faible élévation. Les eaux souterraines dans la partie nord de la zone de développement du projet s'écoulent vers la baie Barton, le bassin central et le bras sud-ouest du lac Kenogamisis. Les eaux souterraines dans la partie sud de la zone de développement du projet s'écoulent vers le bras sud-ouest du lac Kenogamisis, le ruisseau Goldfield, l'affluent du bras sud-ouest et les milieux humides connexes.
L'affluent du bras sud-ouest prend naissance près de deux étangs en milieu humide (SWP1 et SWP2) du côté ouest du chemin Lahtis et s'écoule vers l'est sur environ 3,3 kilomètres dans la partie nord du bras sud-ouest du lac Kenogamisis. Le cours d'eau WC-K et le cours d'eau WC-L forment les eaux d'amont de ce cours d'eau.
Le ruisseau Goldfield est un cours d'eau plus important dans le sous-bassin hydrographique du ruisseau Goldfield (figure 9). Le ruisseau Goldfield prend sa source dans le lac Goldfield et s'écoule vers l'est, se déversant dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis. L'affluent du ruisseau Goldfield, un affluent plus petit du ruisseau Goldfield, draine une zone humide et le lac A-321 au sud du lac Goldfield et fusionne avec le ruisseau Goldfield, juste en amont de sa décharge au bras sud-ouest du lac Kenogamisis.
6.2.1 Diminution du débit annuel moyen dans le ruisseau Goldfield
Évaluation des effets environnementaux par le promoteur et mesures d'atténuation et de surveillance proposées
Une diminution du débit annuel moyen dans le ruisseau Goldfield est prévue en raison de l'aménagement de l'installation de gestion des résidus sur la majeure partie du ruisseau Goldfield; cependant, la construction du canal de dérivation du ruisseau Goldfield minimisera une partie de la diminution du débit annuel moyen. La collecte des eaux de ruissellement et des écoulements autour de l'installation de gestion des résidus; et le réacheminement de l'eau vers l'usine pour la transformation, ce qui réduirait au minimum les prélèvements d'eau dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis, causerait aussi une diminution du débit annuel moyen.
Pendant l'exploitation et la désaffectation, le débit annuel moyen dans le ruisseau Goldfield, au point de croisement avec le bras sud-ouest du lac Kenogamisis, diminuerait à un maximum prévu de 75 % par rapport aux conditions de référence. Toutefois, le niveau d'eau dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis devrait demeurer à moins de 5 % des conditions de référence pendant toutes les phases du projet. Pour vérifier les variations de débit prévues dans le ruisseau Goldfield, le niveau des eaux souterraines sera surveillé en amont, en pente transversale et en aval de l'installation de gestion des résidus. Pour vérifier le niveau et le débit des plans d'eau de surface environnants, une surveillance serait effectuée dans l'affluent du ruisseau Goldfield et le lac Kenogamisis.
6.2.2 Augmentation du débit annuel moyen dans l'affluent du bras sud-ouest
Évaluation des effets environnementaux par le promoteur et mesures d'atténuation et de surveillance proposées
Une augmentation du débit annuel moyen dans l'affluent du bras sud-ouest est prévue pendant toutes les phases du projet, en raison du raccordement du nouveau canal de dérivation du ruisseau Goldfield et à l'abandon, en raison des écoulements, des installations de gestion des stériles C et D et du lac de kettle.
Le débit annuel moyen devrait augmenter de 267 % par rapport aux conditions de référence pendant l'exploitation. La plus forte variation du débit annuel moyen (369 % par rapport aux conditions de référence) est prévue pendant la fermeture, en raison de la recharge des installations de gestion des stériles C et D ainsi que du lac de kettle. De plus, une fois que le lac de kettle est rempli et que l'eau dans les bassins de collecte des écoulements respecte les normes de qualité de l'eau applicablesNote de bas de page 11, le débit des bassins de collecte des écoulements serait dirigé vers l'affluent du bras sud-ouest, ce qui contribuerait davantage à l'augmentation du débit dans l'affluent. Pour vérifier les modifications prévues du niveau et du débit de l'affluent du bras sud-ouest, les eaux souterraines et les eaux de surface seraient surveillées pendant toutes les phases du projet.
Opinions exprimées
La Première Nation d'Aroland, Pêches et Océans Canada et Environnement et Changement climatique Canada ont demandé plus de détails sur la capacité de l'affluent du bras sud-ouest d'accepter des débits supplémentaires provenant du canal de dérivation du ruisseau Goldfield proposé. Le promoteur a confirmé que l'affluent actuel du bras sud-ouest a une capacité suffisante pour absorber l'augmentation du débit, jusqu'aux limites de la crue centenaire et de la tempête de TimminsNote de bas de page 12, sans que cet eau de non contact se mélange avec l'eau de contact collecté dans les fossés adjointes et le bassin de collecte M1, et que tout augmentation de débit n'éroderait pas la digue de l'installation de gestion des résidus.
6.3 Qualité de l'eau
Le projet pourrait causer à la qualité de l'eau des effets résiduels par :
- l'augmentation des contaminants dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis;
- l'augmentation des contaminants dans l'affluent du bras sud-ouest;
- l'augmentation des contaminants dans le lac Mosher.
Le résumé de l'évaluation du promoteur sur les modifications de la qualité de l'eau établi par l'Agence a tenu compte des points de vue exprimés par les ministères fédéraux et provinciaux ainsi que par les groupes autochtones. L'Agence a utilisé ce résumé dans son analyse des effets sur les poissons et leur habitat (section 7.2), sur les oiseaux migrateurs (section 7.2), sur l'utilisation par les Autochtones (section 7.3) et sur la santé humaine (section 7.4), y compris les mesures d'atténuation et de programme de suivi.
Description de l'environnement actuel
Les zones d'évaluation locale et régionale pour les eaux souterraines et de surface sont présentées à la section 1.2.5. Les données de référence montrent les dépassements des normes de qualité de l'eau applicablesNote de bas de page 13 pour l'arsenic et le fer. Ces concentrations élevées sont attribuées aux anciennes activités minières. Les résidus historiques de MacLeod et Hardrock dans la zone de développement du projet (figure 1) lixivient des métaux, dont de l'arsenic, du cobalt, du nickel, du zinc, du cadmium, du cyanure, de l'aluminium et du sélénium dans les plans d'eau avoisinants. Les études géochimiques indiquent que la roche minière et les résidus miniers du projet seraient pour la plupart non acidogènes.
Le bassin versant du lac Kenogamisis (figure 11) comprend plusieurs sous-bassins versants à apport et la qualité de leur eau reflète les divers niveaux d'activités humaines qui ont eu lieu près d'eux. Les sous-bassins versants du ruisseau Goldfield et du bras sud-ouest sont plus éloignés des anciennes activités minières et s'écoulent vers l'est en direction du bras sud-ouest du lac Kenogamisis. Bien que les concentrations d'arsenic dans l'affluent du bras sud-ouest dépassent les normes de qualité de l'eau applicables, les échantillons prélevés dans les sous-bassins versants du ruisseau Goldfield et du bras sud-ouest montrent moins de dépassements des normes de qualité de l'eau applicables pour les métaux.
Parmi les bassins du lac Kenogamisis, la baie Barton présente la concentration moyenne de métaux la plus élevée, y compris d'arsenic. Le bassin central, qui est relié au bras sud-ouest du lac Kenogamisis, présente des concentrations de métaux plus faibles que la baie Barton, tandis que le bras sud-ouest présente les concentrations de métaux les plus faibles. Le sous-bassin versant du lac Mosher, situé à l'est des anciennes activités minières, s'écoule vers le nord-est en direction de la baie Barton; la concentration moyenne d'arsenic dans le lac Mosher dépasse les normes de qualité de l'eau applicables.
6.3.1 Augmentation des contaminants dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis
Évaluation des effets environnementaux par le promoteur et mesures d'atténuation et de surveillance proposées
Une augmentation des concentrations d'arsenic, de mercure, de phosphore total et de l'ammoniac non ionisé au-dessus des conditions de référence est prévue dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis, en raison du déversement d'effluents traités; et des écoulements dans les eaux souterraines à partir de l'installation de gestion des stériles D, de l'installation de gestion des résidus miniers et des haldes de minerai. Ces augmentations seraient à long terme et irréversibles, car même si les effluents étaient traités pendant l'exploitation, les écoulements dans les eaux souterraines des éléments du projet se poursuivraient lors de la désaffectation et de la fermeture.
Le lieu de déversement des effluents, à environ 100 mètres au large dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis (figure 9), recevrait les contaminants qui devraient augmenter au-dessus des conditions de référence. Les concentrations d'arsenic devraient répondre aux normes de qualité de l'eau applicablesNote de bas de page 14 dans un rayon de deux kilomètres du lieu de déversement, le phosphore dans un rayon de 30 mètres et l'ammoniac dans un rayon de 30 mètres (tableau 5)Note de bas de page 15.
| Paramètre | Ligne directrice choisie (microgrammes par litre) | Distance du lieu de déversement des effluents où la ligne directrice est prévue être atteinte (mètres) |
|---|---|---|
| Arsenic | 5 | 2 000 |
| Phosphore total | 20 | 30 |
| Ammoniac non ionisé | 20 | 30 |
Comme mesure d'atténuation des modifications de la qualité de l'eau du bras sud-ouest du lac Kenogamisis pendant l'exploitation, l'eau de contact serait recueillie dans un bassin central M1 par un réseau de bassins de collecte plus petits (A1, A2, B1, B2, C1, D1 et D2). L'eau recueillie dans le bassin M1 serait utilisée pour satisfaire aux exigences en matière d'eau de transformation à l'usine de transformation, et seule l'eau excédentaire serait envoyée à l'usine de traitement des effluents et déversée. L'eau de contact provenant de l'installation de gestion des résidus serait également recueillie dans un ensemble distinct de bassins de collecte et retournée au bassin de récupération de l'installation de gestion des résidus pour être recyclée afin de satisfaire aux exigences en matière d'eau de transformation à l'usine de transformation. Un circuit de destruction du cyanure serait utilisé pour réduire les concentrations de cyanure dans l'usine de transformation et, par conséquent, dans les effluents miniers.
Le système de collecte des écoulements devrait capter 88 % des écoulements, les 12 % restants atteignant le bras sud-ouest du lac Kenogamisis, soit directement, soit par l'affluent du ruisseau Goldfield. Les écoulements proviendraient de l'installation de gestion des résidus, de l'installation de gestion des stériles D et des haldes de minerai. Les résidus historiques (section 2.3.1), excavés principalement pour construire la fosse à ciel ouvert et l'autoroute au tracé modifié, seraient probablement stockés dans une zone pour le stockage de stériles avec un système pour capter les écoulements pendant la construction et les deux premières années de l'exploitation, et ensuite déplacés de façon permanente dans l'installation de gestion des résidus, déposés sur une couche de résidus frais de deux mètres. Bien qu'on sache actuellement que les résidus historiques s'infiltrent présentement dans la baie Barton et le bassin central du lac Kenogamisis , le modèle des eaux souterraines supposait que tous les écoulements issus de la portion des résidus historiques placé dans l'installation de gestion des résidus seraient captés par des fossés de collecte d'eau de contact autour de l'installation de gestion des résidus, ce qui résulterait en une diminution nette des rejets des résidus historiques par infiltration dans le tout du lac Kenogamisis.
Au moment de la désaffectation et de la fermeture, les eaux de ruissellement et les écoulements issus des installations de gestion des stériles et des résidus qui seraient déversés dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis seraient réduits en dirigeant ceux issus des installations de gestion des stériles vers le bassin M1, et ceux issus de l'installation de gestion des résidus vers le bassin de récupération de cette dernière; le contenu des deux bassins serait ensuite redirigé vers la fosse à ciel ouvert. Quand la profondeur de l'eau du lac de kettle atteindrait 100 mètres, de l'eau douce du bras sud-ouest du lac Kenogamisis y serait pompée afin d'accélérer le remplissage de la fosse à ciel ouvert (section 2.3.4), tandis que les écoulements captés seraient pompés dans le fosse à ciel ouvert au-dessous de la couche d'eau douce pour créer une couche d'eau douce stratifiée sur le dessus du lac de kettle. Ce dernier serait ainsi prêt à être raccordé au bras sud-ouest du lac Kenogamisis.
Au moment de la désaffectation et de la fermeture, on prévoit que les concentrations d'arsenic, de mercure et de phosphore total dépasseront les conditions de référence dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis, mais demeureront inférieures à la norme de la qualité de l'eau applicableNote de bas de page 16. Ces augmentations seraient attribuable aux écoulements dans les eaux souterraines provenant de l'installation de gestion des résidus, des installations de gestion des stériles et du raccordement du lac de kettle au bras sud-ouest du lac Kenogamisis pendant la fermeture. Afin de vérifier les prévisions selon lesquelles la norme de la qualité de l'eau applicable14 serait respectée, un programme vaste de surveillance des eaux souterraines et une surveillance du lac de kettle pendant le remplissage et avant son raccordement au bras sud-ouest du lac Kenogamisis est proposée. Si le lac de kettle n'atteint pas la qualité d'eau souhaitée, le rejet serait traitée avec l'usine de traitement conventionnelle pour rencontrer les normes de qualité d'eau applicablesNote de bas de page 17, si un milieu humide artificiel n'est pas efficace ou ne peut pas être réalisé près de l'extrémité du canal de sortie de la fosse à ciel ouvert pour fournir un traitement supplémentaire.
L'enlèvement d'éléments d'infrastructure pendant la désaffectation ainsi que la présence des installations de gestion des stériles et de l'installation de gestion des résidus peuvent causer des rejets de matières en suspension dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis; ces rejets de matières en suspension seraient atténués par la remise en état graduelle des installations de gestion des stériles et de l'installation de gestion des résidus à l'aide d'une couverture des sols et de végétation. Des mesures de contrôle de la sédimentation, comme des clôtures anti-érosion, seraient également utilisées pour s'assurer que les sédiments ne pénètrent pas dans les plans d'eau locaux.
Opinions exprimées
La Première Nation d'Aroland, la Première Nation de Ginoogaming et la Première Nation de Long Lake no 58 ont soulevé des préoccupations au sujet des effets sur le lac A-322Note de bas de page 18 de l'empiétement et des écoulements issus de l'installation de gestion des résidus, car ce lac est un lieu de pêche de prédilection pour ces groupes. Le promoteur a déplacé l'emplacement de l'installation de gestion des résidus afin d'éviter d'empiéter sur ce lac. Bien que la modélisation des eaux souterraines n'ait pas montré de déversement d'écoulements provenant de l'installation de gestion des résidus dans le lac A-322, le promoteur s'est engagé à surveiller les eaux souterraines entre le lac A-322 et l'installation de gestion des résidus, ainsi qu'à surveiller les eaux de surface dans l'affluent du ruisseau Goldfield en aval du lac A-322.
La Première Nation de Pays Plat, la Première Nation de Constance Lake, la Première Nation d'Aroland et la Première Nation de Long Lake no 58 ont exprimé des préoccupations au sujet des effets sur la qualité des eaux de surface en aval de la zone d'évaluation locale. Pour répondre à ces préoccupations, le promoteur s'est engagé à installer d'autres stations de surveillance de la qualité de l'eau en aval du lac Kenogamisis, afin de permettre la détection de contaminants potentiels dans les eaux de surface avant qu'ils n'atteignent le lac Long.
La Nation métisse de l'Ontario s'est dite préoccupée par les modifications possibles des concentrations de mercure et d'arsenic dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis et la baie Barton, modifications qui pourraient avoir une incidence sur les poissons dans ces plans d'eau. Le promoteur et la Nation métisse de l'Ontario vont travailler ensemble pour établir un programme de surveillance afin d'atténuer ces préoccupations.
Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Nation métisse de l'Ontario, la Première Nation d'Aroland, la Première Nation de Ginoogaming, la Première Nation de Long Lake no 58, Environnement et Changement climatique Canada et Ressources naturelles Canada ont soulevé des préoccupations au sujet de la gestion des résidus historiques de MacLeod et Hardrock, qui sont perturbés dans leur emplacement original ou au moment de leur déplacement vers leurs lieux de stockage temporaires ou définitifs. Le promoteur s'est engagé à établir des fossés de collecte d'eau de contact avant l'excavation ou le déplacement des résidus historiques, dans leurs emplacements actuels, temporaires et définitifs, afin de s'assurer que les écoulements des résidus historiques ne pénètrent pas dans les plans d'eau environnants.
Environnement et Changement climatique Canada a indiqué qu'une partie des écoulements des résidus anciens transférés à l'installation de gestion des résidus pourrait s'infiltrer dans les plans d'eau environnants. Environnement et Changement climatique Canada a soulevé des préoccupations, car le traitement des terres humides proposé par le promoteur comme mesure d'urgence pour gérer les écoulements des résidus anciens déplacés a été utilisé pour d'autres projets avec un succès variable et il n'est efficace que pour certains paramètres de qualité de l'eau. Le promoteur s'est engagé à améliorer le mode de traitement des terres humides en utilisant les données de surveillance recueillies pendant l'exploitation.
Environnement et Changement climatique Canada a soulevé des préoccupations au sujet de l'intention du promoteur d'enlever les fossés de collecte de l'eau de contact après l'exploitation. Le promoteur s'est engagé à entretenir ces fossés pendant la désaffectation et l'abandon, jusqu'à ce que la qualité de l'eau respecte les normes applicables.
Environnement et Changement climatique Canada a indiqué que des études géochimiques devraient être poursuivies pour valider les prévisions de l'évaluation environnementale au sujet du lixiviat provenant des résidus. Le promoteur s'est engagé à poursuivre des analyses géochimiques et à utiliser les données obtenues pour améliorer les mesures d'atténuation.
Ressources naturelles Canada et Environnement et Changement climatique Canada ont soulevé des préoccupations au sujet de la gestion des sols contaminés autour des anciens sites des installations de Hardrock et de MacLeod-Mosher. Le promoteur s'est engagé à délimiter davantage les sols et à les gérer pour s'assurer que la qualité des eaux de surface des plans d'eau environnants ne soit pas affectée.
Pour tenir compte de toutes les incertitudes soulevées par les ministères et les groupes autochtones en ce qui a trait aux prévisions des écoulements, le promoteur s'est engagé à mettre en place un vaste programme de surveillance des eaux souterraines qui permettrait de détecter rapidement une éventuelle contamination et de l'intercepter avant qu'elle n'atteigne le lac Kenogamisis.
6.3.2 Augmentation des contaminants dans l'affluent du bras sud-ouest
Évaluation des effets environnementaux par le promoteur et mesures d'atténuation et de surveillance proposées
Les concentrations de mercure dépasseraient les conditions de référence dans l'affluent du bras sud-ouest de l'exploitation jusqu'à la fermeture, tandis que les concentrations de phosphore total les dépasseraient au cours de la fermeture. Bien que les concentrations d'arsenic diminueraient des quantités de référence, ils continueraient à dépasser les normes de qualité de l'eau applicablesNote de bas de page 19. L'augmentation des concentrations de mercure et de phosphore total serait attribuable au raccordement de l'affluent du bras sud-ouest au canal de dérivation du ruisseau Goldfield; aux écoulements continus dans les eaux souterraines issues des installations de gestion des stériles C et D; et au déversement du bassin de récupération de l'installation de gestion des résidus pendant une partie de la fermeture.
Avec l'augmentation du débit dans l'affluent du bras sud-ouest (section 6.2.1), 15 hectares seraient inondés de façon permanente autour de l'affluent du bras sud-ouest, où il pourrait y avoir méthylation du mercure. L'augmentation potentielle du méthylmercure, fondée sur l'augmentation prévue du débit annuel moyen de l'affluent du bras sud-ouest, devrait être d'environ 0,000 1 microgramme par litre, ce qui demeurerait conforme aux normes de qualité de l'eau applicablesNote de bas de page 20.
Une fois qu'il ne serait plus nécessaire de pomper l'eau du bassin de récupération de l'installation de gestion des résidus dans le fond de la fosse à ciel ouvert, elle serait déversée par le canal de dérivation du ruisseau Goldfield vers l'affluent du bras sud-ouest. Si l'eau du bassin de récupération de l'installation de gestion des résidus dépasse les critères applicables pour le cobalt et l'arsenic, la rejet serait traitée avec l'usine de traitement conventionnelle pour rencontrer les normes de qualité d'eau applicablesNote de bas de page 21, si un milieu humide artificiel n'est pas efficace ou ne peut pas être réalisé près de l'extrémité du canal de sortie de la fosse à ciel ouvert pour fournir un traitement supplémentaire.
6.3.3 Augmentation des contaminants dans le lac Mosher
Évaluation des effets environnementaux par le promoteur et mesures d'atténuation et de surveillance proposées
Les concentrations d'arsenic, de mercure et de phosphore total dépasseraient les conditions de référence dans le lac Mosher pendant l'exploitation, la désaffectation et la fermeture. L'arsenic serait le seul contaminant à dépasser les normes pour la qualité de l'eau applicablesNote de bas de page 22. Ces augmentations de contaminants seraient attribuables aux écoulements dans les eaux souterraines à partir de l'installation de gestion des stériles C.
Le drainage et le système de collecte des écoulements de la fosse à ciel ouvert capteraient la plupart des écoulements, avec une petite partie qui se rapporterait au lac Mosher. Au moment de la désaffectation et de la fermeture, le drainage de la fosse à ciel ouvert diminuerait à mesure que cette dernière se remplirait, et le taux d'écoulement de l'installation de gestion des stériles C augmenterait. Une couverture végétale du sol sur l'installation de gestion des stériles C atténuerait les modifications de la qualité de l'eau du lac Mosher en réduisant les écoulements.
6.4 Milieu terrestre
Le projet pourrait causer au milieu terrestre, y compris aux milieux humides, des effets résiduels par :
- la perte d'habitat attribuable à l'enlèvement direct de végétation (c.-à-d. au défrichage);
- des modifications de la qualité et de la fonction de l'habitat.
Dans son résumé de l'évaluation du promoteur sur les modifications du milieu terrestre, l'Agence a tenu compte des opinions exprimées par les ministères fédéraux et provinciaux ainsi que par les groupes autochtones. L'Agence s'est servie de ce résumé pour éclairer l'analyse des effets sur les poissons et leur habitat (section 7.1), les oiseaux migrateurs (section 7.2), les utilisations autochtones (section 7.3) et la santé humaine (section 7.4), de même que d'autres effets liés à des décisions fédérales (section 7.7), dont les mesures d'atténuation et de programme de suivi.
Description de l'environnement actuel
Les zones d'évaluation locale et régionale pour les communautés végétales sont présentées à la section 1.2.5. Les épinettes blanche et noire, le mélèze laricin, le sapin baumier et le pin gris sont répandus dans la zone d'évaluation régionale. On y trouve aussi beaucoup de feuillus, dont le bouleau blanc, le peuplier faux-tremble et le peuplier baumier. Des milieux humides boréaux se trouvent dans la zone de développement du projet et dans l'ensemble de la zone d'évaluation locale. Ils se composent de marécages, de marais ainsi que de tourbières minérotrophes et ombrotrophes. Plusieurs comportent également un plan d'eau libre peu profonde. La zone d'évaluation régionale, qui englobe les bassins hydrographiques de la rivière Burrows, de la rivière Kenogamisis et du lac Kenogamisis (Figure 5), contient des écosystèmes et des habitats semblables à ceux qui se trouvent dans la zone d'évaluation locale.
Les zones perturbées dans la zone de développement du projet se trouvent principalement à l'extrémité nord, y compris les zones historiques d'extraction des résidus et des agrégats, les agglomérations urbaines (les villages de MacLeod et de Hardrock) et le corridor de la route 11.
Le sol des secteurs où se trouvaient autrefois l'usine de traitement et les aires de résidus contient des concentrations de métaux, en particulier d'arsenic, qui excèdent les valeurs des normes provincialesNote de bas de page 23. Le sol contaminé peut avoir une incidence sur la qualité de l'eau (section 6.3) et des effets sur les poissons et leur habitat (section 7.1), les utilisations autochtones (section 7.3) et la santé et les conditions socioéconomiques (section 7.4).
La zone d'évaluation régionale est utilisée par les espèces sauvages pour la reproduction, la nidification, la recherche de nourriture et l'hivernage. La faune observée dans la zone d'évaluation régionale comprend divers mammifères, notamment des orignaux, des cerfs, des animaux à fourrure, des oiseaux aquatiques, des reptiles et des amphibiens, communs dans la région boréale. Les forêts des hautes terres et les milieux humides de la zone d'évaluation régionale fournissent un habitat propice aux espèces sauvages d'intérêt pour les groupes autochtones (section 7.3.1), ainsi qu'aux oiseaux migrateurs (section 7.2.3) et aux espèces en péril (section 8.1).
6.4.1 Perte d'habitat
Évaluation des effets environnementaux par le promoteur et mesures d'atténuation et de surveillance proposées
Environ 2 200 hectares d'habitats en hautes terres, en milieu humide et en eau libre seront éliminés de la zone de développement du projet afin d'y construire les éléments du projet, énumérées dans la section 2.2. Un résumé des effets de la perte d'habitat attribuable au projet par type d'habitat est fourni au tableau 6.
| Type d'habitat | Superficie de la ZDP (ha) | Superficie de la ZEL (ha)(a) | Superficie de la ZDP éliminée pendant la construction (ha) | Superficie de la ZDP réhabilitée pendant la désaffectation (ha) | Description de la communauté végétale à la suite de la désaffectation |
|---|---|---|---|---|---|
| Hautes terres - Forêts- Conifères | 869 | 823 | 1133(b) | 0 | -(c) |
| Hautes terres - Forêts - Feuillus | 209 | 565 | |||
| Hautes terres - Forêts - Mixtes | 55 | 45 | |||
| Hautes terres - Espèces de début de succession | - | - | - | 564 | Croissance prévue des espèces de peupliers et d'arbustes pendant la désaffectation |
| Hautes terres - Espèces de début de succession et roches exposées | - | - | - | 593 | Installations de gestion des stériles réhabilitées |
| Hautes terres - Prairies | 0 | 10 | 0 | 465 | Mosaïques prévues de graminoïdes (plantes ayant des caractéristiques semblables à celles de l'herbe) et roches exposées |
| Milieux humides - Tourbières ombrotrophes | 5 | 0 | 5 | 0 | -(c) |
| Milieux humides - Tourbières minérotrophes | 21 | 102 | 20 | 8 | La zone de développement du projet sera en grande partie défrichée pour le projet. Cependant, environ 8 hectares de tourbière minérotrophe devraient être conservés. |
| Milieux humides - Marais | 65 | 155 | 63 | 37 | Comprend les communautés de marais le long des ruisseaux et des rives et les marais réhabilités le long du canal de dérivation du ruisseau Goldfield. |
| Milieux humides - Marais et zones aquatiques ouvertes | - | - | 0 | 151 | Marais et plans d'eau remis en état dans le canal de dérivation du ruisseau Goldfield, la source d'agrégat S4 et l'installation de gestion des résidus. |
| Milieux humides - Marécages | 719 | 632 | 727 | 77 | La zone de développement du projet sera en grande partie défrichée pour le projet. Cependant, environ 77 hectares d'habitat marécageux devraient être conservés. |
| Eaux libres | 15 | 1265 | 15 | 131 | Comprend le lac de kettle, l'installation de gestion des résidus et les plans d'eau du canal de dérivation du ruisseau Goldfield. |
| Zones perturbées | 245 | 103 | 245 | 163 | Comprend les zones perturbées existantes, dont les bassins de collecte, l'infrastructure toujours en place durant la désaffectation (zones non réhabilitées après la cessation des activités) et les zones de roches exposées associées au barrage de l'installation de gestion des résidus. |
| Total(b) | 2200 | 3700 | 2200 | 2200 | - |
|
ZDP = zone de développement du projet; ZEL = zone d'évaluation locale; ZER = zone d'évaluation régionale; ha = hectares; % = pourcentage; – = sans objet (a) La ZEL exclut la ZDP. (b)Les totaux peuvent ne pas être exacts en raison d'erreurs d'arrondissement. (c) Les communautés végétales, les forêts des hautes terres et les tourbières ne seront pas disponibles dans la zone de développement du projet après la désaffectation. Elles seront remplacées par une combinaison d'autres types d'habitats, notamment des forêts en début de succession, des marais et des zones aquatiques ouvertes, des eaux libres et des zones perturbées. |
|||||
La perte de 37 % de l'habitat de la zone d'évaluation locale est attribuable au projet (44 % des hautes terres, 48 % des milieux humides, 70 % des zones perturbées et 1 % des eaux libres). La conception du projet comprend la conservation d'environ 162 hectares de forêts de hautes terres et 85 hectares de milieux humides comme tampon forestier pour le canal de dérivation du ruisseau Goldfield.
Bien qu'on présume qu'il est peu probable que l'habitat dans la zone de développement du projet revienne aux conditions de référence, on prévoit également que des habitats de hautes terres et de milieux humides semblables demeureront accessibles à la faune dans la zone d'évaluation locale et la zone d'évaluation régionale. Afin d'atténuer la perte de l'habitat, la revégétalisation progressive et le nivellement seront effectués conformément aux exigences provincialesNote de bas de page 24. La revégétalisation progressive se fera avec des espèces indigènes dans le but de créer des habitats de hautes terres et de milieux humides dans la zone de développement du projet, de fournir une couverture végétale et d'encourager la croissance d'espèces de début de succession. Il faudra plusieurs décennies pour que la végétation atteigne la maturité nécessaire pour constituer un habitat potentiel.
6.4.2 Modifications de la qualité et la fonction de l'habitat
Évaluation des effets environnementaux par le promoteur et mesures d'atténuation et de surveillance proposées
Les activités du projet peuvent indirectement modifier la qualité et la fonction de l'habitat en raison du défrichage, de la production de bruit et de poussière (section 6.1) et de modifications de la quantité et de la qualité de l'eau (sections 6.2 et 6.3).
Bien qu'il puisse y avoir des effets localisés sur l'habitat dans la zone de développement du projet et la zone d'évaluation locale, la qualité et la fonction de l'habitat seront conservées dans l'ensemble de la zone d'évaluation régionale. Dans la zone de développement du projet et la zone d'évaluation locale, les éléments du projet peuvent réduire la connectivité de l'habitat, et limiterait donc les déplacements des espèces sauvages. Compte tenu de la fragmentation actuelle de l'habitat dans la zone de développement du projet et l'étendue de l'habitat dans les zones d'évaluation locale et régionale, on ne prévoit pas de modifications de la connectivité de l'habitat de la zone d'évaluation régionale.
Le projet pourrait entraîner l'introduction et la propagation d'espèces envahissantes et exotiques à l'intérieur d'un rayon de 30 mètres de la zone de développement du projet. La zone de développement du projet, de même que les zones d'évaluation locale et régionale, comportent déjà des espèces envahissantes et exotiques le long du corridor de la route 11 en raison de l'activité anthropique existante. Afin de prévenir l'introduction et la propagation d'espèces envahissantes et exotiques dans l'habitat qui n'est pas actuellement touché, des matériaux de remblayage grossier seront utilisés pour le nivellement et la sélection des espèces indigènes qui serviront à la revégétalisation. Dans le cadre d'un programme de suivi, des études sur les espèces envahissantes seront menées pendant le projet jusqu'à la désaffectation, et des mesures seront prises pour éliminer les espèces envahissantes observées à l'aide de méthodes manuelles, mécaniques et, si nécessaire, chimiques.
À la suite de la mise en œuvre de mesures d'atténuation (sections 6.1.1 et 6.1.2), les effets indirects de l'exposition au bruit et à la poussière résiduel sur l'habitat se limiteraient à l'habitat adjacent à la zone de développement du projet pendant la construction, l'exploitation et la désaffectation. Les perturbations sensorielles peuvent faire en sorte que la faune évite ou sous-utilise l'habitat adjacent à la zone de développement du projet, même si ces perturbations cessaient avec la désaffectation du projet.
Bien que la fonction du milieu humide de la zone d'évaluation locale puisse se détériorer en raison de modifications de la quantité et de la qualité de l'eau (sections 6.2 et 6.3), la fonction et la qualité du milieu humide de la zone d'évaluation régionale seraient maintenues. Les mesures d'atténuation proposées pour réduire au minimum l'effet du projet sur la qualité et la fonction des milieux humides comprennent des dispositifs de lutte à la sédimentation et à l'érosion, ainsi que le rétablissement des régimes d'écoulement des eaux là où c'est possible.
Opinions exprimées
Les Premières Nations d'Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, d'Aroland et de Ginoogaming ont exprimé des préoccupations au sujet de l'introduction ou de la propagation possible d'espèces terrestres envahissantes attribuables aux activités du projet, et ont recommandé la mise en œuvre du protocole provincialNote de bas de page 25. Le promoteur dit s'engager à assurer le nettoyage de l'équipement usagé avant d'entrer dans la zone de développement du projet, même si le protocole provincial ne s'applique pas aux mines.
La Nation métisse de l'Ontario s'est dite préoccupée par l'éventuelle perte de connectivité de l'habitat des espèces sauvages et les effets indirects du projet sur la qualité et la fonction de l'habitat. Le promoteur a indiqué qu'il a tenu compte des modifications de connectivité et des effets indirects dans son évaluation des effets environnementaux sur le milieu terrestre et les espèces qui s'y trouvent, et il prévoit que les effets négatifs seront minimes.
7. Effets prévus sur les composantes valorisées
7.1 Poissons et habitat du poisson
Le projet pourrait causer aux poissons et à leur habitat des effets résiduels par :
- la mortalité et effets sur la santé des poissons;
- la perte ou détérioration de l'habitat des poissons.
L'Agence est d'avis que le projet n'est pas susceptible de causer des effets négatifs importants sur les poissons et leur habitat, compte tenu de la mise en œuvre des principales mesures d'atténuation proposées (encadré 7.1-1). L'Agence recommande des mesures de programme de suivi (encadré 7.1-2) pour vérifier l'exactitude des prévisions relatives aux poissons et à leur habitat, et déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation proposées visant à réduire au minimum les effets sur les poissons et leur habitat.
Les conclusions de l'Agence sont fondées sur son analyse des évaluations du promoteur ainsi que sur les points de vue exprimés par Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada, Santé Canada, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario, le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario, et les groupes autochtones.
Description de l'environnement actuel
Les espèces de poissons du lac Kenogamisis comprennent le doré jaune, le grand corégone, le grand brochet, la perchaude et une variété de poissons de petite taille. Le bras sud-ouest du lac Kenogamisis présente la plus grande diversité d'espèces de poissons, et d'autres cours d'eau, y compris l'affluent du bras sud-ouest et le ruisseau Goldfield, offrent un habitat de frai et d'élevage potentiel pour les espèces du bras sud-ouest du lac Kenogamisis (figure 9). Les cours d'eau près des résidus historiques ont été dégradés et fournissent un habitat marginal aux poissons. Les cours d'eau éphémères, comme les cours d'eau WC-G et WC-I, offrent un habitat potentiel aux poissons pendant les périodes humides, mais ces cours d'eau ont une faible diversité d'espèces et une faible abondance de poissons. Aucune espèce de poisson en péril n'a été documentée et on ne prévoit pas en trouver dans la zone d'évaluation locale. Le lac Mosher offre un habitat convenable pour la perchaude, le grand brochet et une variété de poissons de petite taille. Les communautés d'invertébrés benthiques du lac Mosher sont affaiblies en raison de sa proximité avec l'ancienne zone d'exploitation minière.
Les concentrations de métaux ont été mesurées dans les tissus musculaires des poissons de grande et de petite tailles. Les dorés jaunes sont souvent ciblés pour la consommation par les peuples autochtones. Les concentrations d'arsenic et de mercure dans le doré jaune du lac Kenogamisis dépassent les conditions de référence dans le lac Wildgoose et le lac Goldfield, mais les concentrations observées n'ont pas eu d'effet biologique nocif sur les poissons.
7.1.1 Mortalité et effets sur la santé des poissons
Évaluation, atténuation et surveillance des effets environnementaux par le promoteur
Les effets sur les populations de poissons de la mortalité des poissons due à la construction des éléments du projet dans les plans d'eau ou à proximité de ces derniers, et à l'exploitation de la prise d'eau et des activités de dynamitage associées au projet, devraient être négligeables. Des effets négligeables sur la santé des poissons devraient se produire en raison de modifications de la qualité de l'eau à la suite du déversement d'effluents pendant l'exploitation, et des écoulements issus de l'installation de gestion des résidus et des installations de gestion des stériles, de l'exploitation à la fermeture (section 6.3).
En ce qui a trait au ruisseau Goldfield, et aux autres cours d'eau et étangs poissonneux dans la zone de développement du projet qui seraient éliminés pour la construction d'éléments du projet, des mesures seraient mises en œuvre pour récupérer et déplacer les poissons vers un lieu approprié, avant la construction des éléments du projet et conformément aux mesures de déplacement qui seront élaborées en vertu de la Loi sur les pêches. Comme il est décrit à la section 6.3.1, des mesures de contrôle de l'érosion et de la sédimentation, comme la réhabilitation progressive des installations de gestion des stériles, seront prises pour contrôler le rejet de sédiments. Des filtres d'admission seraient installés aux structures de prise d'eau dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis afin d'atténuer l'entraînement et l'impaction des poissons et de réduire leur mortalité. Le dynamitage dans le prolongement est de la fosse à ciel ouvert serait contrôlé afin de réduire la mortalité ou les blessures chez les poissons dans le bassin central du lac Kenogamisis, tels que stipulés à la section 6.1.3.
Des mesures seront également prises pour atténuer les modifications de la qualité de l'eau, comme stipulé à la section 6.3, y compris la collecte des écoulements autour de l'installation de gestion des résidus, des installations de gestion des stériles et des haldes de minerai, et le traitement des effluents avant leur déversement dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis. La collecte des écoulements serait également mise en œuvre pour s'assurer que les eaux de contact des résidus historiques de MacLeod et de Hardrock n'auraient pas d'impact sur les plans d'eau environnants tout au long du projet, pendant qu'ils sont excavés à partir de leur emplacement actuel, entreposés temporairement dans la zone pour le stockage de stériles puis déplacés de façon permanente dans l'installation de gestion des résidus. La surveillance inclurait des paramètres clés de qualité de l'eau, ainsi que des relevés de la population et de la santé des poissons effectués dans le lac Kenogamisis, le lac Mosher et l'affluent du bras sud-ouest pour vérifier que les poissons ne sont pas affectés négativement. Au cours de la fermeture, la qualité de l'eau du lac de kettle serait surveillée afin de s'assurer qu'elle est appropriéeNote de bas de page 26 pour le déversement dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis. Si ce n'est pas le cas, des mesures (stipulées à la section 6.3.1) comme la création d'un milieu humide artificiel près de l'extrémité du canal de sortie de la fosse à ciel ouvert seraient mises en œuvre avant le déversement dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis.
Opinions exprimées
La Première Nation d'Aroland, la Première Nation de Ginoogaming, la Première Nation de Long Lake no 58 et la Nation métisse de l'Ontario ont exprimé des préoccupations au sujet des effets néfastes sur les poissons en raison de l'augmentation des contaminants dans les eaux souterraines et de surface du lac Kenogamisis, ainsi que dans les lacs et cours d'eau connexes, et ont demandé que corps entier du poisson soit échantillonné. Le promoteur s'est engagé à surveiller la présence de contaminants dans les tissus du corps entier des poissons, notamment le méthylmercure, le mercure et l'arsenic provenant des plans d'eau, comme le canal de dérivation du ruisseau Goldfield et le lac Kenogamisis. Le promoteur s'est également engagé à offrir aux groupes autochtones la possibilité de participer à la surveillance des eaux de surface.
Analyse et conclusion de l'Agence
L'Agence est d'avis qu'après avoir pris en compte la mise en œuvre des principales mesures d'atténuation décrites à l'encadré 7.1-1, le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets importants sur la mortalité et la santé des poissons.
L'Agence fait remarquer que tandis l'enlèvement des plans d'eau et des cours d'eau, l'impaction et l'entraînement accidentels des poissons dans la structure de prise d'eau et les activités de dynamitage pourraient entraîner la mortalité des poissons dans la zone de développement du projet, ces effets ne changeraient pas les effectifs globaux des poissons dans la zone d'évaluation locale. Le promoteur déplacerait les poissons des plans d'eau touchés par les éléments du projet et des zones où des travaux en milieu aquatique seraient effectués afin de minimiser les dommages graves aux poissons. Pour éviter les dommages causés par la vibration, le promoteur suivrait les lignes directrices fédéralesNote de bas de page 27.
Bien que la santé des poissons puisse être affectée par des modifications de la qualité de l'eau, ces effets ne changeraient pas les effectifs globaux des poissons dans la zone d'évaluation locale. Le promoteur atténuerait les effets sur les poissons du bras sud-ouest du lac Kenogamisis, du lac Mosher et de l'affluent du bras sud-ouest en gérant la qualité de l'eau comme stipulé à la section 6.3 du présent rapport. Comme stipulé à la section 6.3.1, les concentrations d'arsenic et de phosphore dans la zone située près du lieu de déversement des effluents dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis devraient être plus élevées que les recommandations pour la qualité de l'eau applicablesNote de bas de page 28 pendant l'exploitation et pourraient être chroniquement toxiques pour les organismes aquatiques. Les concentrations d'arsenic devraient également dépasser les valeurs recommandées pour la qualité de l'eau dans l'affluent du bras sud-ouest (section 6.3.2) et du lac Mosher (section 6.3.3) en raison des écoulements pendant l'exploitation et la fermeture. Une fois le déversement des effluents dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis terminé, les exigences réglementaires fédéralesNote de bas de page 29 et provincialesNote de bas de page 30 continueraient de s'appliquer pendant la désaffectation et la fermeture. De plus, des mesures seraient mises en œuvre pour gérer les résidus historiques de MacLeod et Hardrock pendant qu'ils sont entreposés temporairement dans la zone pour le stockage de stériles et déplacés de façon permanente dans l'installation de gestion des résidus, afin de s'assurer que l'effluent n'augmenterait pas les concentrations de contaminants dans les plans d'eau environnants. Des mesures d'atténuation seraient aussi entreprises pour gérer sols contaminés autour des anciens sites des installations de Hardrock et de MacLeod-Mosher, et des résidus historiques non excavés (section 6.3.1). Des mesures de surveillance, tel que stipulé à l'encadré 7.1-2, sont recommandées pour vérifier les prévisions du promoteur selon lesquelles la qualité de l'eau dans la zone d'évaluation locale demeurerait suffisante pour protéger la santé des poissons, pour évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation de la mortalité et des effets sur la santé des poissons, ainsi que pour déterminer la nécessité de mettre en œuvre des mesures d'urgence pour s'assurer que les poissons ne sont pas touchés.
Compte tenu des mesures d'atténuation proposées et des définitions des critères d'évaluation des effets environnementaux à l'annexe A, l'Agence est d'avis que l'ampleur des effets du projet sur la mortalité et la santé des poissons serait faible puisque les effets sur les poissons individuels ne devraient pas affecter l'état régional des populations de poissons et la santé de ces derniers. L'étendue géographique serait modérée et s'étendrait jusqu'à la zone d'évaluation locale. Les effets seraient de longue durée, jusqu'à la fermeture. Les effets se produiraient de façon intermittente et seraient réversibles lorsque les activités du projet cesseraient. Le calendrier des activités du projet serait jugé modéré, car il pourrait avoir une incidence sur certaines activités sensibles du cycle de vie des poissons, comme le frai.
7.1.2 Perte ou détérioration de l'habitat des poissons
Évaluation, atténuation et surveillance des effets environnementaux par le promoteur
Les effets sur l'habitat des poissons découleraient de la perte et de la détérioration de l'habitat en raison de la construction des éléments du projet et de la détérioration de l'habitat en raison du déversement d'effluents traités dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis. Le tableau 7 résume les pertes d'habitat prévues en raison de l'empiétement ou des modifications du niveau et du débit d'eau dans la zone d'évaluation locale. L'habitat des poissons éliminé par ces activités serait contrebalancé par la mise en œuvre d'un plan de compensation de l'habitat des poissons, comme l'exige la Loi sur les pêches.
Le déversement d'effluents dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis pendant l'exploitation pourrait entraîner une détérioration de l'habitat des poissons en raison de l'eutrophisation; toutefois, ces effets seraient largement atténués par le traitement des effluents avant leur déversement. Pour vérifier les prévisions, la surveillance de l'habitat des poissons en raison des modifications de la qualité de l'eau inclurait des relevés des concentrations d'éléments nutritifs, de l'abondance des algues, des concentrations d'oxygène dissous ainsi que de la population et de la santé des poissons. La surveillance serait effectuée dans le lac Kenogamisis, le lac Mosher et l'affluent du bras sud-ouest pour vérifier que l'habitat des poissons n'est pas touché négativement.
| Plan d'eau/cours d'eau | Description de l'impact sur l'habitat des poissons | Superficie (hectare) |
|---|---|---|
| Étangs 2 et 3 du terrain de golf | Perte permanente de l'habitat des poissons en raison de l'empiétement par les éléments du projet | 3,57 |
| Ruisseau Goldfield | Perte permanente de l'habitat des poissons en raison du canal de dérivation et détérioration permanente de l'habitat des poissons en raison de la réduction du débit | 2,82 |
| Cours d'eau WC-D | Perte permanente de l'habitat des poissons en raison de la fosse à ciel ouvert et de la modification du tracé de l'autoroute, en plus d'une détérioration permanente de l'habitat des poissons en raison de la réduction du débit | 0,21 |
| Cours d'eau WC-C, WC-G et WC-O | Perte permanente de l'habitat des poissons en raison de l'empiétement par les éléments du projet, en plus d'une détérioration permanente de l'habitat des poissons en raison de la réduction du débit | 0,25 |
| Cours d'eau WC-F, WC-I, WC-M et WC-Z | Détérioration permanente de l'habitat des poissons en raison de la réduction du débit | 0,31 |
| Total | 7,16 | |
Opinions exprimées
La Première Nation de Biigtigong Nishnaabeg, la Première Nation d'Aroland et la Première Nation de Ginoogaming ont demandé des précisions sur les pertes d'habitat associées à la réduction du débit. Le promoteur a répondu que des modèles de débit ont été utilisés pour les cours d'eau permanents plus importants, comme l'affluent du bras sud-ouest et le ruisseau Goldfield. Comme les modèles de débit ne s'appliquaient pas aux cours d'eau plus petits ou éphémères, les pertes ont été calculées au cas par cas à l'aide d'approches prudentes.
Analyse et conclusion de l'Agence
L'Agence est d'avis qu'après avoir pris en compte la mise en œuvre des principales mesures d'atténuation décrites à l'encadré 7.1-1, le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets importants sur l'habitat des poissons. L'Agence fait remarquer que le projet pourrait avoir des effets négatifs sur l'habitat des poissons en raison de la construction des éléments du projet et des modifications de la qualité de l'eau dans la zone d'évaluation locale. Le promoteur s'est engagé à mettre en œuvre un plan compensatoire pour l'habitat des poissons afin de respecter les exigences réglementaires fédéralesNote de bas de page 31. De plus, l'Agence recommande que le programme de suivi évalue l'efficacité des mesures de compensation de l'habitat des poissons.
L'Agence comprend que pendant les effluents traités de la mine et des eaux usées sont déversés dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis pendant l'exploitation (section 6.3.1), le phosphore et l'ammoniac non ionisé devraient augmenter au-dessus des quantités de référence dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis. Ces augmentations de phosphore et l'ammoniac non ionisé pourraient causer l'eutrophisation et nuire à l'habitat des poissons en affectant les concentrations d'éléments nutritifs pour les organismes aquatiques, l'abondance des algues et les concentrations d'oxygène dissous. Toutefois, dans le pire scénario (déversement maximal d'effluents dans des conditions de faible débit), la norme de qualité de l'eau applicableNote de bas de page 32 serait respectée dans une zone de mélange raisonnable du lieu de déversement des effluents (section 6.3.1). L'Agence est d'avis que la détérioration de l'habitat des poissons serait localisée à une courte distance du lieu de déversement des effluents.
Compte tenu des mesures d'atténuation proposées et des définitions des critères d'évaluation des effets environnementaux à l'annexe A, l'Agence est d'avis que l'ampleur des effets du projet sur l'habitat des poissons serait faible, puisque 7,16 hectares d'habitat des poissons seraient perdus au total en raison du projet, perte qui serait contrebalancée par le plan de compensation de l'habitat des poissons. L'étendue géographique serait modérée, puisque les effets seraient limités à la zone d'évaluation locale. Les effets seraient à moyenne durée, car les habitats créés dans le cadre du plan de compensation de l'habitat des poissons seraient établis avant la perte d'habitat, mais nécessiteraient du temps à l'exploitation afin qu'ils soient pleinement établis et fonctionnels. Les effets seraient continus et réversibles, puisque les gains d'habitat prévus grâce aux habitats créés en vertu du plan de compensation, conformément à la Loi sur les pêches, contrebalanceraient les pertes d'habitat à long terme. Le calendrier des activités du projet serait jugé modéré, car il pourrait avoir une incidence sur certaines activités sensibles du cycle de vie des poissons, comme le frai.
Encadré 7.1-1. Principales mesures d'atténuation des effets sur les poissons et leur habitat
Mesures d'atténuation de la mortalité et des effets sur la santé des poissons
- Récupérer et déplacer les poissons avant que des travaux ne soient effectués dans l'eau ou près de celle-ci pendant la construction et l'exploitation au moyen d'un plan de récupération et de déplacement des poissons mené conformément aux exigences de la Loi sur les pêches afin d'éviter des dommages graves aux poissons. Avant de commencer les activités de récupération et de déplacement du poisson, consulter avec chaque groupe autochtone à propos des opportunités pour leur participation.
- Mettre en œuvre des mesures pendant les activités de dynamitage pour protéger les poissons (et leur habitat, y compris les frayères), tel que déterminé par les données tirées de la surveillance des dynamitages, en tenant compte des Lignes directrices concernant l'utilisation d'explosifs à l'intérieur ou à proximité des eaux de pêches canadiennes de Pêches et Océans Canada relativement à l'utilisation d'explosifs.
- Installer des grillages sur les structures de prise d'eau dans le lac Kenogamisis, conformément aux Directives concernant les grillages à poissons installés à l'entrée des prises d'eau douce de Pêches et Océans Canada, ainsi qu'aux exigences de la Loi sur les pêches pour éviter des dommages graves aux poissons.
- Gérer la qualité de l'eau dans les effluents miniers afin de respecter le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants et les exigences de la Loi sur les pêches dans le bras sud-ouest, bassin central et baie Barton du lac Kenogamisis, le lac Mosher, le lac A-322, l'affluent du bras sud-ouest, et l'affluent du ruisseau Goldfield, tout en tenant compte des Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'Environnement. Cela comprend notamment :
- Intercepter et recueillir l'eau de contact à partir des installations de gestion des stériles incluant tout endroit temporaire pour l'entreposage des résidus historiques excavés, du dépôt des morts-terrains et des haldes de minerai à l'aide des fossés de collecte des eaux de contact aux fins de réutilisation dans le cadre des activités du projet;
- Intercepter et recueillir l'eau de contact de l'installation de gestion des résidus incluant l'endroit permanente pour l'entreposage des résidus historiques excavés, dans les bassins de collecte;
- Traiter l'excès d'eau au besoin avant de déverser dans le lac Kenogamisis;
- Installer et exploiter, pendant l'exploitation, un circuit de destruction du cyanure afin de réduire les concentrations de cyanure dans les effluents miniers;
- Maintenir les fossés de collecte d'eau de contact autour des installations de gestion des stériles, du dépôt des morts-terrains, des haldes de minerai et de l'installation de gestion des résidus pendant la désaffectation et l'abandon jusqu'à ce que la qualité de l'eau respecte les exigences de la Loi sur les pêches. L'eau de contact qui n'est pas traité pendant la désaffectation et l'abandon peut être dirigé à la fosse à ciel ouvert;
- Au besoin, avant que le lac de kettle déverse dans le lac Kenogamisis, traiter cette eau jusqu'à ce que les résultats de la surveillance indiquent que la qualité de l'eau est conforme aux Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique, comme prévu dans l'étude d'impact environnemental.
- Gérer les sols contaminés autour des anciens sites des installations de Hardrock et de MacLeod-Mosher, et les résidus historiques non excavés de façon à protéger la qualité de l'eau dans le bras sud-ouest, bassin central et baie Barton du lac Kenogamisis, le lac Mosher, le lac A-322, l'affluent du bras sud-ouest, et l'affluent du ruisseau Goldfield. Réhabiliter les portions exposées des résidus historiques non excavés, et compléter la réhabilitation aussitôt que techniquement possible après l'excavation des résidus.
Mesures d'atténuation de la perte ou de la détérioration de l'habitat des poissons
- Mettre en œuvre un plan compensatoire pour tous les dommages graves qu'occasionnera le projet sur les poissons, conformément à la Loi sur les pêches, de même qu'un plan compensatoire de l'habitat des poissons pour toute perte d'habitat des poissons liée à l'élimination de l'eau de contact dans le cadre du projet, conformément à l'article 27.1 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants. Ces plans seraient élaborés avec Pêches et Océans Canada et Environnement et Changement climatique Canada, en collaboration avec les groupes autochtones.
- Mettre en œuvre des mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments pendant la construction, l'exploitation et la désaffectation, notamment l'utilisation d'eau pour le dépoussiérage, la remise en état progressive des éléments du projet et l'utilisation de fossés et des talus de dérivation pour prévenir l'érosion et assurer la stabilité des berges et des clôtures anti-érosion, conformément aux exigences de la Loi sur les pêches.
Encadré 7.1-2. Programme de suivi recommandé pour les poissons et leur habitat
Mesures du programme de suivi des poissons et de leur habitat
- Élaborer et mettre en œuvre, en consultation avec Pêches et Océans Canada, un programme de suivi pour vérifier l'efficacité des plans de dynamitage proposés pendant la construction et l'exploitation afin d'évaluer l'efficacité à éviter les dommages graves aux poissons, conformément à la Loi sur les pêches. Le programme de surveillance, élaboré en consultation avec Pêches et Océans Canada, devrait comprendre des exigences visant à ajuster les activités de dynamitage en fonction des données de surveillance du dynamitage propres au site.
- Mettre en œuvre, pendant la construction et l'exploitation, des mesures de surveillance quantitative de la création d'habitat des poissons décrites dans le plan de compensation en vertu de la Loi sur les pêches, et en consultation avec les groupes autochtones et Pêches et Océans Canada, afin d'évaluer si les habitats créés fonctionnent comme prévu. Dans l'éventualité où les mesures décrites dans le plan seraient inefficaces, le promoteur prendrait les mesures d'urgence que requiert la Loi sur les pêches.
- Procéder à des relevés de la population et de la santé des poissons, pendant l'exploitation, afin de respecter la Loi sur les pêches et le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants, notamment le suivi des effets sur l'environnement, afin de vérifier que les modifications de la qualité de l'eau, des quantités d'éléments nutritifs, de l'abondance d'algues et des concentrations d'oxygène dissous dans le lac Kenogamisis, le lac Mosher et l'affluent du bras sud-ouest n'entraînent pas d'effets négatifs sur les poissons et leur habitat. Ces résultats de surveillance détermineraient s'il est nécessaire d'appliquer des mesures d'atténuation supplémentaires. Au cas où des mesures d'appoint seraient mises en œuvre, surveiller également l'efficacité de ces mesures.
- Élaborer et mettre en œuvre, pendant l'exploitation, et en consultation avec les groupes autochtones et Environnement et Changement climatique Canada, des programmes de suivi pour vérifier les prévisions de l'évaluation environnementale relativement à la santé des poissons. Les mesures devraient comprendre, au minimum, pendant l'exploitation et la désaffectation :
- Surveiller l'arsenic, le phosphore et l'ammoniac non ionisé dans les eaux de surface du bras sud-ouest du lac Kenogamisis afin de vérifier la prévision de l'évaluation environnementale figurant au tableau 5 sont respectées;
- Surveiller la concentration d'arsenic dans les eaux de surface de l'affluent du bras sud-ouest et du lac Mosher afin de vérifier la prévision de l'évaluation environnementale selon laquelle les concentrations ne dépasseraient pas 100 microgrammes par litre;
- Ces résultats de surveillance indiqueraient s'il est nécessaire d'appliquer des mesures d'atténuation supplémentaires. Au cas où des mesures d'appoint seraient mises en œuvre, surveiller également l'efficacité de ces mesures.
- Développer, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités pertinentes, et mettre en œuvre, pendant la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture, un programme de surveillance des écoulements et de la qualité de l'eau en amont, en aval et en pente transversale de l'installation de gestion des résidus, des installations de gestion des stériles, du dépôt des morts-terrains, des haldes de minerai et des résidus historiques de MacLeod et de Hardrock, afin d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation. Le programme comprendrait une surveillance du débit, du niveau et de la qualité des eaux souterraines afin de comprendre l'incidence des écoulements sur la qualité de l'eau et de vérifier que les concentrations dans les eaux souterraines prévues pour les paramètres stipulés dans le tableau 9-20 du chapitre 9 de l'étude d'impact environnemental ne sont pas dépassées, dans le but d'éviter la dégradation de la qualité des eaux de surface du bras sud-ouest, bassin central et baie Barton du lac Kenogamisis, du lac Mosher, du lac A-322, du canal de dérivation du ruisseau Goldfield, de l'affluent du bras sud-ouest, et de l'affluent du ruisseau Goldfield. Dans l'éventualité où les données de surveillance montrent la dégradation des eaux souterraines, élaborer des mesures d'urgence et surveiller leur efficacité.
- Surveiller, pendant la désaffectation et la fermeture, la qualité de l'eau du lac de kettle pendant le remplissage afin de s'assurer que la qualité de l'eau du débordement imminent de la fosse à ciel ouvert, avant son raccordement au bras sud-ouest du lac Kenogamisis, ne dépasse pas les valeurs des Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique. Lorsque les résultats de la surveillance justifient la mise en œuvre de mesures d'urgence, l'efficacité de ces dernières devrait également être surveillée.
7.2 Oiseaux migrateurs
Le projet pourrait causer aux oiseaux migrateurs des effets résiduels par :
- l'exposition aux contaminants dans les éléments du projet comportant des eaux libres;
- le risque accru de collision avec des véhicules;
- la perte d'habitat.
L'Agence est d'avis que le projet n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs importants sur les oiseaux migrateurs, compte tenu des principales mesures d'atténuation proposées (encadré 7.2-1). L'Agence recommande des mesures de programme de suivi (encadré 7.2-2) pour vérifier l'exactitude des prévisions relatives aux oiseaux migrateurs et déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation proposées visant à réduire au minimum les effets négatifs envers les oiseaux migrateurs attribuables aux activités du projet. L'Agence a tenu compte de ces effets résiduels dans l'analyse des utilisations autochtones (section 7.3), y compris les mesures d'atténuation et de programme de suivi.
Les conclusions de l'Agence sont fondées sur son analyse des évaluations du promoteur ainsi que sur les opinions exprimées par Environnement et Changement climatique Canada, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario et les groupes autochtones.
Description de l'environnement actuel
Dans la zone d'évaluation régionale (figure 5), 109 espèces d'oiseaux migrateurs protégées en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs ont été observées, dont 7 sont inscrites comme étant menacées ou préoccupantes à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (2002). Il s'agit notamment de l'hirondelle du rivage (Riparia riparia), de l'hirondelle rustique (Hirundo rustica), de la paruline du Canada (Cardellina canadensis), de l'engoulevent d'Amérique (Chordeiles minor), de l'engoulevent bois-pourri (Antrostomus vociferous), du pioui de l'Est (Contopus virens) et du moucherolle à côtés olive (Contopus cooperi).
L'habitat des oiseaux migrateurs comprend les forêts de hautes terres matures et en début de succession (p. ex. l'habitat de la paruline du Canada), les prairies (p. ex. l'habitat de l'engoulevent d'Amérique), les milieux humides (p. ex. les milieux humides non boisés qui servent d'habitat à certains oiseaux), les eaux libres (p. ex. l'habitat des oiseaux aquatiques) et les zones perturbées (p. ex. l'habitat de l'hirondelle rustique).
7.2.1 Exposition à des contaminants dans les éléments du projet comportant des eaux libres
Évaluation des effets environnementaux par le promoteur et mesures d'atténuation et de surveillance
Les éléments du projet comportant des eaux libres, y compris l'installation de traitement des résidus, les installations de gestion de l'eau (section 2.2) et le lac de kettle, pour lesquels on prévoit des niveaux élevés de contaminants, pourraient avoir des effets néfastes sur les oiseaux migrateurs. Bien qu'il y ait une possibilité que des oiseaux aquatiques se posent sur ces plans d'eau libre, on n'anticipe pas d'effets nuisibles durant la construction et l'exploitation, puisque ceux-ci ne seraient pas viables aux invertébrés benthiques, aux plantes aquatiques et aux poissons dont ces oiseaux se nourrissent. La réhabilitation de ces éléments en tant qu'ensembles de plans d'eau, de milieux humides et de prairies à la fermeture du site garantirait que la qualité de l'eau répond aux exigences provincialesNote de bas de page 33 afin qu'elles puissent être reliées au milieu récepteur (section 6.3), et n'aurait pas d'effet néfaste sur la santé des oiseaux migrateurs.
Un programme de surveillance de la faune pour l'installation de gestion des résidus et les systèmes de gestion de l'eau serait mis en application pendant toutes les phases du projet, jusqu'à ce que la qualité de l'eau réponde aux exigences provinciales. Des moyens de dissuasion auditifs et visuels, notamment des klaxons pneumatiques, des pétards, des poteaux de leurre et des réflecteurs, seraient utilisés pour faire fuir les oiseaux au besoin.
Le lac de kettle serait rempli d'eau pendant la fermeture et la désaffectation du projet, et fournirait un habitat aux oiseaux migrateurs. Dans le cas où l'eau résiduaire du lac de kettle ne répondrait pas aux exigences provinciales, des mesures d'urgence seraient prises. Par conséquent, on ne prévoit pas d'effets négatifs sur les oiseaux migrateurs qui accèdent au lac.
Opinions exprimées
La Première Nation d'Aroland, Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Environnement et Changement climatique Canada et le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario ont demandé des renseignements supplémentaires sur les effets potentiels associés à l'utilisation de l'installation de gestion des résidus par les oiseaux aquatiques et migrateurs. Le promoteur a déclaré qu'une évaluation de l'effet de l'installation de gestion des résidus sur les oiseaux migrateurs n'était pas nécessaire, étant donné qu'un programme de surveillance des espèces sauvages et des mesures d'atténuation, y compris le défrichage, l'installation de clôtures et des mesures de dissuasion sensorielles, limiteraient l'exposition des oiseaux migrateurs aux eaux de surface.
Environnement et Changement Climatique Canada a soulevé des préoccupations à propos de l'utilisation de l'installation de gestion des résidus par les oiseaux migrateurs. Le promoteur s'est engagé à mettre en place des mesures d'atténuation, incluant la gestion de la végétation environnante, afin de décourager les oiseaux migrateurs d'utiliser les eaux ouvertes présentes dans l'installation de gestion des résidus par, et des mesures de surveillance pour en vérifier l'utilisation. S'il est découvert que des oiseaux migrateurs utilisent les eaux ouvertes, des mesures additionnelles dissuasives sont proposées.
Analyse et conclusion de l'Agence
L'Agence est d'avis qu'après avoir pris en compte la mise en œuvre des principales mesures d'atténuation décrites à l'encadré 7.2-1, le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets importants sur les oiseaux migrateurs, attribuable à une exposition aux contaminants présents dans les eaux libres de la zone de développement du projet. L'Agence fait remarquer que la construction de l'installation de gestion des résidus, des installations de gestion de l'eau et du lac de kettle pourrait entraîner des effets négatifs chez les oiseaux migrateurs qui utilisent ces plans d'eau, en raison des effets non létaux qui peuvent résulter d'une exposition chronique aux niveaux prévus de contaminants. Toutefois, la mise en œuvre d'un programme de surveillance des espèces sauvages et de mesures dissuasives réduirait les effets des niveaux élevés de contaminants sur les oiseaux migrateurs.
Compte tenu des mesures d'atténuation proposées et des définitions des critères d'évaluation des effets environnementaux à l'annexe A, l'Agence est d'avis que l'effet sera de faible ampleur compte tenu de la probabilité minime de dommages ou de mortalité chez les oiseaux migrateurs. L'étendue géographique serait faible, car elle est associée aux éléments du projet comportant des eaux libres se trouvant dans la zone de développement du projet. L'effet serait de longue durée et perdurerait tout au long du projet. L'effet serait considéré comme réversible, puisqu'après la remise en état de l'installation de gestion des résidus miniers et de la qualité de son eau, le système de gestion de l'eau et le lac de kettle respecteraient les exigences provinciales.
7.2.2 Risque accru de collision avec des véhicules
Évaluation des effets environnementaux par le promoteur et mesures d'atténuation et de surveillance
Le projet ferait augmenter la circulation pendant les phases de construction et d'exploitation. Par conséquent, les collisions de véhicules avec des animaux sauvages, y compris les oiseaux migrateurs, peuvent augmenter. Afin de réduire au minimum les collisions, des limites de vitesse seraient appliquées sur les routes du site dans la zone d'étude du projet (encadré 7.2-1). De plus, les collisions et les accidents évités de justesse impliquant des animaux sauvages seraient surveillés. Le cas échéant, des mesures d'atténuation supplémentaires, comme l'affichage de panneaux d'avertissement pour les conducteurs ou le déboisement en bordure de route près des sections à risque élevé de collision, seraient mises en œuvre dans la zone d'étude du projet.
Opinions exprimées
Environnement et Changement climatique Canada a soulevé des préoccupations au sujet des effets négatifs potentiels des collisions avec les véhicules sur les oiseaux migrateurs, y compris l'engoulevent d'Amérique, une espèce en péril qui se repose souvent sur les routes en gravier et qui est vulnérable aux collisions. Le Ministère a fait des recommandations pour l'élaboration d'un programme de suivi propre aux oiseaux migrateurs visant à surveiller les collisions avec les véhicules, qui comprendrait des mesures d'atténuation pour éviter que des oiseaux soient tués.
Analyse et conclusion de l'Agence
L'Agence est d'avis qu'après avoir pris en compte la mise en œuvre des principales mesures d'atténuation décrites à l'encadré 7.2-1, le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets importants sur les oiseaux migrateurs en raison de la circulation accrue des véhicules dans la zone d'étude du projet, compte tenu de la mise en œuvre des principales mesures d'atténuation décrites dans l'encadré 7.2-1. L'Agence fait remarquer que l'augmentation de la circulation peut avoir des effets négatifs sur les oiseaux migrateurs et propose que l'établissement d'une limite de vitesse soit une mesure d'atténuation clé pour réduire le risque d'accident. La mise en œuvre d'un programme de suivi pour surveiller les collisions, ainsi que le recours éventuel à des panneaux de signalisation et au déboisement, au besoin, pourrait réduire davantage les collisions avec des véhicules dans la zone d'étude du projet.
Compte tenu des mesures d'atténuation proposées et des définitions des critères d'évaluation des effets sur l'environnement figurant à l'annexe A, l'Agence est d'avis que l'ampleur des effets sur les oiseaux migrateurs serait faible étant donné le degré minimal de risque de mortalité ou de blessure. L'étendue géographique serait faible, car elle est associée aux routes dans la zone d'étude du projet. L'effet serait à moyen terme et durerait tout au long des phases de construction, d'exploitation et de désaffectation, pendant que la circulation liée au projet persiste et est continue. L'effet serait considéré comme réversible, puisqu'il prendrait fin lorsque la circulation automobile sur les routes sur le site cesserait.
7.2.3 Perte d'habitat
Évaluation des effets environnementaux par le promoteur et mesures d'atténuation et de surveillance
Les pertes d'habitat directes et indirectesNote de bas de page 34, qui peuvent avoir une incidence sur les oiseaux migrateurs, leurs nids et leurs œufs, sont présentées au tableau 8.Comme il est décrit au tableau 6, la construction du projet entraînerait l'élimination de 2200 hectares d'habitats en hautes terres, en milieu humide et en eau libre dans la zone de développement du projet. De plus, la production de bruit et de poussière pourrait modifier de façon indirecte la qualité et la fonction de l'habitat.
| Habitat des oiseaux migrateurs | Habitat propice | Construction et exploitation | Fermeture | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perte directe maximale (ha) | Perte indirecte maximale (ha)a | Pourcentage de l'habitat perdu dans la ZER (%) avant la réhabilitation | Habitat qui a subi des changements irréversibles après l'abandon (ha) | Changement de l'habitat au sein de la ZER après l'abandon (%) | ||
| Habitat de milieu humide non boisé | ||||||
|
Oiseaux des milieux humides non boisés |
|
87 | 77 | 2 | -42 | -0,6 |
| Habitat de forêt des hautes terres et de milieu humide boisé | ||||||
| Habitat de reproduction de la paruline du Canada |
|
1853 | 620 | 1,9 | -994 | -0,8 |
| Habitat de reproduction du pioui de l'Est |
|
328 | 169 | 1,7 | -167 | -0,6 |
| Habitat ouvert | ||||||
| Habitat de reproduction de l'hirondelle rustique |
Nids recensés sur le terrain |
15 nids | 0 | -b | -c | -c |
|
Nids recensés sur le terrain avec une zone tampon de 200 mètres |
24 | 8 | 5 | -c | -c | |
| Habitat de reproduction de l'engoulevent d'Amérique |
|
321 | 52 | 20 | +1145d | d |
| Habitat de nidification des oiseaux aquatiques |
|
208 | 87 | 2,9 | -163 | -2 |
|
ZER = zone d'évaluation régionale; ha = hectares; % = pourcentage; m = mètre; – = sans objet. Nids recensés sur le terrain = nids d'hirondelle rustique observés pendant les relevés sur le terrain. a Les effets indirects comprennent la production de bruit et de poussière. b Le nombre de nids d'hirondelle rustique recensés dans la zone d'évaluation régionale (ZER) est inconnu. c La réhabilitation de la zone de développement du projet à sa fermeture n'aura pas d'effet mesurable sur l'habitat de nidification de l'hirondelle rustique. d On prévoit que l'aire de l'habitat de reproduction de l'engoulevent d'Amérique augmentera après la fermeture du site grâce à la réhabilitation de l'habitat propice à cette espèce. |
||||||
On s'attend à ce que les oiseaux migrateurs évitent la zone de développement du projet en raison du défrichage et de la production de bruit et de poussière, qui les pousseront à se déplacer vers les zones d'évaluation locale et régionale pendant la construction, l'exploitation et la désaffectation. La zone de développement du projet n'abrite aucun habitat unique et essentiel à la survie des oiseaux migrateurs. Les mesures d'atténuation proposées pour réduire la perte d'habitat comprennent la réduction de la zone de développement du projet et la revégétalisation progressive des zones perturbées pendant toutes les phases du projet.
En raison de la perte d'habitat dans la zone de développement du projet et de perturbations indirectes dans la zone d'évaluation locale, les oiseaux migrateurs éviteraient environ de 2 % à 3 % de l'habitat de milieu humide non boisé, de l'habitat de forêt des hautes terres et de milieu humide boisé et de l'habitat en eau libre de la zone d'évaluation régionale au cours de la construction et l'exploitation. La perte et la détérioration de l'habitat ne devraient pas avoir de répercussions sur la survie ou la viabilité à long terme des populations d'oiseaux migrateurs puisque ces types d'habitats sont répandus dans la zone d'évaluation régionale et que les perturbations sensorielles cesseront à la fin de la désaffectation.
Pendant la construction et l'exploitation, environ 20 % de l'habitat propice à l'engoulevent d'Amérique relevé sur le terrain (p. ex. forêts des hautes terres en début de succession, roches exposées, prairies et zones perturbées) sera éliminé. On ne prévoit pas que cette perte d'habitat ait un effet néfaste important sur l'engoulevent d'Amérique, une espèce d'oiseau migratoire en péril, étant donné la prévalence d'habitat perturbé dans la zone d'évaluation régionale. De plus, la réhabilitation de l'habitat de prairie dans l'installation de gestion des résidus et de l'habitat de succession composé de roches et d'arbrisseaux présents dans les installations de gestion des stériles contribuera à élargir l'habitat de l'engoulevent d'Amérique de 1145 hectares par rapport aux conditions de référence au cours de la désaffectation et la fermeture.
Le projet entraînera la perte directe de l'habitat de nidification de l'hirondelle rustique, une espèce d'oiseaux migrateurs en péril. Pendant la construction, 2 bâtiments abritant 15 nids actifs seront démolis en dehors de la saison de reproduction. Un habitat de nidification de remplacement serait créé pour l'hirondelle rustique avant la prochaine saison de reproduction afin de respecter les normes provincialesNote de bas de page 35. Dans les trois années qui suivront l'installation de l'habitat de remplacement, celui-ci fera l'objet d'une surveillance annuelle afin d'évaluer les activités de nidification et l'utilisation de la structure. On estime que les effets directs et indirects de la perte d'habitat sur les hirondelles rustiques seront faibles grâce à la création d'un habitat de nidification de remplacement.
On estime que l'habitat propice aux espèces d'oiseaux migrateurs en péril restantes, à savoir l'hirondelle de rivage, le moucherolle à côtés olive et l'engoulevent bois-pourri, ne serait pas touché par les activités du projet. On a occasionnellement observé l'hirondelle de rivage lors des relevés sur le terrain. On n'a toutefois pas trouvé d'habitat propice à sa reproduction dans la zone de développement du projet ou dans la zone d'évaluation locale. Des observations uniques du moucherolle à côtés olive (à l'extérieur de la zone d'évaluation régionale) et de l'engoulevent bois-pourri (dans la zone d'évaluation locale) ont été consignées. Cependant, l'habitat propice à la reproduction de ces espèces est considéré comme rare ou inexistant dans la zone de développement du projet et la zone d'évaluation locale.
Les mesures d'atténuation visant à réduire au minimum la perte d'habitat comprennent la réduction de l'empreinte du projet, la restriction du défrichement à l'empreinte du projet et la réduction de l'effet du défrichement sur les habitats d'importance aux oiseaux migrateurs à proximité. Les travaux de défrichage seraient effectués conformément aux lois et lignes directrices fédéralesNote de bas de page 36. Si le promoteur ne peut éviter certaines activités présentant un risque de prise accessoire, il devra mettre en œuvre des mesures supplémentairesNote de bas de page 37 en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada.
Des mesures de réhabilitation progressive pour revégétaliser les zones défrichées, ainsi que des mesures pour la gestion des espèces envahissantes, seraient mises en œuvre afin de favoriser la réhabilitation de l'habitat à l'aide d'espèces indigènes, comme indiqué à la section 6.4. Dans la mesure du possible, on propose d'entamer la réhabilitation progressive d'habitat en hautes terres, en milieu humide et en eau libre dans la fosse à ciel ouvert, l'installation de gestion des résidus, les installations de gestion des stériles et les haldes de minerai au cours de l'exploitation du projet. La surveillance de la végétation serait effectuée durant la construction et l'exploitation pour évaluer l'incidence du projet sur les communautés végétales adjacentes et prendre des mesures correctives au besoin, mais également pour mesurer la réussite de la réhabilitation progressive pendant l'exploitation, la désaffectation et la fermeture du site. De plus, le promoteur effectuera des relevés des oiseaux nicheurs conformément aux exigences fédéralesNote de bas de page 38.
Opinions exprimées
La Première Nation d'Aroland, la Première Nation de Long Lake no 58 et le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario ont demandé que le promoteur mène d'autres études de référence et continue d'exercer une surveillance pour valider les observations antérieures du promoteur. En 2016, le promoteur s'est plié à cette demande en effectuant d'autres relevés sur le terrain des oiseaux nicheurs et a identifié 15 nids d'hirondelles dans la zone de développement du projet.
La Nation métisse de l'Ontario et le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario ont demandé à ce que l'évaluation tienne compte des perturbations sensorielles. Le promoteur a mis à jour l'étude d'impact environnemental afin d'y inclure une évaluation des répercussions des perturbations sensorielles sur la faune, y compris les oiseaux migrateurs, et a conclu que la production de bruit et la poussière pourrait mener à un déplacement.
L'Agence a demandé au promoteur de tenir compte dans son évaluation de la capacité des zones d'évaluation locale et régionale à accueillir les parulines du Canada déplacées de la zone de développement du projet. Le promoteur a fait remarquer la présence d'une faible densité de parulines du Canada dans les zones d'évaluation locale et régionale, et que ces zones pourraient accueillir les individus déplacés de la zone de développement du projet et des parties de la zone d'évaluation locale qui seraient susceptible d'être affectée par des perturbations sensorielles.
Analyse et conclusion de l'Agence
L'Agence est d'avis qu'après avoir pris en compte la mise en œuvre des principales mesures d'atténuation décrites à l'encadré 7.2-1, le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets importants sur les oiseaux migrateurs et leurs nids due à la perte d'habitat. L'Agence indique que le projet éliminerait l'habitat propice aux oiseaux migrateurs dans la zone de développement du projet et perturberait l'habitat de la zone d'évaluation locale. La perte d'habitat entraînerait des modifications aux mouvements des oiseaux migrateurs et pourrait réduire l'abondance des oiseaux dans la zone d'évaluation locale, mais pas dans la population globale. Toutefois, l'Agence reconnaît que les types d'habitat retrouvés dans la zone de développement du projet sont aussi trouvés ailleurs dans les zones d'évaluation locale et régionale, et ne sont pas essentiels à la survie des espèces d'oiseaux migrateurs, y compris des espèces en péril. L'habitat propice aux oiseaux migrateurs serait partiellement restauré par la mise en œuvre de mesures de réhabilitation progressive et de gestion des espèces envahissantes, conformément aux exigences provincialesNote de bas de page 39. L'Agence recommande la mise en œuvre de mesures de programme de suivi (encadré 7.2-2), dont le volet de réhabilitation progressive, pour évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation de la réhabilitation de l'habitat et de la création d'habitat de nidification de remplacement pour les hirondelles rustiques.
Compte tenu des mesures d'atténuation proposées et des définitions des critères d'évaluation des effets environnementaux figurant à l'annexe A, l'Agence juge que l'ampleur de la perte et la détérioration de l'habitat seraient modérées, puisque la perte de l'habitat propice n'entraînerait pas de changement mesurable du nombre d'oiseaux migrateurs dans la zone de développement du projet et la zone d'évaluation locale. L'étendue géographique serait modérée, puisque la perte et la détérioration de l'habitat se limiteraient à la zone d'évaluation locale. Cet effet serait continu et de longue durée. L'effet serait partiellement réversible, car la réhabilitation, qui se poursuivrait jusqu'à la fermeture du site, ne permettrait pas de restaurer la zone aux conditions préalables au projet. Le calendrier serait modéré, puisque le promoteur effectuerait le défrichage conformément aux lignes directrices fédéralesNote de bas de page 40. Le contexte écologique et social de la perte et de la détérioration de l'habitat des oiseaux migrateurs est modéré, car quatre espèces d'oiseaux migrateurs en péril sont susceptibles de subir les effets de la perte et de la détérioration de leur habitat, y compris la perte de l'habitat de nidification connu de l'hirondelle rustique. De plus, les oiseaux aquatiques sont une source de nourriture pour les groupes autochtones de la région.
Encadré 7.2-1. Principales mesures d'atténuation des effets sur les oiseaux migrateurs
Mesures d'atténuation pour limiter l'exposition aux contaminants dans les éléments du projet comportant des eaux libres
- Mettre en œuvre les mesures d'atténuation concernant la qualité de l'eau énumérées dans l'encadré 7.1-1.
Mesures d'atténuation pour limiter le risque accru de collision avec les véhicules
- Établir une limite de vitesse maximale de 65 kilomètres à l'heure sur les routes dans la zone de développement du projet.
Mesures d'atténuation pour remédier à la perte d'habitat
- Réaliser toutes les phases du projet de manière à protéger les oiseaux migrateurs, et à éviter de les blesser, de les tuer ou de les perturber, ou encore de détruire, de perturber ou de prendre leurs nids ou leurs œufs, et à respecter intégralement la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi sur les espèces en péril (2002), tout en tenant compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement et Changement climatique Canada et du document d'orientation Périodes générales de nidification des oiseaux migrateurs au Canada.
- Élaborer et mettre en œuvre des mesures de prévention et d'atténuation pour réduire au minimum le risque de prise accessoire et pour maintenir des populations viables d'oiseaux migrateurs. En cas de découverte de nids actifs (avec des œufs ou des oisillons), il faut interrompre les travaux et établir une zone tampon jusqu'à ce que la nidification soit terminée. Toutes les mesures doivent être élaborées en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada.
- Mettre en œuvre des mesures, en consultation avec les groupes autochtones et Environnement et Changement climatique Canada, pour ramener la zone de développement du projet aux conditions préalables au projet, autant que possible, et créer un habitat propice aux oiseaux migrateurs à l'aide d'espèces indigènes. Les mesures doivent correspondre au plan de réhabilitation progressive du site, qui s'inscrit dans un plan de gestion de l'environnement et qui inclut un plan de gestion des espèces envahissantes, comme l'exige le plan de fermeture certifié prévu par la Loi sur les mines de l'Ontario.
- Mettre en œuvre des mesures visant à créer ou à améliorer l'habitat de l'hirondelle rustique, y compris la construction de l'habitat de nidification de l'hirondelle rustique, afin de compenser la perte de sites de nidification. Les mesures doivent répondre aux exigences de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l'Ontario, appliquée par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario, et des programmes de rétablissement proposés élaborés en vertu de la Loi sur les espèces en péril du gouvernement fédéral.
Encadré 7.2-2. Programme de suivi recommandé pour les oiseaux migrateurs
Mesures du programme de suivi pour limiter l'exposition aux contaminants dans les éléments du projet comportant des eaux libres
- Élaborer et mettre en œuvre, en consultation avec les groupes autochtones dans le cadre du plan de communication et de mobilisation décrit dans l'encadré 7.3-2 et avec Environnement et Changement climatique Canada, des mesures de programme de suivi pour vérifier l'exactitude des prévisions de l'évaluation environnementale :
- Surveiller, aux temps que les oiseaux migrateurs seraient présents dans la zone de développement du projet, l'utilisation par les oiseaux migrateurs de l'installation de gestion des résidus, les fossés de collecte des eaux de contact et les bassins de collecte, durant toutes les phases du projet jusqu'à ce que la qualité de l'eau dans ces composantes satisfasse aux exigences législatives et les objectifs de qualité d'eau. Les objectifs de qualité d'eau seront établis par une approche qui prend en compte les risques écologiques, et qui est développée en consultation avec les groupes autochtones et les autorités pertinentes. Si des oiseaux migrateurs accèdent à ces composantes, mettre en œuvre des mesures correctives, y compris des mesures dissuasives;
- Surveiller l'utilisation du lac de kettle par les oiseaux migrateurs. Le faire, dès le remplissage du lac de kettle jusqu'à ce que le lac de kettle respecte les exigences afin d'être relié au milieu récepteur (comme décrit à l'encadré 7.1-2). Si des oiseaux migrateurs sont observés dans le lac de kettle, mettre en œuvre des mesures correctives, y compris des mesures dissuasives.
- Mettre en œuvre les mesures du programme de suivi liées à la qualité de l'eau dans l'encadré 7.1-2.
Mesures du programme de suivi pour limiter le risque accru de collision avec les véhicules
- Élaborer et mettre en œuvre, en collaboration avec les groupes autochtones, selon le plan de communication et de mobilisation présenté dans l'encadré 7.3-2 et avec Environnement et Changement climatique Canada, un programme de suivi pour vérifier les prévisions de l'évaluation environnementale :
- Surveiller continuellement les collisions entre les véhicules du projet et les oiseaux migrateurs dans la zone d'étude du projet pendant la construction, l'exploitation et la désaffectation. Mettre en œuvre des mesures correctives en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada si des collisions de véhicules avec des oiseaux migrateurs sont enregistrées dans la zone d'étude du projet.
Mesures du programme de suivi pour remédier à la perte d'habitat
- Élaborer et mettre en œuvre, en consultation avec les groupes autochtones dans le cadre du plan de communication et de mobilisation décrit dans l'encadré 7.3-2, et avec Environnement et Changement climatique Canada, un programme de suivi pour vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation proposées, notamment :
- Pendant les travaux de construction, effectuer chaque année des relevés des oiseaux migrateurs dans la zone de développement du projet et la zone d'évaluation locale et faire de même pour cinq ans pendant l'exploitation. Au terme des cinq premières années d'exploitation, en consultation avec les groupes autochtones et Environnement et Changement climatique Canada, le promoteur détermine la fréquence et l'emplacement des relevés en fonction des résultats du programme de suivi.
- Faire le suivi annuel des mesures de réhabilitation de l'habitat propice aux oiseaux migrateurs au cours de la construction et l'exploitation.
- Faire le suivi annuel des mesures de réhabilitation de l'habitat propice aux oiseaux migrateurs pour une période de cinq ans commençant à la désaffectation, et à des intervalles de cinq ans après la confirmation des objectifs de réhabilitation.
- Surveiller annuellement l'habitat de remplacement de l'hirondelle rustique pour une période de trois ans suivant son installation, et évaluer les activités de nidification et l'utilisation de la structure, conformément à la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l'Ontario.
7.3 Peuples autochtones – usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles
Le projet pourrait avoir des effets résiduels sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles (utilisation autochtone) par :
- la réduction de la qualité et de la disponibilité des ressources pour les utilisations autochtones;
- la perte ou la modification de l'accès pour les utilisations autochtones;
- la réduction de la qualité globale de l'expérience pendant les utilisations autochtones.
L'Agence est d'avis que le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets négatifs importants sur les utilisations autochtones en raison des effets résiduels énumérés ci-dessus, compte tenu des principales mesures d'atténuation proposées (encadré 7.3-1). L'Agence recommande des mesures de programme de suivi (encadré 7.3-2) pour évaluer l'exactitude des prévisions relatives aux utilisations autochtones et pour déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation proposées. Les conclusions de l'Agence sont fondées sur son analyse de l'évaluation du promoteur ainsi que sur les opinions exprimées par Environnement et Changement climatique Canada et les groupes autochtones.
Description de l'environnement actuel
Certaines parties du nord de la zone de développement du projet (figure 1) près de la route 11 ont fait l'objet d'une exploitation minière entre les années 1930 et 1970 et sont considérées comme étant principalement une friche industrielle. D'autres parties de la zone ne sont pas aménagées. La zone d'évaluation locale (figure 2) et la zone d'évaluation régionale (figure 3) pour les utilisations autochtones sont fondées sur l'étendue combinée maximale de la composante de l'environnement atmosphérique (qualité de l'air, environnement acoustique) et des composantes valorisées de la santé humaine, des espèces terrestres et des poissons. On accède régulièrement à ces zones pour toute utilisation autochtone.
Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, les Premières Nations d'Aroland, de Constance Lake, d'Eabametoong et de Ginoogaming, la Première Nation Long Lake no 58, la Nation métisse de l'Ontario, la Première Nation de Pays Plat et la Nation indépendante des Métis de Red Sky ont indiqué qu'elles utilisent la zone de développement du projet à des fins traditionnelles comme la cueillette de plantes, la chasse, le piégeage, la pêche et les activités culturelles. Le chemin Lahtis est une voie d'accès importante aux zones d'utilisation autochtone qui traverse le centre de la zone de développement du projet, de la route 11 au bras sud-ouest du lac Kenogamisis, et le long de sa rive. Le bras sud-ouest du lac Kenogamisis se trouve dans la zone d'évaluation locale et constitue un lac important pour la pêche, les loisirs et les activités culturelles. L'affluent du ruisseau Goldfield relie le bras sud-ouest du lac Kenogamisis au lac A-322Note de bas de page 41, et l'embranchement nord de l'affluent du ruisseau Goldfield relie le lac A-322 au lac A-321, le tout dans la zone d'évaluation locale. Le chemin Goldfield, situé plus à l'ouest du chemin Lahtis, relie la route 11 à des zones à l'ouest et au sud du lac Kenogamisis, également dans la zone d'évaluation locale. Des voies de navigation ont été signalées par la Nation métisse de l'Ontario le long du bras sud-ouest du lac Kenogamisis, et par la Première Nation de Long Lake no 58, le long de l'extrémité nord du lac Wildgoose, à travers le bras sud-ouest du lac Kenogamisis et dans le lac Kenogamisis.
7.3.1 Réduction de la qualité et de la disponibilité des ressources
Évaluation des effets par le promoteur et mesures d'atténuation et de surveillance
Cueillette de plantes
L'habitat des espèces végétales récoltées par les peuples autochtones, notamment les baies, le riz sauvage et les plantes médicinales, sera perdu pendant la construction dans la zone de développement du projet (section 6.4.1). D'autres habitats dans la zone d'évaluation locale peuvent être indirectement modifiés par la contamination en raison des dépôts de poussière (section 6.1) et des changements de la quantité et de la qualité de l'eau (sections 6.2 et 6.3) pendant la construction, l'exploitation et la désaffectation.
Dans la zone d'évaluation locale, les mesures d'atténuation pour la qualité de l'air (section 6.1.1) réduiraient l'absorption par les plantes de contaminants dans les dépôts de poussière sur le sol, et les mesures d'atténuation pour la quantité et la qualité de l'eau (sections 6.2 et 6.3) réduiraient l'absorption par les plantes de contaminants dans l'eau. Avant la construction, les groupes autochtones auraient l'occasion de récolter des plantes dans la zone de développement du projet, sujet aux exigences réglementaires pour le récolteur. À toutes les étapes du projet, des mesures seraient prises visant à prévenir l'introduction d'espèces envahissantes dans la zone de développement du projet. Si possible, des méthodes mécaniques seraient utilisés pour enlever des plantes, et l'application localisée d'herbicides chimiques serait seulement utilisée lorsque cela sera nécessaire. La remise en état progressive dans la zone de développement du projet, avec l'intégration d'espèces végétales présentant un intérêt pour les groupes autochtones, se déroulerait dans la mesure du possible pendant l'exploitation et la désaffectation (voir les sections 6.4.1 et 7.2.3).
Pêche
Les groupes autochtones pêchent dans la zone de développement du projet, la zone d'évaluation locale et la zone d'évaluation régionale. Comme l'indique la section 7.1.2, aucune perte d'habitat des poissons n'est prévue grâce aux mesures d'atténuation proposées, y compris la mise en œuvre du plan de compensation de l'habitat dans le canal de dérivation du ruisseau Goldfield, qui atténuera la perte d'habitat dans le ruisseau Goldfield et plusieurs petits cours d'eau.
Chasse
Les groupes autochtones chassent l'orignal, le cerf et les animaux à fourrure (y compris la martre, le lapin et le castor), ainsi que les oiseaux (y compris la sauvagine, la grouse et le perdrix) dans la zone de développement du projet, la zone d'évaluation locale et la zone d'évaluation régionale. La suppression directe de l'habitat dans la zone de développement du projet et les effets indirects des activités du projet dans la zone d'évaluation locale réduiraient l'habitat disponible pour les oiseaux migrateurs, la sauvagine, les cerfs, les orignaux et les animaux à fourrure. Cependant, cet habitat est courant dans les zones d'évaluation locale et régionale.
Environ 2200 hectares seraient supprimés dans la zone de développement du projet, ce qui représente environ 2,5 % de l'habitat dans la zone d'évaluation régionale pour les utilisations autochtones (tableau 3). L'habitat perdu, soit directement (2200 hectares) dans la zone de développement du projet, soit indirectement (200 hectares supplémentaires en raison des perturbations sensorielles, des effets de lisière, des dépôts de poussière et des changements dans les réseaux d'eau de surface et souterraine), abriterait la sauvagine, soutiendrait l'alimentation des orignaux et offrirait une couverture de fin d'hiver pour les orignaux. La faune éviterait et sous-utiliserait une zone tampon de 200 mètres autour de la zone de développement du projet en raison de perturbations indirectes.
Les utilisateurs autochtones pourraient continuer de chasser l'orignal, le chevreuil, les animaux à fourrure et la sauvagine dans les autres parties des zones d'évaluation locale et régionale, car ces espèces devraient demeurer viables. Les déplacements de la faune, y compris ceux de l'orignal, devraient changer en raison de la présence de la fosse à ciel ouvert et des éléments du projet. La circulation motorisée et les rencontres avec les humains pourraient être à l'origine d'une certaine mortalité faunique, mais on s'attend à ce que cette mortalité demeure dans les fourchettes normales grâce à l'adoption de limites de vitesse sur le chantier de jusqu'à 65 kilomètres à l'heure dans la zone de développement du projet.
Opinions exprimées
Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek et Bingwi Neyaashi Anishinaabek se sont dites préoccupées par la perte d'habitat marécageux, source de canneberges et de riz sauvage, dans la zone de développement du projet. Le promoteur a indiqué que l'habitat de la canneberge et du riz sauvage est abondant dans la zone d'évaluation régionale et que la suppression de l'habitat marécageux dans la zone de développement du projet entraînerait une perte de moins de 1 % de la superficie totale des marécages dans la zone d'évaluation régionale. Les groupes autochtones auraient également l'occasion de récolter des plantes dans la zone de développement du projet avant la construction.
La Nation indépendante des Métis de Red Sky s'inquiète des effets éventuels sur la capacité des membres de la collectivité de récolter des baies sauvages et d'autres espèces de plantes comestibles, ainsi que des plantes utilisées à des fins médicinales et rituelles. Elle a également proposé d'éviter l'utilisation d'herbicides et de pesticides dans les régions où l'on sait qu'il y a des espèces végétales d'intérêt, ainsi que l'introduction d'espèces envahissantes, afin qu'il soit possible d'utiliser la zone de développement du projet pour la cueillette de plantes médicinales après la désaffectation. Même si le promoteur s'est engagé à déployer tous les efforts raisonnables pour éviter d'introduire des espèces envahissantes dans la zone de développement du projet, il a fait remarquer que la zone en abrite déjà un certain nombre en raison des utilisations passées des terres et du genre de paysage. Le promoteur a indiqué qu'on envisagerait l'utilisation de méthodes chimiques uniquement en cas d'inefficacité des méthodes mécaniques; on effectuerait une application localisée et on aviserait les groupes autochtones de l'application de produits chimiques.
Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland et la Première Nation de Ginoogaming ont indiqué que le lac Kenogamisis et certaines parties de la zone de développement du projet constituent des zones importantes de transfert des connaissances et d'enseignement. Ces lieux ont une grande valeur culturelle pour les membres des collectivités et ont contribué à façonner leur identité culturelle. Les collectivités ont proposé que le promoteur offre du financement pour appuyer la participation des jeunes des Premières Nations à la récolte et aux activités éducatives dans les zones d'évaluation locale et régionale, afin de compenser la perte de la zone de développement du projet pour la récolte et les effets sur le lac Kenogamisis, en tant que sites d'enseignement pour les activités traditionnelles. Le promoteur a accepté cette condition.
Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland et la Première Nation de Ginoogaming ont fait remarquer que les changements dans l'habitat et les déplacements de la faune peuvent avoir une incidence sur leur capacité de chasser et ont recommandé la surveillance de la flore et de la faune des milieux humides ayant une importance traditionnelle. Elles ont également précisé que la remise en état de l'habitat faunique associé aux utilisations autochtones devrait être entreprise en consultation avec les groupes autochtones. Le promoteur s'est engagé à faire participer les groupes autochtones à ses efforts de revégétalisation progressive afin d'améliorer l'habitat faunique associé aux utilisations autochtones.
Analyse et conclusion de l'Agence
L'Agence est d'avis qu'après avoir pris en compte la mise en œuvre des principales mesures d'atténuation décrites à l'encadré 7.3-1, le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets importants sur la qualité et l'abondance des ressources pour la cueillette de plantes, la pêche et la chasse. L'Agence juge que les activités de cueillette de plantes peuvent se poursuivre en toute sécurité à l'extérieur de la zone de développement du projet et que les mesures d'atténuation pour la qualité de l'air (section 6.1.1) réduiraient l'absorption par les plantes de contaminants dans les dépôts de poussière et que l'utilisation continue d'aliments traditionnels et de plantes médicinales demeurerait sécuritaire (section 7.4). L'Agence est satisfaite de l'engagement du promoteur de réduire au minimum l'introduction d'espèces envahissantes, d'éviter le plus possible l'utilisation d'herbicides, et d'intégrer des espèces végétales indigènes ou d'importance traditionnelle aux les groupes autochtones. L'Agence s'attend à ce que, dans le cadre de mises à jour régulières aux groupes autochtones, le promoteur présente un résumé de la fréquence et de l'emplacement de l'application de produits chimiques, afin de rassurer les utilisateurs autochtones sur le respect de cet engagement.
En ce qui concerne la pêche, l'Agence juge que la santé et la population des poissons seront maintenues, que toute perte d'habitat sera compensée (section 7.1) et que la pêche pourrait se poursuivre à l'extérieur de la zone de développement du projet. L'Agence s'attend à ce que le promoteur avise les groupes autochtones des changements de la qualité de l'eau qui pourraient avoir des répercussions sur la pêche dans certaines parties de la zone d'évaluation locale. En ce qui concerne la chasse, l'Agence juge que la santé et la population des espèces d'intérêt pour les groupes autochtones seraient maintenues, elle souligne que l'établissement d'une limite de vitesse sur les routes dans la zone de développement du projet limiterait le risque de mortalité pour la faune, reconnaît que l'utilisation des terres par les Autochtones à l'extérieur de la zone de développement du projet peut se poursuivre. L'Agence reconnaît que tout habitat perdu sera remis aux conditions préalables au projet, autant que possible à la désaffectation avec la participation des groupes autochtones. De plus, l'Agence prend acte de l'engagement du promoteur de faire participer des contrôleurs environnementaux autochtones à l'examen des rapports de surveillance, de discuter de tout effet imprévu sur les utilisations autochtones à l'extérieur de la zone de développement du projet, afin d'élaborer des mesures d'urgence, et de jouer un rôle dans la remise en état de la zone de développement du projet. Tout cela assurerait efficacement une mobilisation continue des groupes autochtones et leur donnerait l'occasion de fournir une rétroaction qui permettrait au promoteur de maintenir, la qualité et la disponibilité des ressources à l'extérieur de la zone de développement du projet.
Compte tenu des mesures d'atténuation proposées et de la définition des critères d'évaluation des effets environnementaux figurant à l'annexe A, l'Agence est d'avis que les effets seraient de faible ampleur et d'une étendue geographique de faible à modérée, car les modifications apportées à la qualité et à la disponibilité des ressources utilisées pour la cueillette de plantes, la chasse, le piégeage et la pêche permettraient aux utilisations autochtones de se poursuivre de façon semblable juste au dehors de la zone de développement du projet et à l'entrée de la zone d'évaluation locale. L'effet serait continu et de moyenne durée, car il durerait de la construction à la désaffectation, et il serait partiellement réversible étant donné que certaines parties de la zone de développement du projet seraient remises en état, et les changements aux perturbations sensorielles (qualité d'air et bruit) diminuerait après l'exploitation, ce qui augmenterait la qualité des plantes ainsi que de la disponibilité des plantes, de la faune et des poissons pour la cueillette, la chasse et la pêche.
7.3.2 Perte ou modification de l'accès pour les utilisations autochtones
Évaluation des effets par le promoteur et mesures d'atténuation et de surveillance
Les utilisations autochtones pourraient être touchées par :
- la perte de l'accès à la zone de développement du projet pendant la construction, l'exploitation et la désaffectation, dont une partie est actuellement utilisée par les Autochtones;
- la fermeture du chemin Lahtis pendant la construction, l'exploitation et la désaffectation, ce qui modifierait l'accès à la partie sud-ouest de la zone de développement du projet et au bras sud-ouest du lac Kenogamisis, situé dans la zone d'évaluation locale, ainsi qu'à des lieux de pêche de prédilection à l'ouest de la zone de développement du projet;
- l'empiétement du ruisseau Goldfield à partir du cours d'eau GFP4 jusqu'à la jonction avec l'affluent du ruisseau Goldfield par l'installation de gestion des résidus et la perte de l'accès à la zone de développement du projet, qui empêchera la navigation de ces plans d'eauNote de bas de page 42;
- l'empêchement temporaire de certaine navigation dans l'affluent du bras sud-ouest et sur le bras sud-ouest du lac Kenogamisis pendant l'aménagement des éléments du projet à l'étape de la construction et de son enlèvement à la fermeture;
- la modification des voies menant aux sites culturels de la Première Nation de Long Lake no58 et de la Nation métisse de l'Ontario, situés dans la zone de développement du projet et à la limite de la zone d'évaluation locale, pendant la construction et l'exploitation, mais dont l'accès sera rétabli à l'étape de la désaffectation.
Comme mesure d'atténuation pour la perte de l'accès à la zone de développement du projet, le promoteur maintiendrait l'accès le long du chemin Goldfield, et il a pris l'engagement d'offrir une autre voie d'accès au bras sud-ouest du lac Kenogamisis et aux sites culturels mentionnés. Les petites embarcations recouvreraient l'accès au canal de dérivation du ruisseau Goldfield une fois que les restrictions auraient été levées après la désaffectation. Des travaux de construction seraient effectuées pour empêcher l'écoulement des débris dans les plans d'eau navigables, afin d'éviter toute répercussion sur la navigabilité une fois que l'accès sera rétabli après la désaffectation.
Opinions exprimées
Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, les Premières Nations d'Aroland et de Ginoogaming, la Première Nation de Long Lake no 58 et la Nation métisse de l'Ontario ont soulevé des préoccupations au sujet de la capacité d'accéder au bras sud-ouest du lac Kenogamisis, à la jonction avec l'affluent du ruisseau Goldfield, et de la perte de l'accès aux zones le long du chemin Lahtis. La Nation métisse de l'Ontario a aussi indiqué que les activités de récolte par ces citoyens seraient limitées ou modifiées dû aux changements d'accès à leurs sites privilégiés. Le promoteur a indiqué que les groupes autochtones seront toujours en mesure d'accéder à ces zones et s'est engagé à conserver une autre voie d'accès au bras sud-ouest du lac Kenogamisis.
Analyse et conclusion de l'Agence
L'Agence est d'avis qu'après avoir pris en compte la mise en œuvre des principales mesures d'atténuation décrites à l'encadré 7.3-1, le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets importants sur l'accès aux zones d'utilisation autochtone. L'Agence reconnaît que l'hypothèse du promoteur que l'empiétement du ruisseau Goldfield empêcherait sa navigation est très conservatrice, puisqu'aucun groupe autochtone utilise présentement le ruisseau Goldfield pour naviguer aux lieux de pêche de prédilection. L'Agence reconnaît aussi l'affirmation de la Nation métisse de l'Ontario que les activités de récolte par ces citoyens seraient limitées ou modifiées dû aux changements d'accès à leurs sites privilégiés, et fait noter que le promoteur s'est engagé à offrir une autre voie d'accès au bras sud-ouest du lac Kenogamisis le long du chemin Goldfield et aux sites culturels identifiés à toutes les étapes. Après la désaffectation, on assurerait l'accès au canal de dérivation du ruisseau Goldfield au nord de l'installation de gestion des résidus. De plus, malgré la perte du chemin Lahtis existant à cause du projet, l'Agence souligne que les groupes autochtones seraient toujours en mesure d'accéder aux zones le long du bras sud-ouest du lac Kenogamisis, y compris à la jonction entre l'affluent du ruisseau Goldfield et le bras sud-ouest du lac Kenogamisis, quoique ce serait plus long en temps. L'Agence fait remarquer que le promoteur prévoit élaborer un protocole de communication pour informer les groupes autochtones de restrictions d'accès temporaires dû aux activités zone de développement du projet.
L'Agence est d'avis que le programme de suivi devrait supposer de vérifier auprès des groupes autochtones si l'autre voie d'accès est viable et satisfaisante. L'Agence fait remarquer que l'accès aux sites culturels d'intérêt pour la Première Nation de Long Lake no 58 et la Nation métisse de l'Ontario serait rétabli au moment de la désaffectation, et que le promoteur s'engage à travailler avec ces groupes autochtones pour veiller à ce que l'accès à ces sites demeure disponible. Selon les informations reçues, l'Agence convient qu'aucun autre site privilégié pour les utilisations autochtones ne serait perdu à cause de l'aménagement d'éléments du projet dans la zone de développement du projet ou des limites d'accès.
Compte tenu des mesures d'atténuation proposées et de la définition des critères d'évaluation des effets environnementaux figurant à l'annexe A, l'Agence est d'avis que les effets du projet sur l'accès seraient d'une ampleur modérée et d'une étendue géographique de faible à modérée, car ils pourraient cause un changement aux lieux privilégiés, surtout aux citoyens de la Nation métisse de l'Ontario, et ils modifieraient l'accès au bras sud-ouest du lac Kenogamisis, situé dans la zone d'évaluation locale. L'effet serait continu et de moyenne durée, soit moins de 25 ans entre la construction et la désaffectation, et serait partiellement réversible en raison du rétablissement de certains points d'accès après la désaffectation.
7.3.3 Réduction de la qualité globale de l'expérience des utilisations autochtones
Évaluation des effets par le promoteur et mesures d'atténuation et de surveillance
Les peuples autochtones pourraient connaître une diminution de la qualité de leur expérience d'usage ou être dissuadés de pratiquer des activités dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis, où se trouvent des lieux de pêche de prédilection. La qualité de l'expérience dans la zone de développement du projet le long du chemin Goldfield et le long du bras sud-ouest du lac Kenogamisis, qui s'étend jusqu'à la zone d'évaluation locale pour des activités comme la pêche, pourrait être réduite par les perturbations sensorielles dues à l'augmentation de la poussière (section 6.1.1) et par l'augmentation du bruit attribuable aux activités du projet, notamment le dynamitage (section 6.1.2). Le paysage existant visible depuis la rive du bras sud-ouest du lac Kenogamisis, où se déroulent les utilisations autochtones, serait modifié en raison de la présence d'éléments plus importants du projet, en particulier l'installation de gestion des stériles et l'installation de gestion des résidus. Les éléments qui demeureraient au-delà de la désaffectation seraient plus évidents et resteraient visibles jusqu'après la fermeture, bien qu'ils ne soient visibles que dans la zone d'évaluation locale.
Les mesures d'atténuation de la qualité de l'air qui sont décrites en détail à la section 6.1.1 réduiraient les niveaux de poussière éprouvés par les utilisateurs de la zone d'évaluation locale. Les mesures d'atténuation du bruit, décrites en détail à la section 6.1.2, réduiraient le bruit entendu dans la zone d'évaluation locale et assureraient une certaine prévisibilité, puisque les travaux de construction se dérouleraient pendant le jour et que le dynamitage aurait lieu entre 10 h et 16 h les jours de semaine non fériés, à moins que cela ne soit nécessaire à un autre temps pour des raisons de sécurité. La revégétalisation progressive décrite dans l'encadré 7.2-1 rendrait les changements du paysage visuel moins prononcés pendant la fermeture, puisque les utilisateurs qui approcheraient de la zone de développement du projet, en particulier par le bras sud-ouest du lac Kenogamisis, verraient un paysage végétalisé plutôt que des amas de stériles. Une communication régulière avec les contrôleurs environnementaux autochtones permettrait de prendre des mesures proactives pour répondre aux préoccupations et d'intervenir rapidement au cas où les collectivités devraient être avisées d'événements imprévus.
Opinions exprimées
Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland, la Première Nation de Ginoogaming et Biigtigong Nishnaabeg ont indiqué que le projet pourrait avoir des effets négatifs sur le bien-être social, culturel, mental et physique, qu'il faudrait prendre en compte lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de programmes de surveillance, de stratégies de gestion adaptative, de plans de communication et de programmes d'indemnisation. Elles indiquent que les groupes autochtones dépendent fortement des terres et des ressources. Les empêcher ou les dissuader d'utiliser les terres pour la chasse, la pêche, la cueillette ainsi que les activités récréatives et culturelles à l'intérieur ou à proximité de la zone de développement du projet pourrait avoir des effets négatifs sur les membres des collectivités. De plus, les membres des collectivités pourraient éviter les zones considérées comme contaminées ou touchées d'une autre façon par le projet. Cela pourrait entraîner une réduction du lien culturel et la perte de cohésion sociale, et avoir une incidence sur le bien-être mental et physique global de ces collectivités. Le promoteur fait remarquer que les mesures d'atténuation qui évitent ou réduisent les effets sur les utilisations autochtones (section 7.3) et sur les conditions sanitaires et socioéconomiques (section 7.4) pourraient également atténuer les effets sur le bien-être social, culturel, mental et physique. Toutefois, en cas de détection d'effets sur le bien-être, le promoteur adapterait les plans de gestion et de surveillance de l'environnement en fonction de la rétroaction des groupes autochtones. Le promoteur s'est également engagé à aider les collectivités à poursuivre leurs pratiques culturelles et à maintenir leur bien-être.
Analyse et conclusion de l'Agence
L'Agence est d'avis qu'après avoir pris en compte la mise en œuvre des principales mesures d'atténuation décrites à l'encadré 7.3-1, le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets importants sur la qualité de l'expérience attribuable aux perturbations sensorielles et aux modifications du paysage visuel. L'Agence reconnaît que la présence de poussière, de bruit et d'éléments importants du projet pourrait nuire à la jouissance et dissuader les Autochtones d'utiliser les terres, mais fait remarquer que les mesures d'atténuation proposées pour limiter la poussière, le bruit et les perturbations visuelles grâce à la remise en état progressive permettraient de confiner les changements à une zone située immédiatement à l'extérieur de la zone de développement du projet. L'Agence est d'avis que l'engagement du promoteur de limiter les activités de dynamitage aux jours de semaine entre 10 h et 16 h, tout en évitant les jours fériés sauf quand nécessaire pour raisons de sécurité, apportera une certaine prévisibilité aux perturbations sonores. L'Agence croit qu'éviter le dynamitage aux jours d'importance culturelle, déterminés en consultation avec les groupes autochtones, minimiserait aussi certains effets à la qualité de l'expérience, tandis que la communication des calendriers de dynamitage aux groupes autochtones permettra aux utilisateurs autochtones de planifier leurs activités en fonction du bruit prévu du dynamitage, ce qui réduira la probabilité de bruit imprévu. De plus, après la désaffectation, les perturbations causées par la poussière et le bruit seraient éliminées. Dans le cadre de l'étude environnementale, le promoteur avait supposé de façon prudente que toute la végétation serait enlevée dans la zone de développement du projet (section 6.4.1), mais l'Agence croit comprendre que le promoteur en conserverait une partie et qu'il s'est engagé à laisser en place des zones tampons d'arbres et de végétation afin de protéger les éléments du projet des regards et de réduire le bruit. En outre, les perturbations visuelles seraient réduites avec la mise en œuvre de la revégétalisation progressive (encadré 7.2-1). L'Agence reconnaît qu'une perception de contamination attribuable aux modifications de l'air, de l'eau et du sol pourrait se produire et être aggravée par les modifications du paysage visuel. Toutefois, l'Agence fait remarquer que le promoteur adapterait les plans de gestion et de surveillance de l'environnement en fonction des commentaires des groupes autochtones et veillerait à assurer une communication continue afin de clarifier la perception de contamination.
Compte tenu des mesures d'atténuation proposées et de la définition des critères d'évaluation des effets environnementaux figurant à l'annexe A, l'Agence est d'avis que les effets sur la qualité de l'expérience des utilisations autochtones seraient de faible ampleur et d'étendue géographique moyenne, puisque les modifications de l'expérience devraient permettre aux utilisations autochtones de se poursuivre de façon semblable, et l'effet serait limitée à juste dedans la zone d'évaluation locale. L'effet serait continu et de longue durée, étant donné qu'il se prolongerait sur toutes les étapes du projet (pendant plus de 25 ans) et qu'il serait partiellement réversible, car les changements aux perturbations sensorielles (qualité d'air et bruit) diminuerait après l'exploitation, bien que certaines modifications du paysage visuel demeureraient.
Encadré 7.3-1. Principales mesures d'atténuation des effets sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles
Mesures d'atténuation visant à pallier la réduction de la qualité et de la disponibilité des ressources
- Donner aux groupes autochtones l'occasion de récolter des plantes à des fins traditionnelles avant la construction.
- Dans le cadre des mesures visant à restaurer la zone de développement du projet à des conditions aussi proches que possible de celles qui existaient avant le projet (encadré 7.2-1), gérer l'introduction d'espèces envahissantes dans la zone de développement du projet.
- Dans le cadre des mesures visant à restaurer la zone de développement du projet à des conditions aussi proches que possible de celles qui existaient avant le projet (encadré 7.2-1), incorporer des espèces végétales indigènes ou d'intérêt traditionnelles aux groupes autochtones, incluant les plantes médicinaux, consommables et cérémoniels, en consultation avec les groupes autochtones, pour créer des activités de récolte futurs.
- Mettre en œuvre les mesures d'atténuation définies dans l'encadré 7.1-1 relativement aux poissons et à leur habitat, qui protégeraient l'habitat, la population et la santé des poissons.
- Mettre en œuvre les mesures d'atténuation définies dans l'encadré 7.2-1 relativement aux limites de vitesse pour contrôler les dépôts de poussière.
- Mettre en œuvre les mesures d'atténuation définies dans l'encadré 7.4-1 relativement à la qualité de l'air.
Mesures d'atténuation visant à pallier la perte ou la modification de l'accès
- Pour les utilisations autochtones, fournir une autre voie d'accès sans restriction au bras sud-ouest du lac Kenogamisis et maintenir l'accès le long du chemin Goldfield, en consultation avec les groupes autochtones, dans le cadre du plan de communication et de mobilisation présenté dans l'encadré 7.3-2, pendant la construction dès que l'accès courante devient limité, l'exploitation et la désaffectation.
- Fournir aux groupes autochtones un accès sans restriction au canal de dérivation du ruisseau Goldfield, en consultation avec eux, dans le cadre du plan de communication et de mobilisation présenté dans l'encadré 7.3-2, après la désaffectation.
- Fournir de l'information aux groupes autochtones, dans le cadre du plan de communication et de mobilisation, avant la construction, concernant les activités du projet et leurs effets, y compris sur les cours d'eau utilisés pour la navigation (p. ex. les points de rejet des effluents traités et la prise d'eau douce au lac Kenogamisis), et continuer de le faire pendant toutes les étapes du projet.
Mesures d'atténuation visant à pallier la réduction de la qualité globale de l'expérience
- Faire du dynamitage entre 10 h et 16 h, en évitant les jours fériés et les jours d'importance culturelle qui doivent être déterminés en consultation avec les groupes autochtones, à moins que cela ne soit nécessaire pour des raisons de sécurité. Dans le cas où le dynamitage est requis en dehors de ces périodes, ou lors de jours fériés ou de jours d'importance culturelle, le promoteur doit aviser les groupes autochtones, selon le plan de communication et de mobilisation de l'encadré 7.3-2.
- Selon le plan de communication et de mobilisation de l'encadré 7.3-2, fournir aux groupes autochtones les dates et les heures de toutes les activités de dynamitage régulières, ainsi qu'un mécanisme pour fournir des mises à jour sur le calendrier de dynamitage.
- Élaborer une procédure de réponse aux plaintes, dans le cadre du plan de communication et de mobilisation présenté dans l'encadré 7.3-2, pour traiter les plaintes relatives au bruit, le cas échéant.
- Mettre en œuvre les mesures d'atténuation définies dans l'encadré 7.4-1 relativement à la qualité de l'air.
- Mettre en œuvre les mesures d'atténuation définies dans l'encadré 7.2-1 relativement à la revégétalisation progressive.
Encadré 7.3-2. Programme de suivi recommandé pour l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles
Mesures du programme de suivi pour pallier la réduction de la qualité et de la disponibilité des ressources
- Élaborer un plan de communication et de mobilisation et déterminer, de concert avec les dirigeants de chaque groupe autochtone, les contrôleurs environnementaux de chaque collectivité. Faire participer les contrôleurs environnementaux autochtones à l'examen des rapports de surveillance; discuter des effets imprévus sur les utilisations autochtones; et, au besoin, élaborer et mettre en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires. Valider les utilisations autochtones auprès des groupes et veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre de mesures d'atténuation appropriées.
Mesures du programme de suivi pour pallier la perte ou la modification de l'accès
- Dans le cadre du plan de communication et de mobilisation présenté dans l'encadré 7.3-2, valider les utilisations autochtones auprès des groupes et veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre de mesures d'atténuation appropriées, pour permettre au moins de maintenir l'accès continu aux sites importants pour les groupes autochtones.
- Veiller à ce que l'autre voie d'accès au bras sud-ouest du lac Kenogamisis et l'accès le long du chemin Goldfield soient maintenus et demeurent accessibles aux groupes autochtones pendant la construction, l'exploitation et la désaffectation.
Mesures du programme de suivi pour pallier la réduction de la qualité globale de l'expérience
- Dans le cadre du plan de communication et de mobilisation présenté dans l'encadré 7.3-2, valider auprès des groupes autochtones l'utilisation par les Autochtones et la non-utilisation en raison de préoccupations perçues au sujet de la contamination. Dans l'éventualité où l'on remarque un évitement des zones en raison de la perception, fournir des renseignements qui aideraient les groupes autochtones à maximiser les utilisations autochtones. Dans le cas où des groupes autochtones signalent des effets imprévus sur l'expérience, veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre de mesures d'atténuation appropriées.
7.4 Peuples autochtones – santé et conditions socioéconomiques
Le projet pourrait avoir des effets résiduels sur la santé et sur les conditions socioéconomiques des peuples autochtones par :
- l'exposition aux contaminants de l'air et de l'eau par inhalation, ingestion ou contact cutané;
- la réduction de la capacité de récolter des ressources économiques et de subsistance.
L'Agence est d'avis que le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets négatifs importants sur la santé et sur les conditions socioéconomiques en raison des effets résiduels indiqués ci-dessus, compte tenu des principales mesures d'atténuation proposées (encadré 7.4-1). L'Agence recommande des mesures de programme de suivi (encadré 7.4-.2) pour évaluer l'exactitude des prévisions et l'efficacité des mesures d'atténuation liées à la santé humaine.
Les conclusions de l'Agence sont fondées sur son analyse de l'évaluation du promoteur ainsi que sur les opinions exprimées par Santé Canada, Environnement et Changement climatique Canada et les groupes autochtones.
Description de l'environnement actuel
Il existe un avis sur la consommation de poissons dans le lac Kenogamisis en raison de la présence de mercure dans les tissus des poissons. Le quotient de risqueNote de bas de page 43 de référence pour l'arsenic, le mercure, le méthylmercure et plusieurs autres paramètresNote de bas de page 44 est actuellement supérieur au point repère de Santé Canada de 0,2.
L'exploitation traditionnelle dans la zone de développement du projet comprend la chasse, notamment la chasse aux oiseaux migrateurs et à l'orignal, une ligne de piégeage appartenant à un membre d'Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek et une portion de 141 hectares une des zones de pêche de poissons-appâts. Sept autres territoires de piégeage se situent dans la zone d'évaluation régionale, dont trois appartiennent à des membres de la Première Nation de Long Lake no 58 et quatre à des personnes dont on ne connaît pas l'appartenance. Sept zones de pêche de poissons-appâts appartiennent à des Autochtones dans la zone d'évaluation régionale, bien qu'on ne connaisse pas leurs collectivités.
7.4.1 Exposition à des contaminants de l'air et de l'eau par inhalation, ingestion ou contact cutané
Évaluation des effets par le promoteur et mesures d'atténuation et de surveillance
L'évaluation des effets sur la santé humaine a porté sur les voies d'exposition suivantes : inhalation de particules atmosphériques; ingestion d'eau de surface et d'aliments traditionnels (animaux, plantes et poissons); et contact cutané (de la peau) avec l'eau de surface et le sol.
Comme le mentionne la section 6.1, des dépassements peu fréquents (jusqu'à 0,3 % du temps, ou un jour par an) des normes de qualité de l'air applicablesNote de bas de page 45 sont prévus dans certaines parties de la zone d'évaluation locale pour des concentrations moyennes de PM10 sur 24 heures. Les risques pour la santé attribuables à l'exposition à des PM10 sont considérés comme négligeables. Des dépassements des normes de qualité de l'air applicables pour le benzène et le benzo[a]pyrène ont été prévus, mais les concentrations de fond utilisées dans le modèle de risque sont très prudentes pour la zone d'évaluation locale, et la contribution du projet aux risques pour la santé liée à ces composés est considérée comme négligeable. Ces composés ont fait l'objet d'une évaluation plus poussée en tant que cancérogènes dans le cadre de l'évaluation des risques pour la santé humaine. L'augmentation du risque de cancer à vie attribuable à l'exposition à ces contaminants serait considérée comme négligeable.
Comme le mentionne la section 6.3, la concentration de plusieurs métaux devrait augmenter dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis, l'affluent du bras sud-ouest et le lac Mosher. La concentration d'arsenic dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis respecterait les normes de qualité de l'eau applicablesNote de bas de page 46 dans un rayon de deux kilomètres du point de rejet, principalement en raison des conditions existantes, tandis que la concentration d'autres métaux ne dépasserait pas les normes de qualité de l'eau applicables. Les changements de la qualité de l'eau pourraient accroître l'exposition à des métaux par l'ingestion d'eau ou la baignade dans le cadre d'activités récréatives ou culturelles, en particulier dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis. Les dépôts de poussière sur le sol pourraient entraîner l'absorption de métaux par les plantes, et l'augmentation de la concentration de métaux dans le sol et dans l'eau pourrait augmenter la concentration de métaux dans les animaux et les poissons qui les consomment. La concentration d'arsenic chez le doré jaune, en particulier dans l'affluent du bras sud-ouest, pourrait augmenter en raison des changements de la concentration d'arsenic dans l'eau (section 7.1.1).
Le quotient de risque total pour l'arsenic et plusieurs autres paramètresNote de bas de page 47 dépasseraient le seuil de 0,2 recommandé par Santé Canada, mais les dépassements sont généralement attribuables aux conditions existantes, et la contribution du projet serait négligeable. L'arsenic a également été considéré comme cancérogène dans l'évaluation des risques pour la santé humaine; l'augmentation du risque de cancer à vie découlant d'une exposition par ingestion a été considérée comme négligeable.
Les mesures d'atténuation pour la qualité de l'air (section 6.1.1), la qualité de l'eau (section 6.3) et la santé des poissons (section 7.1) protégeraient la santé humaine, et aucune autre mesure d'atténuation n'est proposée expressément pour réduire les effets sur la santé humaine.
La surveillance proposée pour la qualité de l'air comprend la surveillance en temps réel des PM10, l'échantillonnage des particules totales en suspension et des métaux, et la surveillance de la teneur en limon sur les routes, afin de valider les hypothèses formulées au sujet de la formation de particules dans le modèle de la qualité de l'air (section 6.1.1).
La surveillance proposée pour la qualité de l'eau porte sur l'arsenic et le mercure dans le lac Kenogamisis, l'affluent du bras sud-ouest et le lac Mosher. En réponse aux préoccupations soulevées par les groupes autochtones (section 7.1.1) au sujet des effets néfastes sur les poissons en raison de l'augmentation des contaminants dans les eaux souterraines et les eaux de surface du lac Kenogamisis, on surveillera les tissus de poisson pour détecter la présence de contaminants, y compris le méthylmercure, le mercure et l'arsenic, dans les poissons provenant des plans d'eau, comme le canal de dérivation du ruisseau Goldfield et le lac Kenogamisis. Une étude d'échantillonnage des tissus de poisson permettrait de surveiller les modifications éventuelles de la concentration de métaux dans les tissus, y compris le mercure, qui peut se bioaccumuler dans les tissus des poissons. Une étude sur la santé des orignaux serait mise en œuvre en collaboration avec le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario et les groupes autochtones, afin d'évaluer les modifications éventuelles de la concentration de métaux dans la viande sauvage entrant dans l'alimentation traditionnelle. L'étude sur les orignaux, jumelée à l'étude de surveillance des sols, peut servir à inférer les changements des concentrations tissulaires dans les plantes pouvant être utilisées comme aliments traditionnels.
Opinions exprimées
Santé Canada a fait remarquer que les concentrations de référence dans les tissus des gros animaux, comme l'orignal, ont été calculées à partir de données sur les tissus de petits mammifères, et a indiqué une préférence pour les concentrations de référence provenant des aliments traditionnels qui sont réellement consommés dans la zone du projet. Comme solution de rechange, les concentrations dans les tissus provenant de l'Étude sur l'alimentation, la nutrition et l'environnement chez les Premières Nations et du Conseil tribal Nokiiwin ont également été proposées. Le promoteur a reconnu qu'il pourrait y avoir de petites différences entre les concentrations dans les tissus des petits mammifères et celles dans les tissus des orignaux, mais ces différences ne changeraient pas les conclusions de l'évaluation des risques pour la santé humaine. Il a choisi de ne pas utiliser les autres ensembles de données, car la taille des échantillons était petite, étant donné qu'il existe peu d'information pour valider l'échantillonnage utilisé. Santé Canada recommande que l'Agence inclue dans un programme de suivi l'échantillonnage des tissus d'aliments traditionnels, afin de valider les hypothèses formulées au sujet des concentrations prédites de contaminants dans les aliments traditionnels.
Analyse et conclusion de l'Agence
L'Agence est d'avis qu'après avoir pris en compte la mise en œuvre des principales mesures d'atténuation décrites à l'encadré 7.4-1, le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets importants sur la santé liée à l'exposition aux contaminants de l'air et de l'eau par inhalation, ingestion ou contact cutané. L'Agence fait remarquer que, avec l'application des principales mesures d'atténuation présentées dans l'encadré 7.4-1, l'exposition aux contaminants découlant de changements à la qualité de l'air, par inhalation, ingestion et contact cutané serait minime dans la zone d'évaluation locale, étant donné qu'on prévoit seulement des dépassements peu fréquents des critères de qualité sur l'air pour les PM10 (1 journée par année). Les principales mesures d'atténuation décrites dans l'encadré 7.1-1 pour réduire les changements de la qualité de l'eau constitueraient également des mesures clés pour réduire l'exposition à l'arsenic par contact cutané et par ingestion de poissons.
Pour vérifier les prévisions de l'évaluation environnementale, l'Agence propose une surveillance en temps réel des PM10 et une surveillance régulière des particules totales en suspension, des PM2,5 et des métaux à des endroits dedans des zones utilisées par les groupes autochtones aux fins traditionnelles, ou dans des zones représentatifs de la qualité de l'air dans des zones utilisées par les groupes autochtones aux fins traditionnelles près de la limite de la zone de développement du projet pendant la construction, l'exploitation et la désaffectation. L'Agence est d'accord avec l'opinion exprimée par Environnement et Changement climatique Canada et par Santé Canada dans la section 6.1.1 pour surveiller le dioxyde d'azote, pour assurer que le projet rencontre les normes canadiennes de qualité de l'air ambiant pour le dioxyde d'azote. De même, l'Agence propose des mesures de programme de suivi pour vérifier les prévisions de l'évaluation environnementale des concentrations de mercure et de méthylmercure dans l'affluent du bras sud-ouest, pour confirmer la prédiction du promoteur que peu de méthylmercure sera produit dans l'affluent du bras sud-ouest. L'Agence propose également des mesures de programme de suivi pour vérifier les prévisions des concentrations d'arsenic, de mercure et de méthylmercure dans les tissus de poisson, afin de répondre aux préoccupations soulevées par les groupes autochtones au sujet de la contamination. L'Agence fait noter l'engagement du promoteur à surveiller la présence de contaminants dans les tissus du corps entier des poissons, tel que demandé par plusieurs groupes autochtones (section 7.1.1). Lorsque les concentrations dépassent les prévisions, l'Agence s'attend à ce que le promoteur mette en place des mesures d'atténuation supplémentaires. Bien que l'Agence reconnaisse que les niveaux élevés prévus de benzène et de benzo[a]pyrène sont probablement le résultat de mesures de fond très prudentes, dans le cadre du programme de suivi, elle propose que le promoteur surveille les niveaux de ces substances, dans les mêmes zones, tout au long de la construction et au moins pendant les deux premières années d'exploitation. L'Agence propose que le promoteur confirme les conditions de référence afin de vérifier que la contribution du projet est négligeable.
La surveillance proposée par le promoteur pour la teneur en limon sur les routes sur le site serait nécessaire pour confirmer que les prévisions concernant la qualité de l'air étaient fondées sur les hypothèses appropriées. Un plan de communication, élaboré avant la construction en vue d'une mise en œuvre au début du projet, permettra la diffusion des résultats des programmes de surveillance aux groupes autochtones et l'établissement d'une entente proactive sur les mesures d'atténuation supplémentaires qui peuvent être prises si les résultats ne sont pas favorables. L'Agence est d'accord avec la recommandation de Santé Canada selon laquelle il faudrait inclure l'échantillonnage des aliments traditionnels dans un programme de suivi, les espèces de petits mammifères devant être déterminées d'après la collaboration du promoteur avec les collectivités autochtones. L'Agence est satisfaite avec la conclusion du promoteur que les augmentations de contaminants dans l'original seraient peu probables dû au projet, et note aussi que dû aux mouvements de migration de l'orignal, il serait difficile d'attribuer un changement dans les niveaux de contaminants dans l'orignal directement au projet. L'Agence reconnait l'engagement du promoteur de participer dans une étude de santé de l'orignal. Les tissus de poisson devraient faire l'objet d'une surveillance dans le cadre du programme de suivi des augmentations de mercure et d'arsenic dans les zones où des augmentations sont prévues. Bien que le promoteur indique que les changements aux concentrations de méthylmercure dans l'affluent du bras sud-ouest seraient négligeables, un programme de suivi devrait confirmer cette prévision pour le tissus du doré jaune.
Compte tenu des mesures d'atténuation proposées et de la définition des critères d'évaluation des effets environnementaux figurant à l'annexe A, l'Agence est d'avis que les effets sur la santé humaine seraient d'une ampleur modérée, car le projet entraînerait un changement des niveaux d'exposition inférieurs aux normes en matière de santé, mais qui s'en rapprochent. Les effets auraient une étendue géographique modérée, car ils s'étendraient à la zone d'évaluation locale. L'effet serait continu et de moyenne durée, car il durerait jusqu'à la désaffectation, et serait partiellement réversible puisque les changements à la qualité de l'air et de l'eau seraient renversés graduellement vers les conditions préalables au projet.
7.4.2 Réduction de la capacité de récolter des ressources de subsistance
Évaluation des effets par le promoteur et mesures d'atténuation et de surveillance
La capacité de s'adonner à la récolte de ressources de subsistance serait touchée par la perte d'environ 20 hectares d'habitat dans la zone de développement du projet de la ligne de piégeage appartenant à un membre d'Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, ce qui représente environ 0,1 % de la superficie totale de la zone de piégeage, et par la perte de 141 hectares d'une zone de pêche de poissons-appâts. Les lignes de piégeage appartenant à la Première Nation de Long Lake no 58 pourraient être touchées par le fait que la faune évite des parties de la zone d'évaluation locale près de la zone de développement du projet (section 7.3.1). L'accès aux lignes de piégeage situées près de la zone de développement du projet (section 7.3.2) serait également touché.
Les effets sur les lignes de piégeage dans la zone de développement du projet ont été atténués par la réduction de l'empreinte du projet afin de réduire au minimum la perte d'habitat terrestre (section 6.4.1), ainsi que par des mesures d'atténuation visant à réduire la perte d'habitat faunique, le risque de mortalité faunique et la restriction des déplacements de la faune (encadré 7.2-1) et par l'offre d'une autre voie d'accès au bras sud-ouest du lac Kenogamisis pendant la construction, l'exploitation et la désaffectation (encadré 7.3-1). L'habitat faunique serait remis en état au moment de la désaffectation, avec la participation des groupes autochtones. Le plan de compensation de l'habitat des poissons réduirait les effets sur la zone de pêche de poissons-appâts, bien que cette zone deviendrait accessible après la désaffectation (section 7.3.2).
Opinions exprimées
La Première Nation de Ginoogaming a soulevé la préoccupation que la disponibilité réduite des aliments récoltés traditionnellement entraîne des coûts supplémentaires pour ses membres en raison de la dépendance accrue aux aliments des épiceries. Le promoteur a indiqué que, compte tenu de la faible empreinte des effets, de la capacité de récolter ailleurs, y compris dans la zone d'évaluation locale et au-delà, et de la proposition d'offrir une autre voie d'accès dans la mesure du possible, les effets éventuels seraient faibles.
Analyse et conclusion de l'Agence
L'Agence est d'avis qu'après avoir pris en compte la mise en œuvre des principales mesures d'atténuation décrites à l'encadré 7.4-1, le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets importants sur les conditions socioéconomiques liées à la réduction de la capacité de récolter des ressources de subsistance, notamment le piégeage et la pêche de poissons-appâts. L'offre d'une autre voie d'accès au bras sud-ouest du lac Kenogamisis (encadré 7.3-1), les mesures d'atténuation pour l'habitat faunique (encadré 7.2-1) et l'habitat des poissons (encadré 7.1-1) et la réduction de la superficie du projet traiteraient les effets sur les lignes de piégeage pallieraient les effets sur les conditions socioéconomiques attribuables à la réduction de la capacité de récolter des ressources de subsistance, notamment le piégeage et la pêche de poissons-appâts. L'Agence comprend que la ligne de piégeage pourrait avoir une valeur socio-économique et culturelle, et note un engagement du promoteur à traiter cette inquiétude d'Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek. L'Agence reconnaît l'opinion exprimée par Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland et la Première Nation de Ginoogaming au sujet des effets socioéconomiques d'une disponibilité réduite des aliments traditionnels, qui pourrait entraîner une perte économique en raison de la dépendance accrue aux épiceries.
Compte tenu des mesures d'atténuation proposées et de la définition des critères d'évaluation des effets environnementaux figurant à l'annexe A, l'Agence croit que les effets sur les conditions socioéconomiques attribuables à la réduction de la capacité de récolter des ressources de subsistance, notamment le piégeage et la pêche de poissons-appâts, seront d'une ampleur modérée, car la récolte pourrait nécessiter une certaine modification du comportement car il ne pourrait pas accéder à certaines endroits préférés, et auront une étendue géographique de faible à modérée, car elle se limiterait à l'entrée de la zone d'évaluation locale. L'effet serait continu et de moyenne durée, car il durerait jusqu'à la désaffectation, et serait partiellement réversible, étant donné que l'accès aux lignes de piégeage et la pêche de poissons-appâts pourraient être rétablis après la désaffectation, et l'on prévoit que la remise en état permettra de reprendre la récolte des ressources de subsistance dans la zone de développement du projet, quoiqu'à des endroits légèrement différents des lieux actuels en raison du réalignement du ruisseau Goldfield dans la zone d'évaluation locale.
Encadré 7.4-1. Principales mesures d'atténuation des effets sur la santé et sur les conditions socioéconomiques des Autochtones
Mesures d'atténuation visant à pallier l'exposition aux contaminants de l'air et de l'eau
- Dans le cadre du plan de communication et de mobilisation présenté dans l'encadré 7.3-2, communiquer les résultats du programme de suivi figurant dans l'encadré 7.4-2. Cela devrait comprendre la communication de tout risque connexe pour la santé et des mesures correctives à prendre pour réduire davantage les rejets de contaminants ou l'exposition aux contaminants.
- Respecter les normes établies dans les Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant et les Critères de qualité de l'air ambiant de l'Ontario en mettant en œuvre un programme de gestion de la poussière pour contrôler les émissions fugitives de particules provenant des routes et de la manutention des matériaux sur le chantier, ce qui comprend de faire ce qui suit :
- contrôler les émissions fugitives de poussière provenant des routes, de la manutention des matériaux, et des piles de stockage par l'application de jets d'eau, l'utilisation de surfactants, le balayage de la poussière, l'application de gravier, les stations de nettoyage des roues des camions et le confinement des sources de poussière;
- utiliser des dépoussiérants (p. ex. de l'eau) dans des situations qui présentent une possibilité accrue de produire de la poussière en suspension dans l'air;
- munir les concasseurs de systèmes de dépoussiérage (dépoussiéreur à manches ou l'équivalent) pour contrôler les émissions fugitives pendant le broyage et le transfert du minerai;
- déplacer les résidus historiques de manière à réduire le rejet de poussières diffuses.
- Mettre en œuvre les principales mesures d'atténuation définies dans l'encadré 7.1-1 relativement à la qualité de l'eau, les poissons et leur habitat, afin de réduire l'exposition aux métaux par contact avec l'eau et par ingestion, et de réduire la bioaccumulation chez les poissons.
Mesures d'atténuation visant à pallier la réduction de la capacité de récolter des ressources de subsistance
- Mettre en œuvre les mesures d'atténuation définies dans l'encadré 7.1-1 relativement aux poissons et à leur habitat, qui protégeraient l'habitat, la population et la santé des poissons.
- Mettre en œuvre les mesures d'atténuation définies dans l'encadré 7.3-1 relativement à l'accès et à la remise en état progressive de la zone de développement du projet.
Encadré 7.4-2. Programme de suivi recommandé pour la santé et sur les conditions socioéconomiques
Mesures du programme de suivi pour pallier l'exposition aux contaminants de l'air et de l'eau
- Élaborer et mettre en œuvre les mesures du programme de suivi liées à la santé des peuples autochtones afin de vérifier l'exactitude des prévisions de l'évaluation environnementale concernant la qualité de l'air et de déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation. Le faire, en consultation avec les groupes autochtones, dans le cadre du plan de communication et de mobilisation présenté dans l'encadré 7.3-2, et inclure des mesures pour surveiller à tout le moins les éléments suivants :
- les matières particulaires de moins de 10 micromètres de diamètre (PM10), aux endroits dedans des zones utilisées par les groupes autochtones aux fins traditionnelles, ou dans des zones représentatifs de la qualité de l'air dans des zones utilisées par les groupes autochtones aux fins traditionnelles, pendant la construction, l'exploitation et la désaffectation, en temps réel;
- les particules totales en suspension (incluant l'analyse des métaux en trace), les matières particulaires fines (PM2,5) et le dioxyde d'azote, aux mêmes endroits, pendant la construction, l'exploitation et la désaffectation, et à une fréquence suffisante pour comprendre les tendances temporelles concernant les taux de concentration de ces contaminants (au moins une fois par mois);
- le benzène et le benzo[a]pyrène en suspension dans l'air aux mêmes endroits, pendant la construction et pendant au moins les deux premières années d'exploitation, au moins une fois par année, afin de confirmer les conditions de fond dans la zone d'évaluation locale et la contribution des activités du projet;
- la teneur en limon des routes sur le chantier afin de confirmer que les hypothèses formulées dans l'évaluation environnementale pour le modèle de la qualité de l'air sont acceptables.
- Mettre en œuvre les mesures du programme de suivi définies dans l'encadré 7.1-2 relativement à la qualité des eaux de surface.
- Élaborer et mettre en œuvre les mesures du programme de suivi liées à la santé des peuples autochtones, en consultation avec les groupes autochtones, dans le cadre du plan de communication et de mobilisation présenté dans l'encadré 7.3-2, qui comprennent, au minimum, la surveillance trimestriel pendant la construction et les cinq premières années de l'opération, après lequel, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités pertinentes, d'autre surveillance pourrait être nécessaire :
- le mercure dans l'affluent du bras sud-ouest afin de vérifier les prévisions de l'évaluation environnementale selon lesquelles les concentrations ne dépasseraient pas 0,04 microgramme par litre;
- le méthylmercure dans l'affluent du bras sud-ouest, afin de vérifier la prévision de l'évaluation environnementale selon laquelle les concentrations ne dépasseraient pas 0,000 1 microgramme par litre.
- Élaborer et mettre en œuvre les mesures du programme de suivi pour vérifier l'exactitude des prévisions de l'évaluation environnementale quant aux aliments traditionnels et pour déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation, pour ce qui est aux effets environnementales négatifs sur la santé des peuples autochtones du aux changements dans les concentrations des contaminants dans les aliments traditionnels qui sont causés par le projet. Le faire, en consultation avec les groupes autochtones, dans le cadre du plan de communication et de mobilisation figurant à l'encadré 7.3-2, et identifier les espèces de plantes, de poissons et d'animaux qu'il faut surveiller, ainsi qu'un protocole pour le prélèvement d'échantillons de plantes ou de tissus. Inclure des mesures pour surveiller à tout le moins les éléments suivants, avec la participation des groupes autochtones et au moins à toutes les deux ans, après lequel, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités pertinentes, d'autre surveillance pourrait être nécessaire :
- les tissus provenant du doré jaune, afin de vérifier les changements dans les concentrations de mercure, de méthylmercure et d'arsenic;
- les petits mammifères, afin de vérifier les concentrations présumées utilisées dans les prévisions et pour vérifier les changements des concentrations de métaux.
- Participer à toute initiative régionale qui est établi pour l'analyse de contaminants dans le tissus de l'orignal, s'il y a une telle initiative pendant la construction ou les opérations du projet.
7.5 Peuples autochtones – patrimoine physique ou culturel
Le projet pourrait avoir des effets résiduels sur le patrimoine naturel ou culturel autochtone, par la perte ou la modification des habitats de nidification du pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus), une espèce importante sur le plan culturel.
L'Agence est d'avis que le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets négatifs importants sur le patrimoine naturel et culturel autochtone, compte tenu des principales mesures d'atténuation proposées (encadré 7.5-1). L'Agence recommande des mesures de programme de suivi (encadré 7.5-2) afin de déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation proposées pour réduire au minimum le déplacement et la mortalité du pygargue à tête blanche découlant des activités du projet.
Les conclusions de l'Agence sont fondées sur son analyse de l'évaluation du promoteur ainsi que sur les opinions exprimées par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario et les groupes autochtones.
Description de l'environnement actuel
Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland et la Première Nation de Ginoogaming ont déclaré que le pygargue à tête blanche est une espèce qui revêt une importance culturelle. Les pygargues à tête blanche nichent dans divers habitats présentant des arbres matures à proximité de grands plans d'eau et cours d'eau. On a observé des pygargues à tête blanche en nidification et en quête de nourriture dans la zone de développement du projet (figure 1), ainsi que dans les zones d'évaluation locale et régionale, et les groupes autochtones les observent fréquemment le long des rives des lacs. Deux nids de pygargue à tête blancheNote de bas de page 48 ont été détectés par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario dans la zone d'évaluation locale :
- nid no271 : 150 mètres à l'est de la zone de développement du projet, au sud de l'affluent du bras sud-ouest près de la rive du lac Kenogamisis;
- nid no487 : 650 mètres au sud de l'emplacement proposé pour l'installation de gestion des résidus.
7.5.1 Perte ou modification de l'habitat de nidification du pygargue à tête blanche
Évaluation des effets par le promoteur et mesures d'atténuation et de surveillance
La perte directe et indirecte de l'habitat de nidification et d'alimentation causée par le défrichage, les perturbations sensorielles et la poussière pourrait pousser les pygargues à tête blanche à éviter l'habitat touché. D'après la cartographie de l'écosite de la zone d'évaluation régionale, environ 2 % (2 474 hectares) de l'habitat de nidification possible du pygargue à tête blanche sera perdu en raison de l'enlèvement direct de la végétation ainsi que d'effets indirects, notamment la perturbation sensorielle.
Il est prévu que les pygargues à tête blanche évitent la zone de développement du projet pendant la construction, l'exploitation et la désaffectation, ce qui entraînera leur déplacement vers d'autres parties des zones d'évaluation locale ou régionale. Même avec la remise en état progressive de la zone de développement du projet pendant l'exploitation et la désaffectation (encadré 7.2-1), environ 1 % de l'habitat de nidification possible du pygargue à tête blanche dans la zone d'évaluation régionale serait perdu parce qu'il faudra plusieurs décennies avant que des arbres matures de nidification repoussent dans la zone de développement du projet.
Un plan de protection serait élaboré en consultation avec les contrôleurs environnementaux des groupes autochtones pour les nids de pygargue à tête blanche observés à moins de 800 mètres de la zone de développement du projet, à partir des lignes directrices provincialesNote de bas de page 49. Le plan de protection comprendrait des restrictions sur le défrichage et l'accès des humains à moins de 400 mètres des nids actifs de pygargue à tête blanche pendant la période de reproduction cruciale (c.-à-d. du 1er mars au 31 août). On maintiendrait le couvert forestier, les perchoirs et les lignes de visibilité à moins de 800 mètres des nids actifs de pygargue à tête blanche, dans la mesure du possible, et une zone tampon végétalisée autour du lac Kenogamisis. Les activités du projet qui pourraient entraîner l'enlèvement d'un nid de pygargue à tête blanche seraient menées conformément aux règlements provinciauxNote de bas de page 50, avec la participation des groupes autochtones. La zone de développement du projet, ainsi qu'une zone tampon de 800 mètres autour, serait également surveillée pour détecter la présence de nids de pygargue à tête blanche pendant la construction et l'exploitation.
Opinions exprimées
Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland, la Première Nation de Ginoogaming et la Nation métisse de l'Ontario ont demandé à participer davantage aux relevés des nids de pygargue à tête blanche, à être consultées si d'autres nids sont repérés et à participer à l'élaboration de tout plan de protection du pygargue à tête blanche. Le promoteur s'est engagé à consulter les contrôleurs environnementaux autochtones au sujet des pygargues à tête blanche.
Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland et la Première Nation de Ginoogaming ont demandé au promoteur de créer un habitat de nidification artificiel pour le pygargue à tête blanche si on trouve des nids abandonnés à proximité du projet. Le promoteur a indiqué qu'il pourrait y avoir des options pour la création d'un habitat de nidification de pygargue à tête blanche dans la zone d'étude du projet pendant la désaffectation et l'abandon, dans le cadre des plans revégétalisation.
Analyse et conclusion de l'Agence
L'Agence est d'avis qu'après avoir pris en compte la mise en œuvre des principales mesures d'atténuation décrites à l'encadré 7.5-1, le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets importants sur le patrimoine naturel ou culturel autochtone en raison de la perte ou de la modification de l'habitat de nidification du pygargue à tête blanche. L'Agence reconnaît que le pygargue à tête blanche est une espèce revêtant une importance culturelle pour Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland et la Première Nation de Ginoogaming. Par conséquent, l'Agence est d'avis que l'engagement du promoteur à collaborer avec le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario et les groupes autochtones, en particulier Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland et la Première Nation de Ginoogaming, à la protection de l'habitat de nidification du pygargue à tête blanche, et l'obligation de se conformer aux règlements provinciaux6 permettront de réduire au minimum la perte ou la modification de l'habitat de nidification du pygargue à tête blanche. L'Agence recommande, en consultation avec le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario, de mettre en œuvre des mesures d'atténuation et un programme de suivi pour évaluer les effets des activités du projet sur le pygargue à tête blanche pendant la construction et l'exploitation (encadrés 7.5-1 et 7.5-2).
Compte tenu des mesures d'atténuation proposées et de la définition des critères d'évaluation des effets environnementaux figurant à l'annexe A, l'Agence est d'avis que les effets sur le patrimoine culturel découlant de la perte ou de la modification de l'habitat du pygargue à tête blanche seraient de faible ampleur parce que l'habitat demeurerait relativement inchangé et que l'activité associée à l'élément et sa valeur relative ne seraient pas touchées, et d'une étendue géographique modérée, car elle se limiterait à la zone d'évaluation locale. L'effet serait continu et de longue durée, étant donné qu'il durerait jusqu'à la fermeture. L'effet sur l'habitat du pygargue à tête blanche est considéré comme partiellement réversible, car la remise en état de son habitat de nidification s'étendrait sur plusieurs décennies après la désaffectation, et le moment serait modéré, car tout défrichage se déroulerait entre les saisons de reproduction (de septembre à février) pour le pygargue à tête blanche. Le contexte écologique et social de la perte et de la modification de l'habitat du pygargue tête blanche est modéré, puisqu'il s'agit d'une espèce revêtant une importance culturelle pour plusieurs groupes autochtones.
Encadré 7.5-1. Principales mesures d'atténuation des effets sur le patrimoine physique ou culturelle
Mesures d'atténuation des effets sur la perte ou modification de l'habitat de nidification du pygargue à tête blanche
- Consulter les groupes autochtones, dans le cadre du plan de communication et de mobilisation présenté dans l'encadré 7.3-2, pour élaborer un plan de protection du pygargue à tête blanche. Pour ce faire, entreprendre des relevés du pygargue à tête blanche dans un rayon de 800 mètres de la zone de développement du projet entre le 1er mars et le 31 août. Réaliser les relevés avant la construction et chaque année pendant la construction jusqu'à ce que toute la préparation du site, y compris le défrichage, soit terminée dans la zone de développement du projet. Le plan devrait à tout le moins comprendre des dispositions visant à faire ce qui suit :
- aviser les groupes autochtones si des nids de pygargue à tête blanche sont découverts à moins de 800 mètres de toute zone qui serait perturbée par le projet;
- imposer des restrictions sur la préparation du site, y compris le défrichage, et l'accès des humains à moins de 400 mètres des nids actifs de pygargue à tête blanche pendant la période de reproduction cruciale (c.-à-d. du 1 mars au 31 août);
- interrompre les travaux, au moins pendant la période de reproduction cruciale, jusqu'à l'élaboration d'un protocole de mise en œuvre avec les groupes autochtones.
7.6 Effets transfrontaliers – émissions de gaz à effet de serre
Le projet pourrait entraîner des effets transfrontaliers résiduels attribuables aux émissions de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre sont des gaz atmosphériques qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge causant le réchauffement des couches inférieures de l'atmosphère. Ces gaz se dispersent à l'échelle mondiale et sont considérés aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) comme des effets environnementaux transfrontaliers. Les principaux gaz à effet de serre sont le dioxyde de carbone, le méthane, l'oxyde nitreux, l'hexafluorure de soufre, l'ozone, les hydrurofluorurocarbones et les perfluorocarbones. Les estimations de gaz à effet de serre sont habituellement exprimées en tonnes d'équivalent dioxyde de carboneNote de bas de page 51 par année. Depuis 2017, les projets qui émettent plus de 10 kilotonnes (10 000 tonnes) d'équivalent dioxyde de carbone par année sont tenus de déclarer leurs niveaux d'émissions à Environnement et Changement climatique Canada. L'Agence est d'avis que le projet n'est pas susceptible d'avoir des effets transfrontaliers importants attribuables aux émissions de gaz à effet de serre.
7.6.1 Émissions de gaz à effet de serre
Évaluation des effets environnementaux par le promoteur et mesures d'atténuation et de surveillance
Les gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane et oxyde nitreux) émis durant la construction seraient attribuables au brûlage du diesel par l'équipement de terrassement et l'équipement servant à la construction des éléments du projet. Les émissions annuelles de gaz à effet de serre attribuables à la construction du projet sont estimées à 103 kilotonnes d'équivalent dioxyde de carbone réparties sur une période de deux ans et cinq mois.
Les émissions de gaz à effet de serre durant l'exploitation comprendraient la combustion de carburant provenant de l'équipement d'extraction et de forage, de camions lourds, de bouteurs, de niveleuses et d'excavatrices; la combustion de gaz naturel dans la centrale d'alimentation et de sources de combustion fixes (y compris les pompes d'assèchement et le processus de régénération du carbone).
Toutes les émissions calculées pendant l'exploitation seront de catégorie 1Note de bas de page 52. Aucune émission de catégorie 2 ne serait produite, car les émissions découlant de la consommation d'électricité sont incluses dans le total annuel des émissions, étant donné que la centrale d'alimentation présente sur le site est la source de ces émissions et que celles-ci sont considérées comme des émissions directes. Les émissions de catégorie 3 n'ont pas été prises en compte.
Les émissions annuelles maximales de gaz à effet de serre pendant le scénario d'exploitation quotidienne maximale seraient de 249,6 kilotonnes d'équivalent dioxyde de carboneNote de bas de page 53. Les émissions directes totales représenteraient environ 0,151 % des émissions totales de gaz à effet de serre de l'Ontario pour l'année de déclaration 2014. Le tableau 9 présente une ventilation des émissions de gaz à effet de serre du projet prévues pendant l'année d'exploitation maximale.
| Description de la source | Estimation des émissions de gaz à effet de serre (kilotonne par an) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Dioxyde de carbone | Méthane | Oxyde nitreux | Total des émissions d'équivalent dioxyde de carbone | |
| Processus de combustion du gaz naturel – Centrale électrique | 137,9 | 0,002 70 | 0,002 41 | 138,7 |
| Processus de combustion du gaz naturel – Flotte de véhicules miniers alimentés au gaz naturel liquéfié et régénération du carbone | 24,7 | 0,000 484 | 0,000 432 | 24,9 |
| Flotte et équipement miniers | 77,0 | 0,004 23 | 0,027 7 | 85,4 |
| Autres véhicules et appareils de combustion fixes | 0,67 | 0,000 035 6 | 0,000 018 9 | 0,7 |
| Total | 240,3 | 0,007 45 | 0,030 5 | 249,6 |
La perte de séquestration forestière du carbone causée par le déboisement du site du projet est estimée à neuf kilotonnes d'équivalent dioxyde de carbone par an, à supposer que l'entièreté de la zone de développement du projet était boisée puis rasée. Il s'agirait d'une perte négligeable de puits de carbone par rapport à la capacité totale estimée de stockage de carbone dans les arbres de l'Ontario d'environ 322 800 kilotonnes d'équivalent dioxyde de carbone par an.
Les mesures d'atténuation visant à réduire les émissions de contaminants atmosphériques (section 6.1.1) contribueraient également à réduire les émissions de gaz à effet de serre. De plus, des moteurs électriques à haut rendement énergétique seraient utilisés tout au long du projet. Une politique interdisant la marche au ralenti des véhicules permettrait d'éviter les émissions de gaz à effet de serre inutiles. Pendant l'exploitation, la centrale d'alimentation au gaz naturel fournira une source d'électricité efficace émettant peu de gaz à effet de serre. Des carburants de remplacement à faibles émissions et moins polluants que les carburants classiques, comme le gaz naturel liquéfié servant à alimenter l'équipement et les véhicules, seront utilisés dans la mesure du possible.
La surveillance et la déclaration des émissions se feraient conformément aux exigences fédérales et provincialesNote de bas de page 54. Un plan de gestion des gaz à effet de serre serait mis en œuvre pour le projet, conformément au Code de pratiques écologiques pour les mines de métaux d'Environnement et Changement climatique Canada.
Analyse et conclusions de l'Agence
Après avoir pris en considération la mise en œuvre des mesures d'atténuation, l'Agence est d'avis que le projet n'aurait probablement pas d'effet transfrontalier important attribuable aux émissions de gaz à effet de serre. L'Agence fait remarquer que les émissions de gaz à effet de serre de l'Ontario sont passées de 165 200 kilotonnes d'équivalent dioxyde de carbone pour l'année de déclaration 2014 à 160 600 kilotonnes d'équivalent dioxyde de carbone pour l'année de déclaration 2016. Ainsi, le pourcentage relatif des émissions maximales annuelles prévues pour le projet serait légèrement plus élevé, soit environ 0,155 % des émissions provinciales pour l'année de déclaration 2016. L'Agence estime que la contribution relative des émissions directes découlant des activités d'exploitation du projet est de faible ampleur comparativement aux inventaires de gaz à effet de serre du Canada et l'Ontario. L'Agence n'a pas établi les principales mesures d'atténuation contre les émissions de gaz à effet de serre. L'Agence fait remarquer que le promoteur serait tenu de surveiller ses émissions de gaz à effet de serre et d'en faire rapport annuellement à Environnement et Changement climatique Canada.
Compte tenu des mesures d'atténuation proposées et des définitions des critères d'évaluation des effets environnementaux figurant à l'annexe A, l'Agence est d'avis que les émissions de gaz à effet de serre prévues dans le cadre du projet seraient de faible ampleur comparativement aux niveaux d'émissions provinciaux et nationaux.
7.7 Autres effets liés aux décisions fédérales
Conformément aux alinéas 5(2)a) et 5(2)b) de la LCEE 2012, l'Agence a pris en compte les changements et les effets de ces changements qui sont directement ou nécessairement liés à des décisions fédérales, en vertu d'autres lois, qui pourraient être requises pour le projet. L'Agence a aussi pris en compte les effets potentiels, à l'exception des effets sur le poisson et son habitat, les oiseaux migrateurs, les peuples autochtones, et les effets transfrontaliers qui ont déjà été traités dans les sections 7.1 à 7.6 du présent rapport. Les décisions fédérales qui pourraient être requises figurent dans le tableau 1.
Afin de faciliter les activités du projet décrites à la section 2.3, le promoteur a déterminé les plans d'eau et les cours d'eau (énumérés dans le tableau 7) pour lesquels il a l'intention de prendre une ou plusieurs décisions en vertu de la Loi sur les pêches et du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamantsNote de bas de page 55. La figure 13 montre l'emplacement des plans d'eau et des cours d'eau qui seraient enlevés, ainsi que les plans d'eau qui sont proposés comme mesures de compensation.
Le projet pourrait avoir des effets résiduels sur les milieux humides, notamment sur la faune qui en dépend (p. ex. les tortues et les amphibiens), attribuables aux modifications des milieux humides découlant de l'enlèvement des plans d'eau et à la modification de l'hydrologie découlant des activités du projet qui sont associées aux décisions fédérales. L'Agence est d'avis que le projet n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs importants sur les milieux humides, compte tenu des mesures d'atténuation déjà définies dans l'encadré 7.1-1 pour les poissons et leur habitat, et dans l'encadré 7.2-1 pour les oiseaux migrateurs. L'Agence recommande des mesures de programme de suivi déjà indiquées dans l'encadré 7.2-2 pour les oiseaux migrateurs afin d'évaluer l'exactitude des prévisions et de déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation proposées pour limiter au minimum les effets des activités du projet.
Les conclusions de l'Agence sont fondées sur son analyse des évaluations du promoteur ainsi que sur les opinions exprimées par Environnement et Changement climatique Canada et les groupes autochtones.
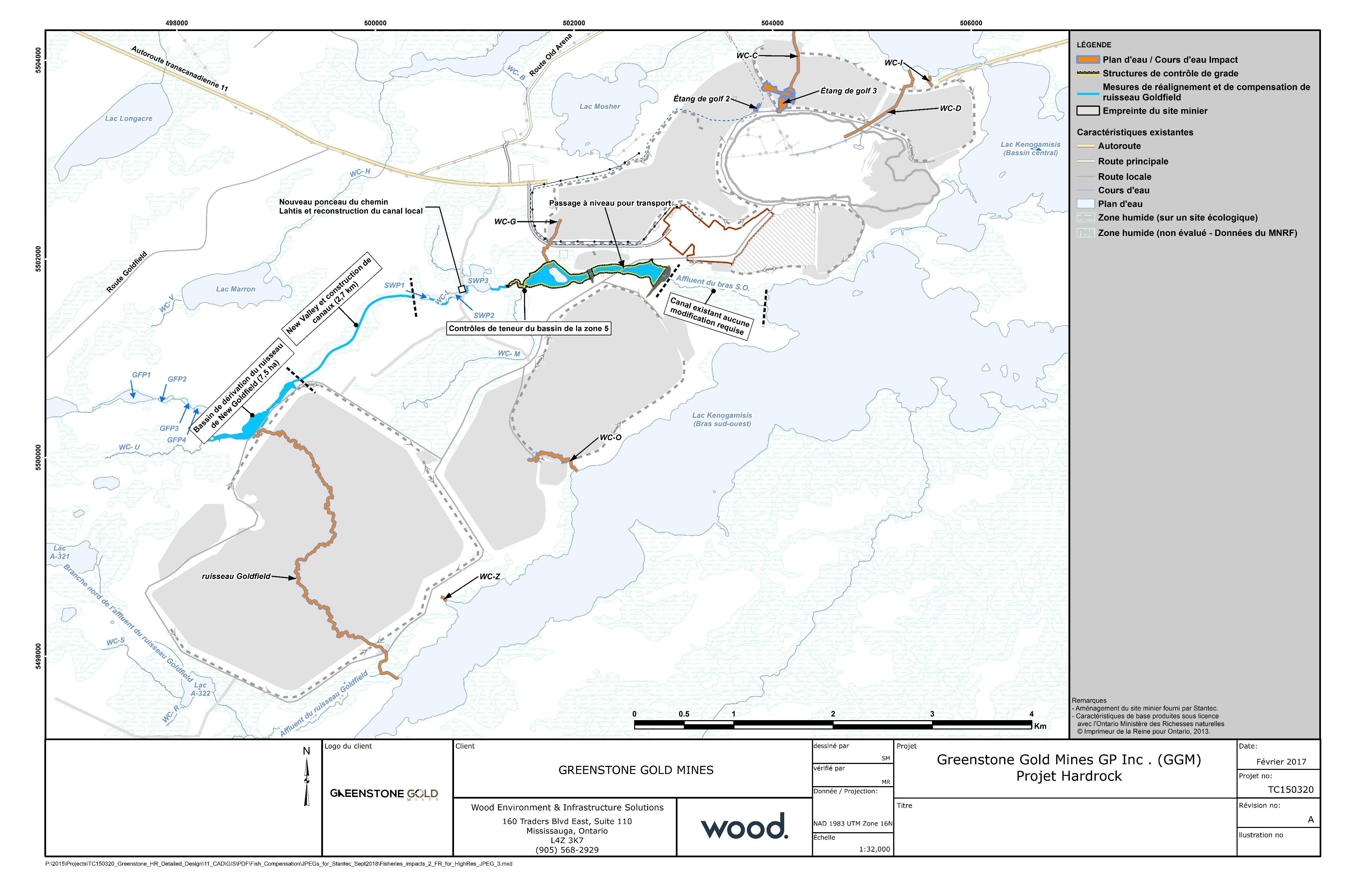
Source : Wood (anciennement Amec Foster Wheeler), février 2017.
Description de l'environnement actuel
Les milieux humides fournissent un habitat aux amphibiens, aux reptiles, aux animaux à fourrure, aux oiseaux aquatiques et aux poissons, qui pourraient être touchés par la perte et la modification des plans d'eau associés aux décisions fédérales. Comme décrit à la section 6.4, à l'encadré 6.4-1, la zone de développement du projet contient environ 2200 hectares d'habitat, dont environ 810 hectares sont un habitat de milieu humide. L'habitat dans les zones sur lesquels il serait empiété et qui seraient réaménagées comprend environ 37 hectares d'habitat, dont 5 hectares de hautes terres, 25 hectares de milieux humides, 4 hectares de zones perturbées et 3 hectares d'habitat en eau libre.
7.7.1 Modifications des milieux humides et de l'hydrologie
Évaluation des effets environnementaux par le promoteur et mesures d'atténuation et de surveillance
L'empiétement sur les plans d'eau et les milieux humides et le réalignement des cours d'eau réduiront les bassins versants des milieux humides, transformeront l'hydrologie des eaux de surface et des eaux souterraines, et modifieront la connectivité des cours d'eau et des milieux humides. La majorité des milieux humides touchés par le projet se trouveront sur les rives du lac Kenogamisis et subiront moins d'effets négatifs à la suite de modifications des niveaux des eaux souterraines et des eaux de surface, car les niveaux d'eau de ces milieux humides sont contrôlés par le lac. En ce qui concerne les milieux humides et les cours d'eau adjacents au canal de dérivation du ruisseau Goldfield, le promoteur prévoit que l'augmentation du débit, qui suivra le réalignement du cours d'eau, atténuera la réduction dans le bassin versant et le rabattement de l'eau souterraine associés à l'assèchement de la fosse à ciel ouvert (section 6.2). Les modifications du territoire, notamment aux milieux humides, sont décrites plus en détail à la section 6.4.
On prévoit que le projet dans sa globalité, qui comprendra un ensemble d'effets plus vastes que ceux liés aux décisions fédérales, entraînera le déplacement d'espèces sauvages de la zone de développement du projet vers un habitat adjacent convenable. Ce déplacement ne devrait pas entraîner d'effets résiduels mesurables sur les populations, les déplacements, la mortalité ou la répartition des animaux dans la biologie terrestre de la zone d'évaluation régionale. Les effets négatifs qui sont liés à des décisions fédérales devraient être mineurs, et ils ne sont pas traités plus en détail dans la présente section.
Les mesures d'atténuation proposées pour réduire au minimum les effets négatifs prévus sur les milieux humides comprennent la réduction de l'empreinte du projet, la restriction du défrichement à l'empreinte du projet et la réduction de l'effet du défrichement sur la végétation et les plans d'eau adjacents. Un plan de réhabilitation progressive et un plan de gestion des espèces envahissantes seraient mis en œuvre pour remettre en état l'habitat des milieux humides et la végétation indigène des milieux humides pendant l'exploitation, la désaffectation et la fermeture du projet, comme indiqué à la section 6.4. Environ 404 hectares d'habitats de milieux humides et d'eaux libres devraient être réaménagés dans l'installation de gestion des résidus, le canal de dérivation du ruisseau Goldfield, les installations de gestion de l'eau et dans d'autres zones perturbées, et la réhabilitation commencera lorsque possible durant l'exploitation.
De plus, le plan de compensation de l'habitat des poissons, comme l'exige la Loi sur les pêches Note de bas de page 56 pour les réalignements de cours d'eau, comprendrait des mesures d'atténuation déterminant les caractéristiques et les fonctions des cours d'eau actuels, notamment des milieux humides. La réhabilitation progressive des milieux humides ferait également partie du programme de surveillance requis conformément au plan de compensation de l'habitat des poissons.
Opinions exprimées
Les Premières Nations d'Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, d'Aroland et de Ginoogaming et Environnement et Changement climatique Canada ont demandé de plus amples renseignements sur la réhabilitation des milieux humides le long du canal de dérivation du ruisseau Goldfield, ainsi que leur participation à la surveillance des eaux souterraines et de surface. Ils se sont dits préoccupés par le plan visant à convertir les milieux humides organiques (p. ex. tourbières minérotrophes et ombotrophes) en milieux humides minéraux (p. ex. marais et marécages) durant la réhabilitation. Le promoteur a proposé un plan de réhabilitation progressive et s'est engagé à subventionner des contrôleurs environnementaux provenant des Premières Nations d'Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, d'Aroland et de Ginoogaming. Le promoteur a fait remarquer que la réhabilitation des milieux humides n'est pas nécessaire pour éviter des effets importants sur la faune et la flore.
Analyse et conclusion de l'Agence
Après avoir pris en considération la mise en œuvre des mesures d'atténuation, l'Agence est d'avis que le projet n'est pas susceptible d'avoir des effets importants sur les milieux humides qui sont directement ou nécessairement liés aux décisions fédérales qui pourraient être requises pour le projet.
L'Agence a tenu compte de la perte directe de milieux humides organiques et minéraux dans la zone de développement du projet et de la perte indirecte de milieux humides dans la zone d'évaluation locale biophysique attribuable aux modifications du niveau des eaux de surface et des eaux souterraines. De plus, l'Agence fait remarquer que la perte d'habitat en milieu humide, en particulier des milieux humides organiques, aura une incidence sur la fonction de l'écosystème, notamment les habitats des végétaux et des animaux, l'alimentation de la nappe souterraine, la rétention des éléments nutritifs et la filtration des contaminants dans la zone d'évaluation locale. Toutefois, des plans de compensation de l'habitat des poissons (encadré 7.1-1), de réhabilitation progressive du site (encadré 7.2-1) et de gestion des espèces envahissantes (encadré 7.3-1) seraient mis en œuvre, ce qui inclurait la réhabilitation des milieux humides. Par conséquent, l'effet du projet sur l'habitat de milieu humide est considéré comme partiellement réversible. La surveillance requise en vertu du plan de compensation de l'habitat des poissons comprend la supervision de la réhabilitation progressive des milieux humides, ce qui est pris en compte dans le programme de suivi des oiseaux migrateurs à l'encadré 7.2-2.
Compte tenu des mesures d'atténuation proposées, des définitions précisant les critères d'évaluation des effets sur l'environnement à l'annexe A, l'ampleur de la perte de milieux humides est jugée modérée, car les effets résiduels sur l'abondance et la répartition des milieux humides dans les zones d'évaluation locale et régionale se situent bien en deçà de la capacité d'adaptation prévue des écosystèmes de milieux humides à l'autosuffisance. L'étendue géographique serait modérée, puisque la perte d'habitat et la modification de sa qualité et de sa fonction se limiteront à la zone d'évaluation locale. La perte de milieux humides serait à longue durée et à fréquence continue, puisque les effets se poursuivraient au-delà de la fermeture du projet. Les effets seraient considérés comme partiellement réversibles en raison de la réhabilitation des milieux humides.
8. Autres effets pris en compte
8.1 Effets du projet sur les espèces en péril
Le paragraphe 79(2) de la Loi sur les espèces en péril exige que l'Agence détermine les effets nocifs éventuels sur les espèces sauvages énumérées à l'annexe 1 de la Loi ou sur leur habitat essentiel. L'Agence doit également veiller à ce que des mesures soient prises pour éviter ou atténuer les effets négatifs sur les espèces en péril et à ce que les programmes de surveillance et de suivi à mettre en œuvre soient pris en compte si le projet va de l'avant. Les mesures doivent être conformes aux programmes de rétablissement et aux plans d'action applicables.
L'Agence est d'avis que le projet n'est pas susceptible d'avoir des effets néfastes sur les espèces en péril, compte tenu des principales mesures d'atténuation et des programmes de surveillance décrits pour les oiseaux migrateurs à la section 7.2 et pour l'utilisation autochtone à la section 7.3.
Les conclusions de l'Agence sont fondées sur son analyse des évaluations du promoteur ainsi que sur les opinions exprimées par Environnement et Changement climatique Canada, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario et les groupes autochtones.
Pour les besoins de la présente évaluation, l'Agence définit l'expression « espèces en péril » comme l'ensemble des espèces qui figurent à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril ou que le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada considère comme en voie de disparition, menacées ou préoccupantes.
Évaluation des effets environnementaux par le promoteur et mesures d'atténuation et de surveillance
Neuf espèces en péril ont été repérées dans la zone d'évaluation régionale (tableau 10). Sept espèces d'oiseaux migrateurs et deux mammifères ont été cernés. Aucune espèce de poisson ou de plante désignée comme espèce en péril aux termes de la Loi sur les espèces en péril du gouvernement fédéral ne devrait être touchée par le projet. L'évaluation dans cette section est axée sur la perte directe et indirecte de l'habitat. Les effets du projet sur les espèces d'oiseaux migrateurs à risque sont analysés à la section 7.2.
| Espèce | Observée dans la ZEL ou la ZDP | État | ||
|---|---|---|---|---|
| Nom commun | Nom scientifique | LEP (annexe 1) | COSEPAC | |
| Oiseaux (toutes ces espèces sont des oiseaux migrateurs1) | ||||
| Hirondelle de rivage | Riparia riparia | ZDP, ZEL | Espèce menacée | Espèce menacée |
| Hirondelle rustique | Hirundo rustica | ZDP, ZEL | Espèce menacée | Espèce menacée |
| Paruline du Canada | Cardellina canadensis | ZDP, ZEL | Espèce menacée | Espèce menacée |
| Engoulevent d'Amérique | Chordeiles minor | ZDP, ZEL | Espèce menacée | Espèce préoccupante |
| Engoulevent bois-pourri | Antrostomus vociferous | ZEL | Espèce menacée | Espèce menacée |
| Pioui de l'Est | Contopus virens | ZDP, ZEL | Espèce préoccupante | Espèce préoccupante |
| Moucherolle à côtés olive | Contopus cooperi | ZDP, ZEL | Espèce menacée | Espèce préoccupante |
| Mammifères | ||||
| Petite chauve-souris brune | Myotis lucifugus | ZDP, ZEL | Espèce en voie de disparition | Espèce en voie de disparition |
| Chauve-souris nordique | Myotis septentrionalis | ZDP, ZEL | Espèce en voie de disparition | Espèce en voie de disparition |
|
ZDP = zone de développement du projet; ZEL = zone d'évaluation locale. LEP = Loi sur les espèces en péril; COSEPAC = Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. 1 Au sens de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. |
||||
La petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) hibernent dans des gîtes d'hibernation froids et humides comme des grottes ou des galeries de minesNote de bas de page 57. La petite chauve-souris brune construit des pouponnières dans des bâtiments ou des arbres de grand diamètre en été. Elle trouve sa nourriture près des plans d'eau et des cours d'eau, ainsi qu'en bordure des forêts et dans des clairières. La chauve-souris nordique occupe rarement des structures artificielles pour se percher, préférant les gros arbres. Elle trouve sa nourriture dans les clairières.
La petite chauve-souris brune et la chauve-souris nordique ont été recensées dans la zone de développement du projet et la zone d'évaluation locale, mais les gîtes d'hibernation et de maternité n'ont pas été trouvés. Les sites de mise bas (arbres, crevasses rocheuses, bâtiments, dortoirs à chauves-souris) et les gîtes d'hibernation (grottes, mines ou bâtiments) sont les principales caractéristiques limitatives de l'habitat de la petite chauve-souris brune et de la chauve-souris nordiqueNote de bas de page 58.
Durant la construction, environ 268 hectares d'habitat potentiel seraient défrichés dans la zone de développement du projet, et 155 hectares supplémentaires d'habitat potentiel dans la zone d'évaluation locale seraient modifiés en raison de la production de bruit et de poussière, ce qui entraînerait un déplacement vers les zones d'évaluations locale ou régionale des espèces à la recherche de nourriture et d'un abri pendant la construction, l'exploitation et la désaffectation.
Afin d'atténuer les effets négatifs prévus du projet, on limiterait la perte d'habitat en réduisant le plus possible la superficie de la zone de développement du projet (encadré 7.2-1). De plus, un plan de réhabilitation graduelle serait mis en œuvre pour reverdir les zones défrichées pendant l'exploitation, la désaffectation et la fermeture du projet, comme indiqué dans les sections 6.4 et 7.2. Environ 93 % de l'habitat potentiel de gîte de maternité perdu pendant les activités du projet sera remis en état lors de la désaffectation, ce qui entraînerait une perte finale de 0,1 % de l'habitat naturel de gîte de maternité des chauves-souris dans la zone d'évaluation régionale pendant la fermeture.
La construction du projet éliminera également les bâtiments existants dans la zone de développement du projet qui peuvent possiblement servir de gîtes de maternité anthropiques pour les chauves-souris. Il est peu probable qu'il y ait un effet important sur la petite chauve-souris brune et la chauve-souris nordique, car il existe des bâtiments dans la zone d'évaluation régionale qui peuvent possiblement servir de gîte de maternité anthropique pour les chauves-souris.
Opinions exprimées
La Première Nation d'Aroland a demandé au promoteur de réaliser d'autres relevés des espèces en péril dans les affluents du ruisseau Goldfield et du bras sud-ouest, ainsi que d'autres relevés de gîte de la petite chauve-souris brune et de la chauve-souris nordique dans la zone de développement du projet et la zone d'évaluation locale. Le promoteur a effectué d'autres relevés des espèces sauvages et a indiqué que les affluents du ruisseau Goldfield et du bras sud-ouest sont des zones d'hivernage possibles pour les tortues nicheuses. De plus, une seule observation de la petite chauve-souris brune le long du ruisseau Goldfield a été enregistrée.
Environnement et Changement Climatique Canada a soulevé des préoccupations que le prélèvement d'eau souterraine pourrait inadvertamment ouvrir des portions de la mine souterraine historique à la Petite chauve-souris brune et la Chauve-souris nordique et créer de l'habitat hivernal, qui serait ensuite détruit quand ces portions de la mine seraient inondés. Le promoteur s'est engagé à fermer toutes les entrées aux portions souterraines de la mine historique avant le début du prélèvement d'eau souterraine.
Analyse et conclusion de l'Agence
L'Agence a déterminé que les mesures que le promoteur mettrait en œuvre et les principales mesures d'atténuation décrites à la section 7.2 visant à réduire les effets négatifs sur les oiseaux migrateurs réduiraient également les effets négatifs sur la petite chauve-souris brune et la chauve-souris nordique. La fermeture de toutes les ouvertures des puits de mine avant toute activité de rabattement, au bon temps, serait aussi une mesure préventive pour réduire les effets négatifs sur la petite chauve-souris brune et la chauve-souris nordique. L'Agence recommande également au promoteur de tenir compte des stratégies de rétablissement et des plans d'action applicables pour les espèces en péril susceptibles d'être touchées par le projet, comme prévu dans la Loi sur les espèces en péril, en vue de réduire ou de prévenir le déclin de ces espèces43. La suppression de l'habitat d'alimentation de la petite chauve-souris brune et de la chauve-souris nordique ainsi que celle de l'éventuel habitat naturel de gîte de maternité des chauves-souris peut nuire à ces deux espèces ou les faire mourir.
8.2 Effets des accidents et des défaillances
Des accidents et des défaillances sont susceptibles de survenir à toutes les étapes du projet, ce qui pourrait entraîner des effets néfastes sur le projet et le milieu environnant. Le promoteur a décrit les effets potentiels des accidents et des défaillances liées au projet, ainsi que les mesures de prévention et d'intervention connexes. Les accidents et défaillances examinés par le promoteur comprennent la rupture de la digue de l'installation de gestion des résidus, la défaillance de la pente de l'installation de gestion des stériles, la défaillance de la zone de résidus historiques et la défaillance du canal de dérivation du ruisseau Goldfield.
Le promoteur s'est engagé à élaborer et à mettre en œuvre un plan d'intervention d'urgence qui décrit les mesures à prendre en cas d'urgences environnementale, médicale et de sécurité. Ce plan contiendrait des mesures de communication pour aviser les autorités fédérales et provinciales, les groupes autochtones et le public.
Évaluation des effets environnementaux par le promoteur et mesures d'atténuation
Rupture de la digue de l'installation de gestion des résidus
Le scénario le plus pessimiste concernant la rupture d'une digue de l'installation de gestion des résidus est la rupture complète de la digue, à la fin de l'exploitation, qui entraînerait le déversement d'une partie des résidus solides et de tous les résidus liquides. Trois lieux de rupture sont possibles : à la digue ouest ou à la digue nord de la cellule nord, ou au sud-ouest de la cellule sud.
Une rupture des digues ouest ou nord de la cellule nord augmenterait le débit dans le canal de dérivation du ruisseau Goldfield ou les cours d'eau reliés en aval, y compris le rivage du bras sud-ouest du lac Kenogamisis. Une rupture de la digue sud-ouest de la cellule sud entraînerait un déversement le long de l'affluent du ruisseau Goldfield jusqu'à l'extrémité amont du lac Kenogamisis, mais d'autres parties de la zone de développement du projet ne seraient pas inondées au-delà de ce qui est typique d'un important épisode de précipitations. Le lac Kenogamisis connaîtrait des augmentations minimales du niveau d'eau au-delà des inondations résultant de précipitations typiques.
En cas de rupture d'un barrage, Indépendamment du lieu, la détérioration de la qualité de l'eau et le dépôt de sédiments causeraient des effets à court terme comme la toxicité des poissons et des habitats de frai inappropriés en raison de l'étouffement par des résidus solides, et des effets à long terme comme la mortalité des poissons due à la pénurie alimentaire ou à la toxicité chronique. Ces effets pourraient s'étendre au-delà de la zone d'évaluation locale des poissons et de leur habitat et seraient probablement irréversibles.
Les communautés végétales locales peuvent être recouvertes de résidus solides. Une perte localisée d'habitats de la faune et des oiseaux migrateurs pourrait se produire près de l'installation de gestion des résidus, en particulier à l'emplacement de la rupture. Cette perte pourrait s'étendre à la zone d'évaluation locale. Les effets néfastes sur les oiseaux migrateurs, la faune et leurs habitats seraient à moyen terme ou à long terme et pourraient être irréversibles.
L'accès aux terres à des fins autochtones peut être entravé à la suite d'une rupture de digue. Cette restriction peut avoir une incidence sur la navigation sur les cours d'eau. Ces effets devraient être limités à la zone d'évaluation locale, à moyen et à long terme, et potentiellement irréversibles.
L'intervention initiale en cas de rupture d'une digue comprendrait les éléments suivants :
- Arrêter le pompage des résidus à l'installation de gestion des résidus;
- Signaler l'incident aux autorités, aux intervenants d'urgence, aux résidents locaux et aux groupes autochtones locaux;
- Amorcer le pompage de l'eau des résidus dans la fosse à ciel ouvert, le cas échéant;
- Déployer des rideaux de confinement dans les cours d'eau touchés;
- Déployer d'équipement de terrassement pour la réparation de la digue et l'établissement d'un confinement supplémentaire, au besoin;
- Élaborer un plan de mesures correctives et de surveillance propre à l'incident.
Plusieurs mesures de conception ont été prises pour assurer la sécurité et la stabilité de l'installation de gestion des résidus. Des structures de confinement seront construites et conçues conformément aux Recommandations de sécurité des barragesNote de bas de page 59 de l'Association canadienne des barrages et aux Recommandations de sécurité des barrages aux barrages miniersNote de bas de page 60, ainsi qu'aux exigences du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario ou du ministère de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines de l'Ontario, selon le cas.Note de bas de page 61 La digue à résidus serait conçue pour contenir la crue centenaire sans déversement, aurait un déversoir d'urgence pour déverser des plus gros crues, et pourrait résister au séisme maximum le plus crédible dans la région géographique. Des remblais d'enrochement seraient utilisés pour le périmètre des digues, de sorte que la stabilité de la digue ne dépend pas des résidus déposés. La conception du périmètre tirera également parti de la topographie naturelle du site du projet afin de contenir les résidus tout en réduisant la longueur et la hauteur de la digue.
Le promoteur s'est également engagé à ce qui suit :
- Créer un conseil d'examen indépendant des résidus miniers, composé d'experts de l'industrie minière, pour faire la revue du design de l'installation de gestion des résidus et les données du programme de suivi;
- Inspecter l'assurance de la qualité pendant la construction de l'installation de gestion des résidus;
- Élaborer un manuel d'exploitation, d'entretien et de surveillance pour faciliter la formation et l'inspection appropriée;
- Effectuer des inspections annuelles de sécurité des digues par un ingénieur géotechnique qualifié;
- Mettre en œuvre des instruments de barrage pour surveiller l'état des digues.
Défaillance de la pente de l'installation de gestion des stériles
Une défaillance à grande échelle de la pente d'une installation de gestion des stériles pourrait libérer des stériles dans la fosse à ciel ouvert, le bras sud-ouest du lac Kenogamisis ou l'affluent du bras sud-ouest. Les pentes seront conçues pour la stabilité et surveillées, de sorte que le risque de défaillance de la pente sera faible. Une défaillance de la pente à grande échelle peut faire entrer des déchets dans la zone d'évaluation locale, ce qui aurait des répercussions sur les eaux de surface, les poissons et leur habitat, ainsi que sur autochtone. Une défaillance de la pente dans le lac de kettle, pendant ou après le remplissage avec de l'eau, peut entraîner le mélange complet du lac de kettle. Les conditions d'eau stratifiée dans le lac de kettle devraient se rétablir dans l'année suivant la défaillance. Les effets de la défaillance seraient localisés, à court terme et réversibles. Dans ce scénario, la première réaction serait d'arrêter les travaux dans le secteur, d'élaborer un plan d'intervention précis et d'éliminer le plus possible les matières rejetées.
Défaillance de la zone de résidus historiques
La défaillance de la zone des résidus historiques de MacLeod non excavés pourrait causer un affaissement et une exposition localisés de ces résidus. Le contenu serait libéré, dont l'arsenic est le plus préoccupant, dans l'environnement environnant. La première réaction à la perte de cette stabilité serait d'arrêter les travaux et de sécuriser la zone, d'aviser les résidents locaux, les groupes autochtones et les intervenants d'urgence. Les résidus historiques seraient confinés, assainis, surveillés et examinés afin de réduire la probabilité de récurrence. Des travaux d'excavation seraient nécessaires en cas de défaillance subséquente. Les effets sur la qualité de l'eau, les poissons et leur habitat, et l'utilisation autochtone seraient localisés. Ces effets peuvent être à long terme et potentiellement irréversibles, en raison des effets cumulatifs des écoulements issus des résidus historiques.
Défaillance du canal de dérivation du ruisseau Goldfield
Une défaillance du canal de dérivation du ruisseau Goldfield ne serait attendue que dans le cas d'un événement de précipitation extrême. À titre de mesure de conception préventive, la conception d'un canal naturel servirait à créer un canal de dérivation qui convient le mieux à l'environnement et au climat environnants, et à répondre à un pic de débit élevé en raison d'un épisode de pluie correspondant à la crue centenaire sans déborder le barrage de dérivation au nord de l'installation de gestion des résidus. Les risques au canal de dérivation incluent l'érosion du barrage de derivation de l'installation de gestion des résidus, et le potentiel que l'eau de mine mélange avec l'eau dans le bassin M1. Dans le cas d'une rupture, des réparations seraient effectuées et des mesures compensatoires seraient mises en œuvre au besoin. Les effets pourraient s'étendre sur plusieurs centaines de mètres du canal et causer la sédimentation de l'affluent du bras sud-ouest et peut-être du bras sud-ouest du lac Kenogamisis. Des effets localisés sur les eaux de surface et les poissons et leur habitat sont possibles. Ces effets devraient être à court terme et réversibles.
Opinions exprimées
Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland, la Première Nation de Ginoogaming, la Première Nation de Long Lake no 58 et la Nation métisse de l'Ontario ont soulevé des préoccupations au sujet de l'intervention du promoteur en cas de rupture de la digue de l'installation de gestion des résidus, des effets environnementaux possibles de la rupture de ladite digue et de la possibilité que les groupes autochtones participent au processus de surveillance. Le promoteur a indiqué que la probabilité qu'une rupture de digue se produise est faible et que si une telle défaillance se produisait, les effets environnementaux pourraient être nombreux, mais particulièrement importants dans les habitats aquatiques à l'intérieur de la zone inondée. Le promoteur a fait remarquer que le plan d'intervention d'urgence comporterait la signalisation de l'incident aux groupes autochtones locaux qui utilisent les terres et les eaux touchées, ainsi qu'une consultation pour un plan d'assainissement. Une surveillance de la digue de l'installation de gestion des résidus serait effectuée pour éviter une catastrophe, et des mesures préventives de conception seraient prises pour ajouter un soutien supplémentaire à l'installation de gestion des résidus. Le plan d'intervention d'urgence et d'autres plans de surveillance ont été peaufinés et comprennent des consultations avec les Autochtones.
Environnement et Changement climatique Canada, le Ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario et le Ministère de l'Énergie, Développement du Nord et Mines de l'Ontario ont exprimés l'opinion que les effets d'une rupture de la digue de l'installation de gestion des résidus pourraient être importants, à long-terme et potentiellement irréversible, dû au volume important du déversement de résidus dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis et de la profondeur du lac. Les départements qui ont exprimé cette préoccupation acceptent que le risque d'un tel scénario soit petit, et serait de plus réduit par la création d'un conseil d'examen indépendant des résidus miniers avec des experts de l'industrie minière, auquel s'est engagé le promoteur pour faire la revue du design de l'installation de gestion des résidus et les données du programme de suivi.
Analyse et conclusion de l'Agence
L'Agence est d'avis que le promoteur a correctement recensé et évalué les types d'accidents et de défaillances qui pourraient survenir dans le cadre du projet. Le promoteur a tenu compte des risques d'accidents et de défaillances dans la conception du projet afin de les réduire le plus possible. L'Agence note en outre que le promoteur a cerné des mesures de prévention et d'intervention qui seraient décrites dans le plan d'intervention d'urgence. Bien qu'une rupture de la digue de l'installation de gestion des résidus puisse avoir des effets néfastes importants sur l'habitat aquatique, l'Agence fait remarquer qu'il est peu probable qu'un tel événement se produise compte tenu des mesures de prévention que le promoteur s'est engagé à prendre. L'Agence remarque que la création d'un conseil d'examen indépendant des résidus miniers par le promoteur pour faire la revue du design de l'installation de gestion des résidus et les données du programme de suivi réduit encore la possibilité d'une rupture de la digue de l'installation de gestion des résidus.
L'Agence a examiné les mesures proposées par le promoteur et les commentaires reçus des groupes autochtones et conclut que le projet n'est pas susceptible d'avoir des effets néfastes importants sur l'environnement découlant d'accidents ou de défaillances.
8.3 Effets de l'environnement sur le projet
En vertu de l'alinéa 19(1)h) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), l'évaluation environnementale doit prendre en compte toute modification susceptible d'être apportée au projet du fait de l'environnement, notamment du fait d'épisodes climatiques extrêmes et périodiques. Plusieurs facteurs environnementaux qui pourraient avoir un effet sur le projet, notamment le climat, les changements climatiques, les événements sismiques et les glissements de terrain, et les feux de forêt. Ces facteurs peuvent endommager les éléments du projet et augmenter la probabilité d'accidents et de défaillances (section 8.2).
Évaluation des effets environnementaux par le promoteur
Climat
Les températures extrêmes et les précipitations extrêmes, le brouillard et la visibilité, les vents et les phénomènes météorologiques extrêmes pourraient retarder les activités du projet et la livraison des matériaux, endommager les éléments du projet, et accroître la charge structurale. Des conditions de sécheresse pourraient entraîner une augmentation de la poussière dans la zone de développement du projet, une diminution de la disponibilité de l'eau pour répondre à la demande d'eau à l'usine de l'installation de traitement des résidus, et une diminution de la disponibilité de l'eau douce du bras sud-ouest du lac Kenogamisis. La diminution de la disponibilité de l'eau pourrait être compensée par une augmentation de l'assèchement des chantiers souterrains historiques et de la fosse à ciel ouvert. Des précipitations extrêmes pourraient entraîner des inondations et de l'érosion; les installations seraient conçues pour traiter l'excès d'eau en cas de conditions météorologiques extrêmes.
Des embâcles peuvent également se produire dans les structures de confinement de l'eau. Ces embâcles pourraient causer des inondations dans le milieu environnant et endommager les éléments du projet. Pour atténuer ces effets, le niveau d'entrée de la pompe pour la récupération de l'eau à l'usine serait toujours maintenu sous le niveau de formation de glace. Des pompes submersibles feront circuler les eaux relativement plus chaudes à partir des profondeurs plus élevées du bassin de résidus. Des coupe-glaces ou des brise-glaces seraient déployés, au besoin.
Changements climatiques
Les prévisions relatives aux changements climatiques pour la zone de développement du projet suggèrent une augmentation de la fréquence et de l'ampleur des phénomènes météorologiques extrêmes, une augmentation des inondations et de l'érosion, ainsi qu'une hausse des températures qui entraînerait des feux de forêt plus fréquents. Tout comme les effets du climat sur le projet, les effets des changements climatiques pourraient retarder les activités du projet et la livraison de matériaux, endommager les éléments du projet et accroître la charge structurelle. Le respect des normes et des codes de conception et de construction devrait tenir compte des conditions météorologiques extrêmes, grâce à des facteurs de sécurité intégrés visant à prévenir les dommages indus aux éléments du projet causés par de tels événements. La conception tenait compte de l'occurrence de la tempête de TimminsNote de bas de page 62, qui dépasse les critères de conception de la crue quincentennale (une chance sur cinq cents de se produire au cours d'une année donnée) recommandés par le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario pour lutter contre les changements climatiques.
Activité sismique et glissements de terrain
Le projet est considéré comme ayant une faible vulnérabilité à l'activité sismique, en raison de la faible fréquence des séismes dans la zone de développement du projet. La zone du projet se trouve également dans une région peu vulnérable aux glissements de terrain. Toutefois, pour réduire au minimum la probabilité de dommages causés par des séismes aux éléments du projet, la conception, la construction et la surveillance des digues, des structures et des bâtiments seraient effectuées conformément aux codes, recommandations et normes sismiques appropriés.
Feux de forêt
Dans des conditions sèches, un feu de forêt pourrait se propager à la zone de développement du projet, enflammer le carburant et d'autres matières inflammables et causer des explosions ainsi que la perte de l'habitat créé pendant la réhabilitation progressive. Afin de réduire au minimum la probabilité que des feux de forêt se propagent sur le site, les débris inflammables se trouvant à moins de 30 mètres des éléments du projet seront enlevés. Du personnel de lutte contre les incendies formé serait disponible pour intervenir en cas de feu.
Analyse et conclusion de l'Agence
L'Agence est de l'avis que l'environnement n'est pas susceptible de causer des effets sur le projet qui causerait des effets négatifs importants sur l'environnement. L'Agence estime que le promoteur a bien étudié l'ensemble des effets environnementaux sur le projet et que les mesures de prévention, d'atténuation et d'intervention proposées tiennent adéquatement compte des effets potentiels de l'environnement sur le projet.
8.4 Effets environnementaux cumulatifs
Les effets environnementaux cumulatifs sont définis comme les effets qu'un projet est susceptible d'avoir lorsqu'un effet résiduel agit en combinaison avec les effets d'autres projets ou activités qui ont été ou qui seront réalisées. L'évaluation des effets cumulatifs a été guidée par l'Énoncé de politique opérationnelle de l'Agence – Évaluation des effets environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)Note de bas de page 63. En vertu de la LCEE 2012, les « effets environnementaux » dont il faut tenir compte pour l'analyse des effets cumulatifs sont ceux qui se trouvent dans les secteurs de compétence fédérale décrits à l'article 5 de la LCEE 2012. Pour le projet, l'Agence a particulièrement axé son analyse sur :
- les oiseaux migrateurs;
- l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles.
Dans les sections 7.2 et 7.3, l'Agence a conclu que les effets du projet sur ces deux éléments valorisés ne sont pas importants, compte tenu des principales mesures d'atténuation et de programmes de suivi. Bien que ces effets ne soient pas importants, ils peuvent s'ajouter aux effets d'autres activités concrètes passées, présentes et futures.
L'Agence estime que le projet, combiné à des projets passés, présents ou raisonnablement prévisibles, n'est pas susceptible de produire des effets environnementaux cumulatifs et négatifs importants et qu'aucune mesure d'atténuation ou mesure du programme de suivi supplémentaire n'est requise. Pour ce faire, l'Agence a tenu compte des effets du projet, des opinions exprimées par les ministères fédéraux et provinciaux, les groupes autochtones et le public, des mesures d'atténuation proposées (chapitre 7), ainsi que des effets d'autres projets et des régimes de réglementation fédéraux et provinciaux existants.
Approche et portée définies par le promoteur
Les projets antérieurs, actuels et raisonnablement prévisibles qui pourraient interagir avec le projet ont été inclus dans l'évaluation des effets cumulatifs. Les projets et les activités pris en compte par le promoteur étaient en lien avec l'exploitation minière, la foresterie, l'infrastructure et le développement municipal. La figure 14 montre leur emplacement par rapport au projet. Les activités concrètes, chacune étant raisonnablement prévisible, retenues pour l'évaluation en fonction du potentiel d'interaction des effets environnementaux de ces activités et du projet, sont présentées au tableau 11. Le promoteur a évalué comment les effets des projets pourraient se chevaucher en tenant compte de l'étendue géographique, de la durée et du moment des effets. Dans son évaluation, il a également tenu compte des régimes réglementaires en place qui influent sur la gestion des projets.
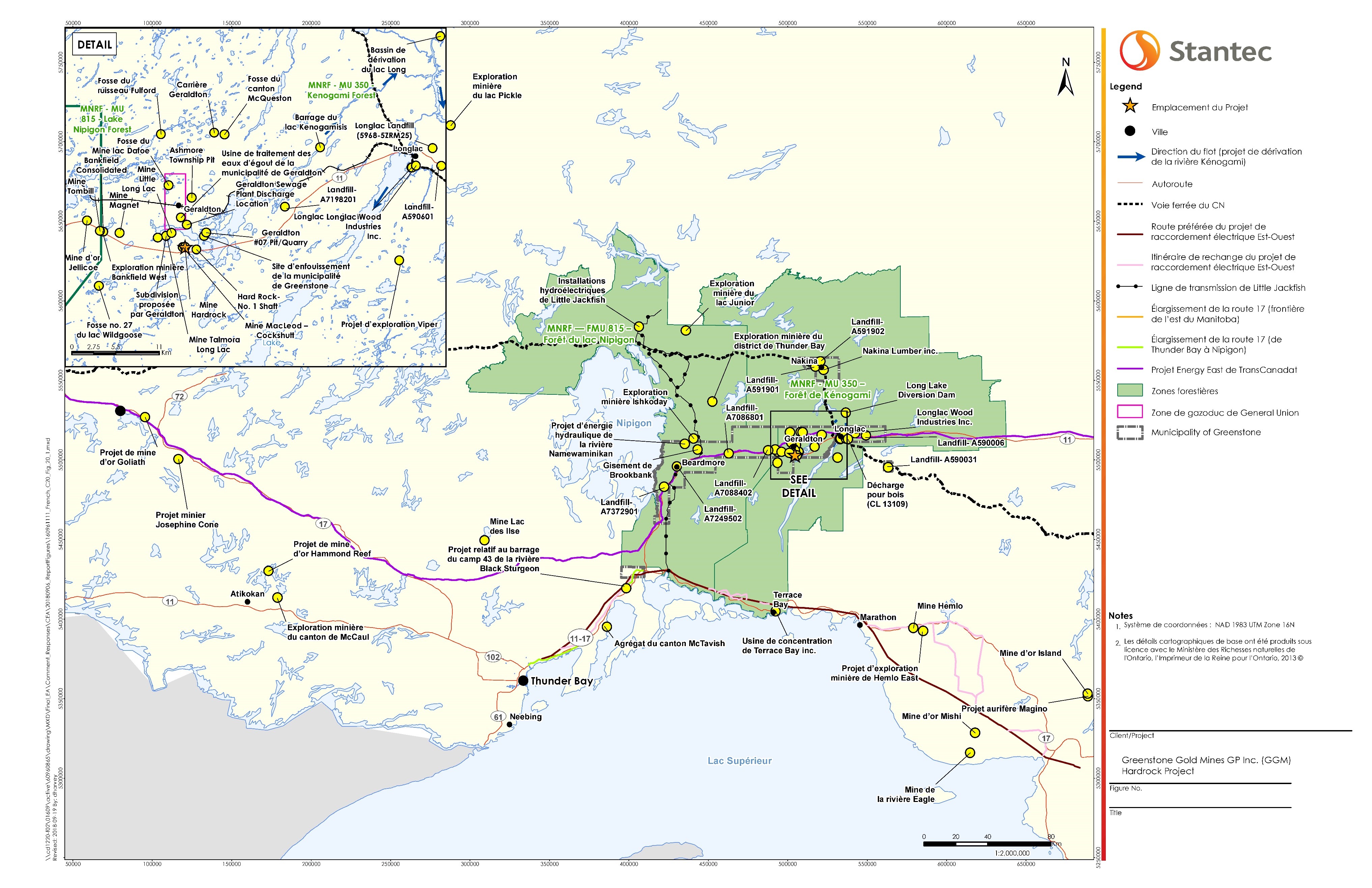
Source : Stantec, septembre 2018
| Activité concrète | Distance du projet | Description | Interaction possible avec le projet |
|---|---|---|---|
| Exploration minière de Bankfield West | 10 kilomètres à l'est du projet | Un programme de forage d'exploration, dans la zone cible de Bankfield West, pour confirmer l'occurrence de la minéralisation. | Modifications de la qualité de l'air, des communautés végétales, de la faune et de l'habitat, et des utilisations par les Autochtones. |
| Projet de lotissement de Geraldton | 2 kilomètres au nord-ouest du projet | Aménagement d'un lotissement résidentiel rural sur la rive sud du lac Kenogamisis (baie Barton) à l'ouest de Little Longlac. | Modifications de la qualité de l'air, des communautés végétales, de la faune et de l'habitat, et des utilisations par les Autochtones. |
| Lieu d'enfouissement de la municipalité de Greenstone | Indéterminé, mais à l'intérieur des limites de la municipalité de Greenstone | Le lieu d'enfouissement de la municipalité, dans le quartier de Geraldton, approche de sa capacité et un examen des options de rechange pour la gestion des déchets solides dans cette municipalité est en cours. | Modifications de la qualité de l'air et des utilisations par les Autochtones. |
| Gazoduc d'Union Gas | À environ 5 kilomètres au nord du projet | Construction d'environ 10 kilomètres de nouveau gazoduc entre une canalisation de TransCanada et le projet. | Modifications de la qualité de l'air, des communautés végétales, de la faune et de l'habitat, et des utilisations par les Autochtones. |
| Projet Énergie Est de TransCanadaNote de bas de page 65 | 10 kilomètres au nord du projet | Dans le Nord de l'Ontario, le tronçon nécessitera la conversion d'une canalisation actuelle de gaz naturel en une canalisation de transport de pétrole, ainsi que la construction des installations et des stations de pompage connexes. | Modifications de la qualité de l'air, des communautés végétales, de la faune et de l'habitat, et des utilisations par les Autochtones. |
| Ministère des Richesses naturelles et des Forêts – Unité de gestion forestière 815 – Forêt du lac Nipigon | 10 kilomètres à l'ouest du projet | Comprend 1,26 million d'hectares de terres administrées par la Couronne. La forêt se situe dans la région des forêts boréales. | Modifications de la qualité de l'air, des communautés végétales, de la faune et de l'habitat, et des utilisations par les Autochtones. |
| Ministère des Richesses naturelles et des Forêts – Unité de gestion forestière 350 – Forêt de Kenogami | Zone de développement du projet au sein de l'unité de gestion | Englobe 1,9 million d'hectares de forêt boréale du Nord de l'Ontario. | Modifications de la qualité de l'air, des communautés végétales, de la faune et de l'habitat, et des utilisations par les Autochtones. |
8.4.1 Oiseaux migrateurs
Évaluation des effets environnementaux par le promoteur et mesures d'atténuation et de surveillance proposées
Le projet, combiné à cinq activités concrètes futures (l'exploration minière de Bankfield West, l'activité forestière, le projet de lotissement de Geraldton, le projet Énergie Est de TransCanada et le gazoduc d'Union Gas), entraînerait l'élimination de l'habitat des oiseaux migrateurs dans la zone d'évaluation régionale. Les effets du projet sont détaillés à la section 7.2.3. Des habitats semblables pour les oiseaux migrateurs demeureraient accessibles ailleurs dans la zone de développement du projet, et la majeure partie de l'habitat perdu se régénérerait après les activités d'exploitation forestière.
Environ 2 % de l'habitat de reproduction des oiseaux des milieux humides non boisés et 5 % de l'habitat de nidification des oiseaux aquatiques dans la zone d'évaluation régionale (figure 5, environ 168 300 hectares) seraient éliminés en raison des effets cumulatifs du projet et des activités concrètes à venir susmentionnées. La plus grande partie de cette perte directe est attribuable au projet et à l'exploitation forestière. Toutefois, la perte associée aux activités forestières est considérée comme étant modérée parce que la législationNote de bas de page 66 et les lignes directricesNote de bas de page 67 provinciales limitent les activités forestières opérationnelles qui sont adjacentes aux milieux humides. De plus, une partie de l'habitat de milieu humide non boisé et de l'habitat de nidification des oiseaux aquatiques se rétablira avec le temps à mesure que la végétation terrestre se régénère.
Environ 11 % de l'habitat de reproduction de la paruline du Canada et 15 % de l'habitat de reproduction du pioui de l'Est dans la zone d'évaluation régionale serait éliminé en raison du projet et des activités concrètes à venir susmentionnées. La majorité des habitats de forêts des hautes terres et de milieux humides boisés propices à la reproduction se rétabliraient sur plusieurs décennies, au fur et à mesure que la succession après l'exploitation forestière et la réhabilitation des mines avancent. Tel que noté dans le tableau 8, moins que 2 % de l'habitat de la paruline du Canada et du pioui de l'Est dans la zone d'évaluation régionale serait perdue de façon permanente par suite du projet et du lotissement de Geraldton.
Le projet ainsi que les activités concrètes susmentionnées, à l'exception du projet de lotissement de Geraldton, entraîneraient la perte directe de 33 % de l'habitat de reproduction de l'engoulevent d'Amérique dans la zone d'évaluation régionale. La plus grande partie de la perte d'habitat serait attribuable au projet et aux travaux de canalisation. L'habitat de l'engoulevent d'Amérique est sous-représenté dans la cartographie de l'écosite et, par conséquent, la perte estimée dudit habitat découlant des activités concrètes futures pourrait être surestimée. De plus, les activités concrètes futures dans la zone d'évaluation régionale pourraient donner suite à un habitat propice à la nidification de cette espèce au fur et à mesure que les sites perturbés se reverdiront.
La mise en œuvre des programmes d'atténuation et de suivi décrits dans la section 7.2 réduirait au minimum la contribution du projet aux effets environnementaux cumulatifs de la perte d'habitat. Aucune autre mesure d'atténuation n'est proposée pour réduire les effets cumulatifs sur les oiseaux migrateurs.
Analyse et conclusion de l'Agence
Compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation (encadré 7.2-1) et des programmes de suivi recommandés (encadré 7.2-2), l'Agence conclut que celui-ci, en combinaison avec des projets ou activités existants ou raisonnablement prévisibles, n'est pas susceptible d'avoir des effets cumulatifs importants sur les oiseaux migrateurs.
L'Agence indique que les pratiques de gestion de l'exploitation forestière à l'échelle provinciale tiennent compte de toutes les valeurs forestières, notamment la conservation de la biodiversité ainsi que l'amélioration ou la protection de l'habitat des espèces sauvages et des bassins hydrographiques. L'Agence reconnaît aussi que le processus de gestion de l'exploitation forestière à l'échelle provinciale définit des objectifs pour les espèces indicatrices avant de déterminer les zones dans lesquelles la récolte de bois d'œuvre est permise, et des facteurs dans l'implication de terres privées, les activités minières, les lieux des ressources naturelles typiques, ainsi que les utilisations et les valeurs des terres présentant un intérêt pour les peuples autochtones. L'Agence fait remarquer que les effets cumulatifs sur la perte d'habitat des oiseaux migrateurs seraient partiellement réversibles puisque l'habitat éliminé par les activités d'exploitation forestière serait régénéré au fil du temps. L'Agence est donc d'avis qu'aucune autre mesure d'atténuation ou de programme de suivi n'est requise pour le projet.
8.4.2 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles
Évaluation des effets environnementaux par le promoteur et mesures d'atténuation et de surveillance proposées
Le projet, combiné à cinq activités concrètes présentes et futures (l'exploration minière de Bankfield West, l'activité forestière, le projet de lotissement de Geraldton, le projet Énergie Est de TransCanada et le gazoduc d'Union Gas), entraînerait une perte cumulative d'habitat terrestre et de faune dans la zone d'évaluation régionale. Comme indiqué à la section 8.4.1, des habitats de hautes terres et de milieux humides semblables demeureront accessibles ailleurs dans la zone de développement du projet, et la majeure partie de l'habitat perdu se régénérera après les activités d'exploitation forestière.
Les effets cumulatifs sur l'utilisation des espèces sauvages par les Autochtones pourraient découler des effets résiduels de la perte et de la fragmentation de l'habitat, ce qui pourrait entraîner la mortalité de la faune et le déplacement des espèces. Les activités concrètes passées ont considérablement modifié le paysage dans la zone d'évaluation régionale et, bien qu'il soit peu probable qu'elles aient eu une incidence sur la pérennité de la plupart des espèces sauvages dans la zone d'évaluation régionale, les activités concrètes futures contribueront à une perte supplémentaire d'habitat. Les populations d'orignaux ont diminué dans la zone d'évaluation régionale en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment la chasse, la prédation, les parasites et les conditions de l'habitat. Environ 7450 hectares d'habitat d'alimentation de l'orignal et environ 6938 hectares de la zone d'abri de fin d'hiver de l'orignal seraient éliminés en raison d'activités concrètes futures, ce qui représente environ 2 % de la zone d'évaluation régionale (figure 3, environ 785 400 hectares). Les orignaux déplacés en raison des activités concrètes futures trouveront probablement un habitat d'alimentation et un abri de fin d'hiver ailleurs dans la zone d'évaluation régionale. De plus, on s'attend à ce que l'habitat d'alimentation et la zone d'abri de fin d'hiver de l'orignal reverdissent après les activités d'exploitation forestière.
Le risque de mortalité des espèces sauvages associé aux effets cumulatifs dans la zone d'évaluation régionale augmenterait, et on observerait des sources persistantes supplémentaires de risque de mortalité (p. ex. la circulation routière) et des sources intermittentes à court terme (p. ex. les activités d'exploitation forestière ou de déblayage de terrain); cependant, ce risque ne devrait pas avoir d'effet sur la pérennité ou la viabilité à long terme des espèces sauvages dans la zone d'évaluation régionale.
Le projet, combiné à trois activités concrètes futures (le projet d'exploration de Bankfield West, le projet de lotissement de Geraldton et le lieu d'enfouissement de la municipalité de Greenstone) entraînerait des modifications cumulatives de la qualité de l'air. Les modifications de la qualité de l'air peuvent entraîner une réduction de la qualité de l'expérience lors de l'utilisation par les Autochtones (section 7.3.3). Toutes les activités concrètes futures susmentionnées se dérouleront dans la zone d'évaluation régionale de l'utilisation autochtone et devraient respecter les normes de qualité de l'air applicables durant leur exploitation. Comme indiqué à la section 6.1.1, la contribution du projet à la qualité de l'air sera supérieure aux conditions de référence, mais se situera principalement dans les normes de qualité de l'air applicables pour tous les contaminants, à l'exception des dépassements occasionnels des particules fines PM10 et PM2,5 dans la zone d'évaluation locale. Les effets cumulatifs sur la qualité de l'air ne devraient pas détériorer davantage la qualité de l'expérience dans la zone d'évaluation régionale.
La mise en œuvre des mesures d'atténuation et des programmes de suivi décrits aux sections 7.2 et 7.3 réduirait au minimum la contribution du projet aux effets environnementaux cumulatifs. Aucune autre mesure d'atténuation n'est proposée pour réduire les effets cumulatifs sur l'utilisation par les Autochtones attribuables aux modifications de la qualité de l'air ou de l'habitat.
Opinions exprimées
Les Premières Nations d'Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, d'Aroland et de Ginoogaming ont demandé que les autres gisements connus de la propriété de TransCanada appartenant à Greenstone Gold Mines, notamment les gisements miniers de Brookbank et de Viper, soient considérés comme des activités concrètes raisonnablement prévisibles dans l'évaluation des effets cumulatifs. Le promoteur discute de ces gisements sur son site Web et dans des documents destinés aux investisseurs. Les groupes autochtones ont également soulevé des préoccupations quant au fait que ces activités concrètes proposées pourraient se servir d'éléments du projet en cours afin de rendre celui-ci plus viable sur le plan financier, et que son utilisation n'est pas pris en compte dans l'évaluation des effets cumulatifs. Le promoteur a indiqué que les activités concrètes de Brookbank et de Viper étaient considérés comme des « activités passées et présentes », car des travaux d'exploration ont été réalisés, et que leurs effets sont déjà pris en compte dans les conditions de référence. Le promoteur a ajouté qu'il n'y a pas de plans actuels de mise en valeur de ces gisements, et que le projet est viable et planifié sans recours à d'autres gisements qu'il possède à proximité du projet.
Les Premières Nations d'Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, d'Aroland et de Ginoogaming ont exprimé des préoccupations au sujet de l'effet cumulatif de la perte d'habitat de l'orignal sur les populations de cet animal, compte tenu de la tendance à la baisse du recrutement des petits et des estimations de la densité écologique dans la zone du projet. Elles ont demandé au promoteur de mettre en œuvre un programme de surveillance de l'orignal. Le promoteur a indiqué que les habitats d'espèces sauvages sont courants et répandus dans la zone d'évaluation régionale, que la perte d'habitat attribuable au projet a été réduite au minimum grâce à la conception du projet, et que le projet ainsi que d'autres activités concrètes raisonnablement prévisibles n'auront aucune incidence sur la pérennité ou la viabilité à long terme de l'orignal. Le promoteur a également fait remarquer qu'en raison de l'étendue de l'aire de répartition des orignaux, les populations d'orignaux sont surveillées et gérées à l'échelle du paysage par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario, et non par des promoteurs privés.
Analyse et conclusion de l'Agence
Compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation et des programmes de suivi recommandés concernant les effets négatifs du projet (encadrés 7.2-1, 7.2-2, 7.3-1 et 7.3-2), l'Agence conclut que celui-ci, en combinaison avec des projets ou activités existants ou raisonnablement prévisibles, n'est pas susceptible d'avoir des effets cumulatifs importants sur l'utilisation par les Autochtones.
L'Agence fait remarquer que les contributions du projet aux effets cumulatifs sur l'habitat terrestre et de faune impliqueraient des effets localisés, tels qu'ils sont décrits aux sections 6.4, 7.2 et 7.3. Comme indiqué à la section 7.3.1, l'Agence est d'avis que la qualité des ressources utilisées par l'utilisation autochtone est abondante dans la zone d'évaluation régionale. L'Agence est d'avis que la perte globale de l'habitat de l'orignal (d'environ 2 %) dans la zone d'évaluation régionale permettrait quand même l'utilisation continue de l'habitat ailleurs dans cette même zone. L'Agence fait remarquer que toute incidence attribuable à la perte d'habitat est réversible, puisque l'habitat commencerait à se rétablir peu après la réhabilitation de la zone de développement du projet.
L'Agence a tenu compte des préoccupations soulevées par les groupes autochtones selon lesquelles les effets cumulatifs de l'exploitation minière des gisements de Brookbank et Viper devraient être pris en compte dans l'évaluation des effets cumulatifs, en particulier lorsque des éléments du projet seraient utilisés pour ces activités concrètes. L'Agence convient que ces activités concrètes ne seraient pas considérées comme certaines ou raisonnablement prévisibles en vertu de l'Énoncé de politique opérationnelle de l'Agence et ne seraient pas visées par l'évaluation des effets cumulatifs. L'Agence fait remarquer que le promoteur s'est engagé à tenir les groupes autochtones au courant de tout plan futur d'exploitation d'autres gisements lui appartenant dans la région. Elle fait également remarquer que si le ministre de l'Environnement et du Changement climatique autorise le projet avant que tout changement pouvant causer des effets environnementaux négatifs soit apporté, le promoteur serait tenu de fournir à l'Agence une description des effets environnementaux négatifs potentiels des changements proposés au projet, ainsi que les mesures d'atténuation et les mesures du programme de suivi qu'il compte mettre en œuvre. Cela comprendrait notamment une exigence selon laquelle le promoteur doit consulter les groupes autochtones et fournir à l'Agence les résultats de la consultation.
L'Agence est donc d'avis qu'aucune autre mesure d'atténuation ou de programme de suivi n'est requise pour le projet.
9. Effets sur les droits ancestraux ou issus de traités
Conformément à l'approche globale de l'Agence en matière de consultation et aux Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter (mars 2011), l'Agence a demandé à tous les groupes autochtones susceptibles d'être touchés des renseignements sur la nature de leurs droits ancestraux et issus de traités protégés en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 Note de bas de page 68 (droits ancestraux et issus de traités) et sur l'incidence possible du projet. L'Agence a tenu compte de tout nouveau renseignement provenant du promoteur au sujet des effets éventuels du projet, au fur et à mesure qu'ils émergeaient, afin de mieux comprendre la nature, la portée et l'étendue des effets négatifs sur les droits. Lorsqu'on a relevé des effets éventuels sur les droits ancestraux et issus de traités, l'Agence a tenu compte des mesures d'atténuation appropriées avant de déterminer la gravité des effets.
La présente section résume les effets que le projet est susceptible d'entraîner sur les droits ancestraux ou issus de traités. L'annexe D résume l'ensemble des préoccupations soulevées par les groupes autochtones.
9.1 Droits existants – ancestraux ou issus de traités
Le projet est situé dans la région visée par le Traité 9 (1905-1906) de l'Ontario (figure 12), qui offre des protections concernant la chasse, le piégeage et la pêche sur l'ensemble du territoire visé par le traité. Les autres utilisations traditionnelles des terres et des ressources, qui sont des droits ancestraux protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, comprennent le piégeage, la cueillette de plantes et l'utilisation des terres et des ressources à des fins culturelles. Le projet est également situé à environ 13 kilomètres de la limite de la région visée par le Traité Robinson-Supérieur (1850) (figure 12), qui offre des protections concernant la pratique de la chasse et de la pêche pour les peuples autochtones.
Le projet est situé dans une zone désignée par la Nation métisse de l'Ontario comme la zone de récolte traditionnelle Région 2 de Lakehead, Nipigon et Michipicoten. Les Métis ont réussi à établir leurs droits par l'entremise de la décision rendue par la Cour suprême dans l'affaire R. c. Powley (2003). Les Métis détiennent également des droits ancestraux protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. La Nation métisse de l'Ontario a indiqué que de nombreux citoyens métis qu'elle représente vivent et récoltent à l'intérieur des zones d'évaluation ou les utilisent beaucoup. Les citoyens de la Nation indépendante des Métis de Red Sky, qui vivent dans des collectivités de la région visée par le Traité Robinson-Supérieur et affirment qu'ils sont les descendants des 84 bénéficiaires métis de ce traité, ont également désigné certaines parties de la région visée par le Traité 9 comme étant des terres traditionnelles utilisées par la collectivité de la Nation indépendante des Métis de Red Sky.
Quatorze groupes autochtones ont été désignés aux fins de consultation pour le projet, dont cinq sont signataires du Traité 9, sept sont signataires du Traité Robinson-Supérieur et deux sont des groupes métis.
Le projet pourrait entraîner des effets environnementaux négatifs (voir les chapitres 6 et 7), ce qui pourrait également avoir des répercussions négatives sur les droits ancestraux et issus de traités liés à la pratique de la pêche, de la chasse, du piégeage et de la cueillette de plantes, ainsi que sur les pratiques culturelles des groupes autochtones. Les membres de la Première Nation d'Aroland et de la Première Nation de Ginoogaming (signataires du Traité 9), Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek et la Première Nation Long Lake no 58 (signataires du Traité Robinson-Supérieur), et la Nation métisse de l'Ontario seraient les plus susceptibles d'être directement touchées en raison de la proximité du projet par rapport à l'utilisation actuelle ou traditionnelle des terres et à la pratique des droits. Les effets éventuels comprennent l'empiétement des éléments du projet sur les sites utilisés pour la cueillette de plantes, la chasse, le piégeage, la pêche, l'enseignement et le lien culturel avec la terre, en plus des effets indirects comme la diminution de l'expérience de vie dans la nature. Ces effets particuliers sur les droits ancestraux et issus de traités sont abordés ci-dessous.
9.2 Effets négatifs éventuels du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités
Opinion du promoteur
Le promoteur a fourni de l'information sur les traités dans la région et l'utilisation autochtone par chaque collectivité. Dans le cadre de son évaluation des utilisations autochtones, de la santé, des conditions socioéconomiques, du patrimoine naturel et culturel et de la description de l'importance culturelle des activités, le promoteur a évalué les effets biophysiques du projet sur les pratiques d'utilisation traditionnelle des terres (sections 7.3, 7.4 et 7.5). À la lumière de ces évaluations, le promoteur est d'avis que le projet n'aura aucun effet important sur les droits ancestraux et issus de traités, compte tenu de ses conclusions quant aux effets sur les utilisations autochtones.
Chasse et piégeage
Opinions des groupes autochtones
Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, les Premières Nations d'Aroland, de Ginoogaming et de Long Lake no 58 et la Nation métisse de l'Ontario ont soulevé l'importance de la zone de développement du projet, de la zone d'évaluation locale et de la zone d'évaluation régionale pour l'exercice des droits ancestraux et issus de traités liés à la chasse et au piégeage. Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland et la Première Nation de Ginoogaming ont souligné l'importance de la zone de développement du projet pour la chasse à l'orignal et ont exprimé des préoccupations au sujet de la perte d'habitat de l'orignal en raison de l'empiétement par des éléments du projet et de la perte d'accès en raison du retrait du chemin Lahtis.
Un membre d'Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek possède une ligne de piégeage qui chevauche partiellement la zone de développement du projet, et les membres de la Première Nation de Long Lake no 58 détiennent trois lignes de piégeage situées dans la zone d'évaluation locale. Ces groupes autochtones ont soulevé des préoccupations quant à la capacité de leurs membres de continuer à utiliser ces lignes de piégeage. Le promoteur s'est engagé à réduire au minimum le chevauchement de la ligne de piégeage tenue par un membre d'Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek en réduisant l'empreinte de la zone de développement du projet. De plus, le promoteur s'est engagé à réduire au minimum les perturbations pour les animaux et les perturbations pour la qualité de l'expérience.
Opinions de l'Agence
Bien que le promoteur et les groupes autochtones n'aient pas formulé la plupart des commentaires ou des analyses sur la chasse et le piégeage dans une perspective axée sur les droits, l'Agence a reçu de l'information, des commentaires et des analyses sur l'utilisation et la valeur de la chasse et des espèces chassées (p. ex. orignal, martre et sauvagine) et revêtant une importance pour les groupes autochtones. L'information reçue dans le cadre de l'étude d'impact environnementale du promoteur, les demandes d'information et les commentaires reçus démontrent que le droit de chasser, y compris de piéger, pourrait être modifié par l'enlèvement de l'habitat des espèces (section 7.3.1), la perte de l'accès aux sites de chasse et de piégeage (section 7.3.2), et la perturbation des chasseurs autochtones par les changements au bruit, l'air ou le paysage visuel (section 7.3.3). L'Agence est au courant du chevauchement de la zone de développement du projet avec certaines parties d'une ligne de piégeage détenue par Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek et trois lignes de piégeage détenues par la Première Nation de Long Lake no 58 dans la zone d'évaluation locale (section 7.4.2); toutefois, le promoteur a travaillé avec les collectivités afin de réduire au minimum l'empreinte du projet et d'assurer l'accès aux zones de piégeage à proximité de la zone de développement du projet, afin d'atténuer les effets éventuels.
Une étude sur la santé de l'orignal serait mise en œuvre en collaboration avec le promoteur, Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, les Premières Nations d'Aroland, de Ginoogaming et de Long Lake no 58, la Nation métisse de l'Ontario et le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario. Le promoteur a aussi accepté de surveiller davantage les espèces sauvages de petite taille dans la zone d'évaluation locale. Le promoteur s'est également engagé à fournir une autre voie d'accès sans restriction aux zones importantes pour la chasse, en particulier au bras sud-ouest du lac Kenogamisis, situé près de la zone de développement du projet, et à maintenir l'accès au chemin Goldfield à l'ouest de la zone de développement du projet. L'Agence est d'avis que, compte tenu des mesures d'atténuation proposées et de la faible superficie perturbée (y compris les perturbations sensorielles), le projet devrait avoir de faibles répercussions sur les droits ancestraux et issus de traités des groupes autochtones concernant la chasse et le piégeage.
Pêche
Opinions des groupes autochtones
Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, les Premières Nations d'Aroland, de Ginoogaming et de Long Lake no 58 et la Nation métisse de l'Ontario ont déclaré que la pêche dans le lac Kenogamisis et les environs est une activité importante et contribue à un régime alimentaire traditionnel. Des préoccupations ont été exprimés au sujet des changements environnementaux résiduels découlant du projet sur la disponibilité et la santé des poissons dans le lac Kenogamisis et les plans d'eau environnants. Les groupes autochtones s'inquiètent depuis longtemps de la qualité de l'eau du lac Kenogamisis et de la baie Barton en raison des activités minières historiques, ce qui entraîne des préoccupations continues au sujet des effets éventuels du projet sur la qualité de l'eau dans les plans d'eau de surface de la région. Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, les Premières Nations d'Aroland, de Ginoogaming et de Long Lake no 58 ont demandé une surveillance continue de la qualité de l'eau, en particulier des concentrations d'arsenic, et la participation des membres de leurs collectivités à la surveillance. La nation métisse de l'Ontario a indiqué qu'il travaille avec le promoteur pour établir des programmes de surveillance pour le mercure dans le lac Kenogamisis, surtout à la baie Barton. De plus, la Première Nation de Long Lake no 58 a demandé au promoteur d'inclure une station de surveillance de la qualité de l'eau au lac Long, étant donné le lien entre ce lac et le lac Kenogamisis et son importance pour ses membres.
Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland et la Première Nation de Ginoogaming ont soulevé des préoccupations au sujet de l'empiétement potentiel du lac A-322 par l'installation de gestion des résidus proposée. À la suite de discussions avec le promoteur, l'installation de gestion des résidus a été déplacée vers le nord-est, afin d'éviter l'empiétement du lac et de permettre aux groupes autochtones d'y avoir accès et de continuer à l'utiliser.
Opinions de l'Agence
Le projet ne devrait pas avoir d'effet important sur la santé ou la population des poissons, et des changements à la consommation sécuritaire de tissus de poisson ne sont pas prévus (section 7.1.1). Bien que des portions du ruisseau Goldfield et plusieurs petits cours d'eau seraient en empiétement ou subiraient une réduction de débit à la suite des activités du projet, celui-ci ne devrait pas avoir d'effet important sur l'habitat des poissons (section 7.1.2). En raison de l'élimination du chemin Lahtis, l'accès au bras sud-ouest du lac Kenogamisis par le chemin Lahtis changera; toutefois, le promoteur s'est engagé à offrir une autre voie d'accès (section 7.3.2). Il pourrait également y avoir des perturbations sensorielles pour les utilisateurs des zones à proximité ou des changements perçus de la santé des poissons, ce qui pourrait dissuader les pêcheurs d'utiliser la ressource et limiterait ainsi l'exercice de leurs droits de pêche (section 7.3.3).
Le promoteur et les groupes autochtones comme Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, les Premières Nations d'Aroland, de Ginoogaming et de Long Lake no 58 et la Nation métisse de l'Ontario ont proposé de nommer des contrôleurs autochtones dans le cadre des plans de gestion et de surveillance de l'environnement. Le promoteur s'est engagé à effectuer une surveillance approfondie des eaux de surface et des tissus de poisson dans le lac Kenogamisis et dans les plans d'eau environnants, y compris à l'embouchure du lac Long. Par conséquent, l'Agence est d'avis que, en raison des mesures d'atténuation proposées et de l'élimination minimale de l'habitat des poissons, qui sera contrebalancée par un plan de compensation de l'habitat des poissons qui serait approuvé par Pêches et Océans Canada, le projet devrait avoir de faibles répercussions sur les droits ancestraux et issus de traités des groupes autochtones concernant la pêche.
Cueillette de plantes
Opinions des groupes autochtones
Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland, la Première Nation de Ginoogaming et la Nation métisse de l'Ontario ont souligné l'importance des lieux de cueillette de plantes dans la zone de développement du projet, la zone d'évaluation locale et la zone d'évaluation régionale et ont soulevé des préoccupations au sujet de la perte de l'accès à l'habitat floristique dans la zone de développement du projet (y compris le chemin Lahtis). Plusieurs groupes autochtones ont également soulevé des préoccupations au sujet de la propagation d'espèces envahissantes sur leur territoire en raison de la circulation accrue et de la présence de véhicules de l'extérieur, ainsi que de l'utilisation éventuelle d'herbicides pour éliminer les plantes indésirables. Le promoteur a accepté de donner l'occasion aux groupes autochtones de récolter des plantes dans les zones à défricher avant la construction, et il a également accepté des mesures visant à atténuer la propagation d'espèces envahissantes et à limiter l'utilisation d'herbicides à des applications localisées au besoin.
Opinions de l'Agence
Le projet entraînera des effets comme la suppression de l'habitat dans la zone de développement du projet (section 6.4.1) et des perturbations sensorielles nuisant à la capacité des groupes autochtones de récolter des plantes (section 7.3.3). Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, les Premières Nations d'Aroland, de Ginoogaming et de Long Lake no 58 et la Nation métisse de l'Ontario ont indiqué qu'elles récoltaient des plantes dans cette région, comme des baies, du riz sauvage et des plantes médicinales; cependant, aucun des groupes autochtones n'a mentionné que la région était un lieu de cueillette de prédilection. Le promoteur a proposé des mesures d'atténuation visant à permettre aux groupes autochtones touchés de récolter des plantes dans la zone de développement du projet avant la construction (section 7.3.3), à réduire au minimum les émissions de poussière (section 6.1.1), à réduire au minimum l'introduction d'espèces envahissantes dans la zone de développement du projet et à éviter l'utilisation d'herbicides dans la mesure du possible (section 6.4.2). Ces mesures devraient permettre aux groupes autochtones de poursuivre l'exercice de leurs droits de cueillette dans toute la zone d'évaluation locale et la zone d'évaluation régionale. Par conséquent, l'Agence est de l'avis que, avec les mesures d'atténuation proposées et l'abondance de sites de cueillette de plantes ailleurs dans la zone d'évaluation régionale, le projet devrait avoir de faibles répercussions sur les droits ancestraux et issus de traités des groupes autochtones concernant la cueillette de plantes.
Lien culturel et spirituel global à la terre
Opinions des groupes autochtones
Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, les Premières Nations d'Aroland, de Ginoogaming et de Long Lake no 58 et la Nation métisse de l'Ontario ont toutes souligné l'importance de la zone de développement du projet, en particulier du lac Kenogamisis, comme étant un endroit important pour la continuité de leurs droits ancestraux et issus de traités. La Première Nation de Long Lake no 58 et la Nation métisse de l'Ontario ont identifié des sites culturels à l'intérieur de la zone de développement du projet et à la limite de la zone d'évaluation locale. Les pratiques courantes des droits ancestraux et issus de traités, comme la chasse, le piégeage, la pêche et la cueillette de plantes, sont liées aux enseignements et à la transmission du savoir entre les aînés et les jeunes, aux pratiques spirituelles et culturelles et contribuent à la continuité culturell.
Le promoteur indique que leurs travaux visant à atténuer et à réduire au minimum la superficie perdue dans la zone de développement du projet ainsi qu'à assurer une autre voie d'accès aux endroits importants le long du bras sud-ouest du lac Kenogamisis permettront l'utilisation continue de sites importants et l'exercice des droits de chasse, de piégeage, de pêche et de cueillette.
Opinions de l'Agence
Le projet pourrait avoir des répercussions sur le lien culturel et spirituel global des Autochtones avec la terre, en particulier Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, les Premières Nations d'Aroland, de Ginoogaming et de Long Lake no 58 et la Nation métisse de l'Ontario, et sur l'intendance sur leurs territoires. Outre les mesures d'atténuation des changements de l'air, de l'eau, du sol et de la faune, l'engagement du promoteur à l'égard de la mobilisation, de la consultation, de la participation et de la nomination continues de contrôleurs autochtones dans le cadre du suivi et de la surveillance des éventuels effets et répercussions du projet sur les droits fera en sorte que les groupes autochtones continueront de participer à la gestion et à l'intendance continues du lac Kenogamisis et de la région environnante. De plus, son engagement à assurer une autre voie d'accès permettra aux groupes autochtones de poursuivre leurs pratiques, leurs enseignements et, au bout du compte, leur lien avec la terre. Ainsi, l'Agence est d'avis que le projet devrait avoir de faibles répercussions sur les droits ancestraux et issus de traités des groupes autochtones concernant leur lien culturel et spirituel avec la terre.
9.3 Questions à aborder à l'étape des autorisations réglementaires
L'étape des autorisations réglementaires du projet comprendra des décisions fédérales liées aux secteurs de compétence fédérale qui pourraient être nécessaires si la décision concernant l'évaluation environnementale détermine que le projet peut aller de l'avant. Celles-ci figurent à la tableau 1.
Les autorités fédérales responsables des autorisations réglementaires consulteront les groupes autochtones, le cas échéant, avant de prendre des décisions. L'Agence a présenté directement aux autorités fédérales les commentaires reçus des groupes autochtones pendant l'évaluation environnementale pour que les autorités les examinent, le cas échéant, avant de prendre leurs décisions. Les décisions prises par les autorités fédérales tiendraient compte des résultats des consultations continues avec les groupes autochtones.
L'Agence reconnaît que le projet est assujetti à une évaluation environnementale provinciale en vertu de la Loi sur l'évaluation environnementale de l'Ontario et que plusieurs autres lois provinciales et règlements, lignes directrices et politiques connexes prévoient la protection d'aspects pertinents du milieu naturel et humain. La consultation par la province, le cas échéant, sur ces autorisations aidera également les groupes autochtones à régler les problèmes.
9.4 Conclusions de l'Agence concernant les effets sur les droits des peuples autochtones
D'après l'analyse des effets environnementaux du projet sur les peuples autochtones et les mesures d'atténuation connexes décrites au chapitre 7, ainsi que des effets éventuels et des mesures d'accommodement indiqués plus haut, l'Agence juge que les effets éventuels du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités ont été déterminés de manière adéquate et que les mesures voulues d'atténuation et d'accommodement ont été prévues. L'application de mesures d'atténuation, d'accommodement et de suivi devrait permettre aux groupes autochtones de continuer d'exercer leurs droits ancestraux et issus de traités d'une manière comparable à celle avant la réalisation du projet.
10. Conclusion
Pour établir ce rapport, l'Agence a pris en considération l'étude d'impact environnemental du promoteur, ses réponses aux demandes d'information, ainsi que les points de vue des organismes gouvernementaux et des groupes autochtones.
Les effets environnementaux du projet et leurs conséquences ont été déterminés par des méthodes d'évaluation et à l'aide d'outils analytiques reflétant les pratiques couramment acceptées par les spécialistes des études environnementales et socioéconomiques, notamment pour l'évaluation des conséquences des accidents et des défaillances possibles.
L'Agence conclut que, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, le projet n'est pas susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants au sens de la LCEE 2012.
L'Agence a défini les principales mesures d'atténuation et de programmes de suivi dont elle demande à la ministre de l'Environnement et du Changement climatique de tenir compte pour établir les conditions qui feront partie de sa décision si la réalisation du projet est autorisée. En plus, l'Agence s'attend, pour que le projet sera abordé avec soin et prudence, que toutes les engagements du promoteur décrites dans le document titré "Addendum to the Environmental Impact Statement - Mitigation, Monitoring and Commitment List", et disponible en anglais sur le site internet du Registre canadien d'évaluation environnementale, seront mis en œuvre tels que proposés. L'étude d'impact environnemental du promoteur et la liste de mesures d'atténuation, de surveillance et d'engagements aborde les effets aux composantes environnementales relevant de la compétence fédérale, tels que présentés dans ce rapport, et aussi autres composantes environnementales tels que le travail et l'économie, les services communautaires, les ressources de patrimoine, et les impacts au parc provincial MacLeod. Le promoteur a conclu aucun effet négatif important pour toutes les composantes valorisées dans son étude d'impact environnemental.
11. Annexes
Annexe A – Critères d'évaluation des effets environnementaux
| Critère d'évaluation | Importance faible | Importance moyenne | Importance élevée |
|---|---|---|---|
| Ampleur | Propre à chaque composante valorisée (tableau 13). | ||
| Étendue géographique | Propre au site, dans la zone de développement du projet. | Locale, dans la zone d'évaluation locale. | Régionale, dans la zone d'évaluation régionale. |
| Durée | À court terme ou temporaire, au cours de la construction (moins de 3 ans) OU au cours d'une génération ou d'un cycle de rétablissement de la composante environnementale. Pour l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles : l'effet dure moins d'un cycle saisonnier complet (moins de 1 an). | À moyen terme, pendant l'exploitation et la désaffectation (de 3 à 20 ans) OU qui s'étend sur une ou deux générations ou sur un ou deux cycles de rétablissement de la composante environnementale. Pour l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles : l'effet s'étend sur moins d'une génération d'utilisateurs des terres (moins de 25 ans). | À long terme, jusqu'à la désaffectation et au-delà (plus de 20 ans) OU qui s'étend sur au moins deux générations ou cycles de rétablissement de la composante environnementale. Pour l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles : l'effet s'étend sur plus d'une génération d'utilisateurs des terres (plus de 25 ans). |
| Fréquence | Se produit une fois au cours d'une phase quelconque du projet. | Se produit de façon occasionnelle ou intermittente au cours d'une phase quelconque du projet. | Se produit de façon continue au cours d'une phase quelconque du projet. |
| Réversibilité | Réversible pendant la durée de vie du projet ou à la fermeture. | Partiellement réversible pendant la durée de vie du projet ou à la fermeture. | Irréversible, persistant après la fermeture. |
| Moment* | Sans conséquence; le moment des activités prévues du projet ne devrait pas avoir d'incidence sur les activités sensibles. | Moyennement important; le moment des activités prévues du projet pourrait avoir une incidence sur certaines activités sensibles. | Défavorable; le moment des activités prévues du projet aura une incidence sur certaines activités sensibles. |
| Contexte écologique et social |
Pris en compte dans l'examen des principaux critères relatifs à certaines composantes valorisées, car le contexte peut aider à mieux déterminer si les effets négatifs sont importants. Par exemple, l'information sur le contexte est utile lorsqu'elle révèle : un aspect unique du secteur (comme la proximité de parcs, de zones écologiques essentielles ou fragiles, de ressources patrimoniales précieuses); les valeurs ou coutumes propres à une collectivité qui influent sur la perception d'un effet environnemental (notamment les facteurs culturels); une composante valorisée importante pour le fonctionnement d'un écosystème, d'une communauté écologique ou d'une collectivité de personnes. |
||
|
* Le choix du moment est un facteur propre à une composante valorisée, qui s'applique aux poissons et à leur habitat, où des perturbations peuvent se produire au cours des stades sensibles du développement, et à l'usage courant des terres et des ressources, qui peut être touché de façon saisonnière par des changements environnementaux. |
|||
| Composante valorisée | Cote d'ampleur | ||
|---|---|---|---|
| Faible | Moyenne | Élevée | |
| Poissons et leur habitat | Peu ou pas d'effets sur la santé ou les populations de poissons dans le milieu récepteur. | Effet mesurable sur la santé ou les populations de poissons dans le milieu récepteur, mais qui n'en modifierait probablement pas l'état régional. | Effet mesurable sur la santé ou les populations de poissons dans le milieu récepteur qui pourrait en modifier l'état régional. |
| Oiseaux migrateurs | Peu ou pas d'effets sur les oiseaux migrateurs ou leurs habitats uniques. | Effet sur de nombreux individus ou sur des habitats uniques, mais probablement sans incidence sur l'état des populations régionales ou la disponibilité des habitats uniques. | Effet sur la plupart des oiseaux migrateurs ou des habitats uniques qui modifierait probablement l'état des populations régionales ou la disponibilité des habitats uniques. |
| Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles | L'effet modifie une activité et une utilisation par un groupe autochtone qui pourraient se pratiquer de façon identique ou semblable à la façon antérieure. | L'effet modifie les lieux ou les moyens privilégiés de pratiquer l'activité, et l'utilisation par un groupe autochtone peut être modifiée ou limitée. | L'effet produit un changement si important que l'activité ne peut plus être pratiquée par un groupe autochtone de la manière et à l'endroit qu'il préfère. |
| Santé des peuples autochtones | L'effet modifie de façon négligeable ou faible le degré d'exposition, et celui-ci n'est pas près de dépasser les normes sanitaires. | L'effet modifie le degré d'exposition de sorte que celui-ci s'approche des limites des normes sanitaires sans toutefois les atteindre. | L'effet modifie le degré d'exposition de sorte que celui-ci dépasse les limites des normes sanitaires. |
| Situation socioéconomique des peuples autochtones | Modification négligeable d'une activité en cours qui exigerait peu ou pas de modification du comportement pour continuer à la pratiquer. | Modification mesurable d'une activité en cours qui nécessiterait une certaine modification de comportement pour continuer à la pratiquer. | Modification mesurable d'une activité en cours qui empêcherait de continuer à la pratiquer. |
| Patrimoine naturel et culturel, sites et ouvrages historiques et archéologiques | L'effet modifie les conditions, mais l'élément revêtant de l'importance sur le plan du patrimoine naturel et/ou culturel demeure relativement inchangé, et l'activité associée à l'élément et sa valeur relative ne sont pas touchées. | L'effet modifie les conditions, et l'élément revêtant de l'importance sur le plan du patrimoine naturel et/ou culturel est nettement changé. L'activité et l'utilisation associées à l'élément et sa valeur seraient touchées, mais l'utilisation pourrait continuer. | L'élément revêtant de l'importance sur le plan du patrimoine naturel et/ou culturel est retiré ou détruit, et/ou l'utilisation associée à l'élément cesse. |
| Effets environnementaux transfrontaliers : émissions de gaz à effet de serre | Les émissions contribuent peu aux émissions provinciales ou nationales. | Les émissions contribuent moyennement aux émissions nationales et provinciales, mais se situent dans les limites réglementaires et sont conformes aux objectifs. | Les émissions entraînent un dépassement des normes ou objectifs nationaux et provinciaux. |
| Composantes valorisées visées au paragraphe 5(2) de la LCEE 2012 : milieux humides | Aucun effet résiduel mesurable sur l'abondance et la répartition des milieux humides. | Effet résiduel mesurable sur l'abondance et la répartition des milieux humides dans la zone d'évaluation locale, mais les changements se situent bien en deçà des limites de la capacité d'adaptation prévue des écosystèmes de milieux humides pour s'autoréguler. | Effet résiduel sur l'abondance et la répartition des milieux humides dans la zone d'évaluation locale qui s'approche des limites de la capacité d'adaptation prévue des écosystèmes de milieux humides pour s'autoréguler. |
| Ampleur* | Étendue géographique | Durée | Fréquence | Réversibilité | Importance |
|---|---|---|---|---|---|
| Moyen | Propre au site | Court terme ou moyen terme | Une fois ou intermittent | Tout niveau de réversibilité | Pas important |
| Continu | Totalement ou partiellement réversible | Pas important | |||
| Irréversible | Important | ||||
| Long terme | Tout niveau de fréquence | Totalement ou partiellement réversible | Pas important | ||
| Irréversible | Important | ||||
| Locale | Court terme | Une fois ou intermittent | Tout niveau de réversibilité | Pas important | |
| Continu | Totalement ou partiellement réversible | Pas important | |||
| Irréversible | Important | ||||
| Moyen terme ou long terme | Une fois | Tout niveau de réversibilité | Pas important | ||
| Intermittent ou continu | Totalement ou partiellement réversible | Pas important | |||
| Irréversible | Important | ||||
| Régionale | Court terme | Une fois ou intermittent | Tout niveau de réversibilité | Pas important | |
| Continu | Tout niveau de réversibilité | Important | |||
| Moyen terme | Une fois | Tout niveau de réversibilité | Pas important | ||
| Intermittent ou continu | Tout niveau de réversibilité | Important | |||
| Long terme | Tout niveau de fréquence | Tout niveau de réversibilité | Important | ||
| Élevé | Propre au site | Court terme ou moyen terme | Tout niveau de fréquence | Tout niveau de réversibilité | Pas important |
| Long terme | Tout niveau de fréquence | Totalement ou partiellement réversible | Pas important | ||
| Irréversible | Important | ||||
| Locale | Toute durée | Tout niveau de fréquence | Totalement ou partiellement réversible | Pas important | |
| Irréversible | Important | ||||
| Régionale | Toute durée | Tout niveau de fréquence | Tout niveau de réversibilité | Important | |
|
*Tous les effets d'une faible ampleur ont été considérés comme non importants, sans considération d'autres critères. |
|||||
Annexe B – Résumé de l'évaluation des effets environnementaux
| Effet résiduel | Degré prévu d'effet résiduel | Importance de l'effet résiduel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampleur | Étendue géographique | Durée | Fréquence | Réversibilité | Moment | ||
| Composante valorisée – Poissons et leur habitat | |||||||
| Mortalité et effets sur la santé des poissons |
Faible On ne s'attend pas à ce que la mortalité et les effets sur la santé de certains individus aient une incidence sur l'état régional de la santé et des populations de poissons. |
Moyenne L'effet prévu s'étendra à la zone d'évaluation locale. |
Long terme L'effet prévu s'étendra à la fermeture. |
Intermittente L'effet prévu se produira à des intervalles intermittents pendant la construction, l'exploitation et le début de la désaffectation. |
Réversible L'effet prévu sera entièrement réversible une fois les activités du projet terminées. |
D'importance moyenne Le calendrier des activités du projet peut avoir une incidence sur certaines activités sensibles du cycle de vie des poissons, comme le frai. |
Non important On s'attend à ce qu'il y ait des effets sur la mortalité et la santé de certains poissons, mais les populations de poissons à l'extérieur de la zone d'évaluation locale ne seraient pas touchées. |
| Perte et perturbation de l'habitat des poissons |
Faible 7,16 hectares d'habitat des poissons seraient perdus en raison du projet, mais cela serait contrebalancé par le plan de compensation de l'habitat. |
Moyenne L'effet prévu s'étendra à la zone d'évaluation locale. |
Moyen terme Les habitats créés selon le plan de compensation de l'habitat seraient établis avant la perte d'habitat, mais nécessiteraient du temps pendant l'exploitation pour être pleinement établis et fonctionnels. |
Continue L'effet prévu se produira de façon continue pendant la construction et une partie de l'exploitation du projet. |
Réversible Les gains prévus grâce aux habitats créés selon le plan de compensation contrebalanceraient les pertes d'habitat à long terme. |
D'importance moyenne Le moment de la perte d'habitat peut avoir une incidence sur certaines activités sensibles du cycle de vie des poissons, comme le frai. |
Non important Aucune perte nette d'habitat prévue en vertu du plan de compensation, conformément à la Loi sur les pêches. |
| Composante valorisée – Oiseaux migrateurs | |||||||
|
Exposition à des contaminants dans les éléments du projet en eau libre |
Faible Étant donné la faible probabilité de mortalité ou de dommages pour les oiseaux migrateurs. |
Faible L'effet est prévu dans la zone de développement du projet. |
Long terme L'effet prévu s'étendra à la fermeture. |
Continue L'effet prévu se produira de façon continue pendant toutes les phases du projet. |
Réversible L'effet prévu sera entièrement réversible une fois que la qualité de l'eau sera conforme aux lignes directrices. |
S. O. |
Non important Les oiseaux migrateurs ne sont pas prévues d'utiliser régulièrement les composantes à eau libre, et s'ils sont observés à le faire, des éléments dissuasif seraient mises en œuvre. |
| Risque accru de collision avec des véhicules |
Faible Étant donné la faible probabilité de mortalité ou de dommages pour les oiseaux migrateurs. |
Faible L'effet est prévu dans la zone de développement du projet. |
Moyen terme L'effet prévu s'étendra à la désaffectation. |
Continue L'effet prévu se produira de façon continue pendant la construction, l'opération et la désaffectation. |
Réversible L'effet prévu sera entièrement réversible une fois que la qualité de l'eau sera conforme aux lignes directrices. |
S. O. |
Non important Les oiseaux migrateurs éviteraient la zone de développement du projet en raison d'éléments dissuasifs et de perturbations sensorielles, mais des mesures de programme de suivi seront mises en œuvre si des collisions entre les oiseaux migrateurs et les véhicules sont observés. |
| Perte d'habitat |
Moyenne La perte d'un habitat convenable n'entraînerait pas de changement mesurable de l'abondance des oiseaux migrateurs dans la zone de développement du projet et la zone d'évaluation locale. |
Moyenne L'effet prévu s'étendra à la zone d'évaluation locale. |
Long terme L'effet prévu s'étendra à la fermeture. |
Continue L'effet prévu se produira de façon continue pendant toutes les phases du projet. |
Partiellement réversible L'effet prévu sera partiellement réversible, car les conditions préalables au projet ne seront pas entièrement atteintes. |
D'importance moyenne Le moment de la perte d'habitat peut avoir une incidence sur les activités de reproduction des oiseaux migrateurs. |
Non important Des habitats convenables sont présents dans les zones d'évaluation locale et régionale. La remise en état du site conformément aux exigences provinciales rétablirait partiellement la zone de développement du projet à long terme. |
| Composante valorisée – Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles | |||||||
| Diminution de la qualité et de la disponibilité des ressources |
Faible Les modifications de la qualité et de la disponibilité des ressources utilisées pour la cueillette des plantes, la chasse, le piégeage et la pêche mèneraient à une utilisation des ressources par les Autochtones qui serait semblable à leur usage courant. |
Faible à moyenne L'effet prévu s'étendra seulement à la zone d'évaluation locale. |
Moyen terme L'effet prévu se produira pendant moins de 25 ans (de la construction à la désaffectation). |
Continue L'effet prévu sera continu pendant sa durée. |
Partiellement réversible Certaines parties de la zone de développement du projet devraient être remises en état, et les modifications de la qualité de l'air (poussière) seraient atténuées après l'exploitation, ce qui annulerait certains changements de qualité et de disponibilité des plantes, de la faune et des poissons pour la récolte. |
S. O. |
Non important Les changements de qualité et de disponibilité des ressources se produiraient à l'intérieur et à proximité de la zone de développement du projet. On trouverait des plantes, des animaux sauvages et des poissons dans d'autres parties de la zone d'évaluation locale et dans la zone d'évaluation régionale. |
| Perte ou modification de l'accès pour les Autochtones |
Moyenne L'accès au bras sud-ouest du lac Kenogamisis serait maintenu, mais modifié par le projet. |
Faible à moyenne L'effet prévu s'étendra seulement à la zone d'évaluation locale. |
Moyen terme L'effet prévu se produira pendant moins de 25 ans (de la construction à la désaffectation). |
Continue L'effet prévu sera continu pendant sa durée. |
Partiellement réversible Certains points d'accès seront rétablis après la désaffectation. |
S. O. |
Non important Les groupes autochtones seraient toujours en mesure d'accéder aux zones le long du bras sud-ouest du lac Kenogamisis, y compris à l'endroit où l'affluent du ruisseau Goldfield rencontre le bras sud-ouest du lac Kenogamisis, mais l'accès prendrait plus de temps et il faudrait parcourir une plus grande distance. |
| Diminution de la qualité globale de l'expérience d'utilisation par les Autochtones |
Faible Les modifications de l'expérience devraient mener à une utilisation des ressources par les Autochtones qui serait semblable à leur usage courant. |
Moyenne L'effet prévu s'étendra à la zone d'évaluation locale. |
Long terme L'effet prévu se produira pendant plus de 25 ans (de la construction à la fermeture). |
Continue L'effet prévu sera continu pendant sa durée. |
Partiellement réversible Les modifications de la qualité de l'air et du bruit seraient annulées au fil du temps, mais certaines perturbations visuelles du sol demeureraient. |
S. O. |
Non important Des modifications de la qualité de l'expérience pourraient survenir pendant le projet, mais elles se produiraient à l'intérieur et à proximité de la zone de développement du projet. Les Autochtones pourraient continuer d'utiliser les terres et les ressources sans subir de baisse de qualité de l'expérience dans d'autres parties de la zone d'évaluation locale et dans la zone d'évaluation régionale. |
| Composante valorisée – Conditions sanitaires et socioéconomiques | |||||||
| Exposition à des contaminants de l'air et de l'eau par inhalation, ingestion ou contact cutané |
Moyenne Le projet modifierait le degré d'exposition à des contaminants de l'air et de l'eau de sorte que celui-ci s'approcherait des limites des normes sanitaires sans toutefois les atteindre. |
Moyenne L'effet prévu s'étendra à la zone d'évaluation locale. |
Moyen terme L'effet prévu se produira de la construction à la désaffectation. |
Continue L'effet prévu sera continu pendant sa durée. |
Partiellement réversible Les modifications de la qualité de l'air et de l'eau seraient annulées au fil du temps. |
S. O. |
Non important L'exposition à l'arsenic, au mercure et au méthylmercure provenant de l'eau et des poissons n'est pas susceptible d'entraîner des effets sur la santé. |
| Réduction de la capacité de récolte des ressources de subsistance |
Moyenne Les activités de récolte peuvent nécessiter certains changements comportementaux. |
Faible à moyenne L'effet prévu s'étendra seulement à la zone d'évaluation locale. |
Moyen terme L'effet prévu se produira de la construction à la désaffectation. |
Continue L'effet prévu sera continu pendant sa durée. |
Partiellement réversible Le piégeage et la pêche aux poissons-appâts pourraient reprendre après la désaffectation, mais à d'autres endroits de la zone d'évaluation locale que ceux où ces activités se pratiquent actuellement. |
S. O. |
Non important Les modifications de la disponibilité des zones de piégeage et de pêche aux poissons-appâts ainsi que de leur accès ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence sur les conditions socioéconomiques. |
| Composante valorisée – Patrimoine naturel et culturel | |||||||
| Perte ou modification de l'habitat de nidification du pygargue à tête blanche |
Faible L'habitat de nidification du pygargue à tête blanche demeurerait relativement inchangé, et l'activité associée à l'élément et sa valeur relative ne seraient pas touchées. |
Moyenne L'effet prévu sera limité à la zone d'évaluation locale. |
Long terme Si des nids sont découverts, l'effet prévu s'étendra à la fermeture. |
Continue Si des nids sont découverts, l'effet prévu se produira de façon continue pendant toutes les phases du projet. |
Partiellement réversible La remise en état de l'habitat de nidification de l'aigle à tête blanche s'échelonnerait sur plusieurs décennies. |
D'importance moyenne Le retrait serait effectué au cours des périodes recommandées dans les lignes directrices provinciales sur le pygargue à tête blanche. |
Non important Le projet n'est pas susceptible d'entraîner des modifications dans la population de pygargues à tête blanche. |
| Composante valorisée – Effets transfrontaliers | |||||||
| Émissions de gaz à effet de serre |
Faible Les émissions pourraient atteindre 0,155 % des émissions annuelles de l'Ontario. |
S. O. |
S. O. |
S. O. |
S. O. |
S. O. |
Non important Le projet n'entraînerait pas le rejet d'une quantité importante de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. |
| Composante valorisée – Effets visés au paragraphe 5(2) de la LCEE 2012 | |||||||
| Modifications des milieux humides et de l'hydrologie |
Moyenne Les effets résiduels sur l'abondance et la répartition des milieux humides se situent nettement dans les limites de la capacité d'adaptation prévue des écosystèmes de milieux humides pour s'autoréguler. |
Moyenne La perte d'habitat et les modifications de la qualité et de la fonction de l'habitat s'étendront à la zone d'évaluation locale en raison de modification du niveau des eaux de surface et des eaux souterraines. |
Long terme L'effet prévu s'étendra à la fermeture. |
Continue L'effet prévu se produira de façon continue pendant toutes les phases du projet. |
Partiellement réversible L'effet peut être partiellement réversible par la remise en état des milieux humides. |
S. O. |
Non important L'élimination de plans d'eau et la modification de la qualité des eaux de surface découlant des activités du projet seraient partiellement annulées par la remise en état des milieux humides. |
Annexe C – Liste des principales mesures d'atténuation, de surveillance et de suivi considérés par l'Agence
| Composante valorisée | Principales mesures d'atténuation, de surveillance et de suivi |
|---|---|
| Effets déterminés en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi | |
| Poissons et habitat du poisson |
Mesures d'atténuation de la mortalité et des effets sur la santé des poissons
Mesures d'atténuation de la perte ou de la détérioration de l'habitat des poissons
Mesures du programme de suivi des poissons et de leur habitat
|
| Oiseaux migrateurs |
Mesures d'atténuation pour limiter l'exposition aux contaminants dans les éléments du projet comportant des eaux libres
Mesures d'atténuation pour limiter le risque accru de collision avec les véhicules
Mesures d'atténuation pour remédier à la perte d'habitat
Mesures du programme de suivi pour limiter l'exposition aux contaminants dans les éléments du projet comportant des eaux libres
Mesures du programme de suivi pour limiter le risque accru de collision avec les véhicules
Mesures du programme de suivi pour remédier à la perte d'habitat
|
| Peuples autochtones – usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles |
Mesures d'atténuation visant à pallier la réduction de la qualité et de la disponibilité des ressources
Mesures d'atténuation visant à pallier la perte ou la modification de l'accès
Mesures d'atténuation visant à pallier la réduction de la qualité globale de l'expérience
Mesures du programme de suivi pour pallier la réduction de la qualité et de la disponibilité des ressources
Mesures du programme de suivi pour pallier la perte ou la modification de l'accès
Mesures du programme de suivi pour pallier la réduction de la qualité globale de l'expérience
|
| Peuples autochtones – santé et conditions socioéconomiques |
Mesures d'atténuation visant à pallier l'exposition aux contaminants de l'air et de l'eau
Mesures d'atténuation visant à pallier la réduction de la capacité de récolter des ressources de subsistance
Mesures du programme de suivi pour pallier l'exposition aux contaminants de l'air et de l'eau
|
| Peuples autochtones – patrimoine physique ou culturel |
Mesures d'atténuation des effets sur la perte ou modification de l'habitat de nidification du pygargue à tête blanche
|
Annexe D – Résumé de la consultation des groupes autochtones par la Couronne
La présente annexe contient un résumé des observations recueillies au cours de l'évaluation environnementale. La plupart des observations et des réponses se trouvent en version intégrale dans les documents de l'étude d'impact environnemental fournis par le promoteur. L'Agence a fait le résumé des observations reçues au cours de l'évaluation environnementale et les a classées en fonction des composantes valorisées et des éléments de l'évaluation environnementale.
| Groupe | Observation ou préoccupation | Résumé de la réponse du promoteur | Réponse de l'Agence |
|---|---|---|---|
| Effets déterminés en vertu du paragraphe 5(1) de la LCEE 2012 | |||
| Poissons et leur habitat | |||
| Nation indépendante des Métis de Red Sky |
Préoccupations concernant la dégradation de la qualité de l'eau dans les plans d'eau environnants en raison de la possibilité d'écoulements ou de déversements provenant de l'installation de gestion des résidus. Cela poserait un risque pour l'environnement, pour l'utilisation des ressources par les Autochtones à proximité de l'installation de gestion des résidus et pour la santé des Autochtones. |
Selon le promoteur, il est peu probable que la qualité de l'eau change, car l'installation de gestion des résidus sera entourée de fossés de collecte pour recueillir la plus grande partie des écoulements, et tous les écoulements seront pompés jusqu'à l'installation. L'eau provenant de l'installation de gestion des résidus serait recyclée, et tout excédent d'eau serait traité avant d'être rejeté dans le lac Kenogamisis. |
L'Agence est satisfaite de la réponse du promoteur. L'Agence a indiqué les principales mesures d'atténuation et de programme de suivi aux encadrés 7.1-1 et 7.1-2. De plus, le promoteur sera tenu de gérer la qualité de l'eau dans les effluents miniers conformément au Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants, qui protège les poissons et leur habitat, tout en tenant compte des Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement. |
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland, Première Nation de Ginoogaming |
Préoccupations concernant la contamination du lac Kenogamisis et des eaux environnantes en raison des contaminants provenant des résidus historiques non excavés. Précisions demandées sur la façon dont les résidus historiques seraient confinés et nettoyés en toute sécurité pour éviter la contamination des terres et des ressources des Premières Nations. Préoccupations concernant la façon dont l'installation de gestion des résidus sera assainie au moment de la désaffectation, surtout en raison des résidus historiques qui y sont stockés. Précisions demandées sur la façon de réduire les niveaux de contaminants prévus et sur la faisabilité d'aménager des milieux humides pour réduire les niveaux de contaminants. Selon une suggestion, dans l'éventualité où les plans de remise en état existant ne permettent pas de réduire les concentrations de métaux, une stratégie de gestion adaptative doit inclure la mobilisation opportune et significative des collectivités autochtones ainsi qu'un système de notification pour informer ces collectivités de tout résultat inattendu si une utilisation par les Autochtones est possible. |
Dans son évaluation, le promoteur a indiqué que le projet n'aurait pas d'incidence négative sur la stabilité des résidus historiques non excavés. Les résidus historiques de MacLeod seraient stabilisés pour accroître la sécurité en cas d'événement sismique. Le promoteur a prédit que la lixiviation des métaux provenant des résidus historiques, en particulier l'arsenic, diminuera considérablement grâce aux mesures d'assainissement. Le promoteur a indiqué que les résidus historiques seront placés là où tous les écoulements seront interceptés et qu'ils ne seront pas rejetés dans les eaux avoisinantes. Les eaux du projet se stabiliseraient après la désaffectation et seraient éventuellement rejetés dans l'environnement sans qu'il soit nécessaire de les traiter. Il serait possible d'utiliser un milieu humide aménagé dans l'éventualité où l'eau de contact ne respecterait pas les normes provinciales applicables en matière de qualité de l'eau. Le promoteur s'est engagé à verser le financement nécessaire à la dotation de postes de contrôleurs environnementaux de chaque collectivité. Ceux-ci feront partie d'un comité consultatif de l'environnement et examineront et recommanderont des changements aux plans de gestion et de surveillance de l'environnement, y compris les procédures de communication. |
L'Agence a indiqué les principales mesures d'atténuation et de programme de suivi aux encadrés 7.1-1 et 7.1-2. Elle recommande d'inclure dans les conditions de la décision de la ministre que le promoteur gère les résidus historiques de MacLeod et de Hardrick, à leurs emplacements actuels, temporaires et finaux, afin que l'eau de contact des résidus historiques n'augmente pas la concentration de contaminants dans les plans d'eau environnants, y compris les suivants : bras sud-ouest, bassin central et baie Barton du lac Kenogamisis, affluent du bras sud-ouest et affluent du ruisseau Goldfield. De plus, l'Agence sait que, si le projet devait être mis en œuvre, un plan de fermeture serait requis en vertu de la Loi sur les mines de l'Ontario. Le plan comprendrait des conditions pour la fermeture et la surveillance du site et intégrerait des cibles de qualité de l'eau conformes à celles établies par le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario. |
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland, Première Nation de Ginoogaming, Nation métisse de l'Ontario |
Préoccupations et incertitudes liées aux concentrations prévues de mercure, de méthylmercure et d'arsenic dans les eaux de surface et les tissus des poissons. Demande de surveillance, de mesures préventives et de communication en cas de concentrations excessives. |
Dans son évaluation, le promoteur a prédit une amélioration globale de la qualité de l'eau dans le lac Kenogamisis et les plans d'eau environnants, principalement en raison de la réduction des rejets de résidus historiques. Le promoteur s'est engagé à surveiller les effluents de la mine conformément au Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants et à surveiller la présence d'arsenic, de mercure et de méthylmercure dans la zone d'évaluation locale, y compris dans l'affluent du ruisseau Goldfield, le canal de dérivation du ruisseau Goldfield, l'affluent du bras sud-ouest du lac Kenogamisis et le lac Mosher, afin de confirmer les prévisions de l'évaluation environnementale. Pour protéger la santé humaine, le promoteur s'est également engagé à surveiller les concentrations de méthylmercure, mercure et arsenic dans les tissus des poissons de chaque bassin du lac Kenogamisis ainsi que d'autres lacs (dont le lac Mosher). Par l'entremise du comité consultatif de l'environnement, le promoteur élaborerait des procédures de communication avec les groupes autochtones. |
Les conclusions générales de l'Agence sur les poissons et leur habitat sont présentées à la section 7.1 du présent rapport. L'Agence est satisfaite de l'engagement du promoteur à surveiller la qualité de l'eau et les poissons. L'Agence a indiqué les principales mesures d'atténuation et de programme de suivi aux encadrés 7.1-1 et 7.1-2. De plus, le promoteur sera tenu de gérer la qualité de l'eau dans les effluents miniers conformément au Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants, qui protège les poissons et leur habitat, tout en tenant compte des Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement. |
| Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek, Bingwi Neyaashi Anishinaabek, Première Nation de Ginoogaming |
Préoccupations concernant les concentrations de contaminants métalliques comme le mercure et l'arsenic dans les poissons, car ils peuvent nuire à la santé des poissons et de ceux qui les consomment. Demande de surveillance des contaminants et de communication des résultats aux personnes à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de développement du projet. |
Le promoteur a répondu que la qualité des eaux de surface ne serait pas touchée par le projet, car les effluents miniers seront traités avant le rejet, et il a également souligné que des restrictions à la consommation de poissons visant à limiter l'exposition au méthylmercure sont actuellement en vigueur pour le lac Kenogamisis. Le promoteur s'est engagé à surveiller la présence de méthylmercure, de mercure et d'arsenic dans les tissus des poissons en provenance des plans d'eau, comme le système de dérivation du ruisseau Goldfield et le lac Kenogamisis. Les groupes autochtones auraient l'occasion de participer à la surveillance des ressources des eaux de surface. |
L'Agence a examiné les effets du projet sur les poissons et leur habitat à la section 7.1 et sur la santé humaine à la section 7.4.1, et a conclu que le projet n'aurait pas d'effet important sur la santé des poissons ou des humains. L'Agence a indiqué les principales mesures d'atténuation et de programme de suivi pour la santé des poissons aux encadrés 7.1-1 et 7.1-2 et pour la santé des humains aux encadrés 7.4-1 et 7.4-2. |
| Première Nation de Ginoogaming |
Préoccupations concernant la création d'un lac de kettle en tirant de l'eau douce du lac Kenogamisis. Renseignements demandés sur la façon dont ce projet pourrait influer sur le débit d'eau local, la qualité de l'eau ainsi que les populations de poissons, et sur la possibilité que les générations futures ne soient pas conscientes des risques liés à l'accès au lac de kettle. |
Dans son évaluation, le promoteur a indiqué qu'en raison du faible taux de prise d'eau douce par rapport au débit annuel moyen et du fait que les niveaux d'eau dans le lac Kenogamisis sont régulés par un barrage, il ne s'attend pas à des répercussions sur les utilisateurs, les pêches et les poissons. |
L'Agence est satisfaite de la réponse du promoteur et a indiqué les principales mesures d'atténuation et de programme de suivi aux encadrés 7.1-1 et 7.1-2 du présent rapport. De plus, l'Agence sait que, si le projet devait être mis en œuvre, un plan de fermeture serait requis en vertu de la Loi sur les mines de l'Ontario. Le plan comprendrait des conditions pour la fermeture et la surveillance du site et intégrerait des cibles de qualité de l'eau conformes à celles établies par le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario. L'Agence comprend également que les exigences relatives aux fermetures de mines en vertu de la Loi sur les mines prévoient la consultation des groupes autochtones susceptibles d'être touchés et tient compte de l'utilisation future des terres et des ressources. |
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland, Première Nation de Ginoogaming |
Préoccupations concernant les effets éventuels d'une augmentation des contaminants du bassin M1 qui pourraient être rejetés dans l'affluent du bras sud-ouest une fois que l'ancien chantier souterrain sera inondé, puisque l'affluent du bras sud-ouest contient un habitat de frai pour les poissons. |
Le promoteur a répondu qu'il n'est pas proposé que le bassin M1 se déverse directement dans l'affluent du bras sud-ouest pendant l'exploitation ou la désaffectation. L'eau recueillie dans le bassin M1 serait ensuite acheminée au fond de la fosse à ciel ouvert par le puits no 1 de Mosher à mesure que le lac de kettle se remplirait. Une fois le lac de kettle rempli, l'eau continuerait d'être pompée vers le puits jusqu'à ce que la qualité de l'eau respecte les normes de qualité de l'eau applicables, après quoi elle pourrait s'écouler naturellement. |
L'Agence est satisfaite de la réponse du promoteur et a indiqué les principales mesures d'atténuation et de programme de suivi aux encadrés 7.1-1 et 7.1-2 du présent rapport. L'Agence recommande d'inclure dans les conditions de la décision de la ministre que le promoteur effectue des relevés de la population de poissons et de la santé des poissons dans l'affluent du bras sud-ouest pour s'assurer que le projet n'aura pas d'effets négatifs sur les poissons et leur habitat. |
| Première Nation de Ginoogaming, Nation indépendante des Métis de Red Sky |
Préoccupations concernant les effets éventuels sur les frayères de poissons perdues dans le ruisseau Goldfield étant donné que le projet s'y étendrait, et sur les frayères du lac Kenogamisis potentiellement touchées en raison du rejet d'effluents. Préoccupations concernant la réussite et l'accessibilité de l'autre habitat des poissons qui sera créé comme mesure compensatoire, car il faudra peut-être attendre des années avant que cet habitat devienne comme les habitats originaux, et il se peut que l'habitat ne soit pas utilisé aussi souvent qu'il l'est plus en amont du lac Kenogamisis. |
Le promoteur a répondu que les gros poissons ne resteraient probablement dans le ruisseau Goldfield pendant de longues périodes parce que l'habitat ne convient pas aux adultes de ces espèces pendant la majeure partie de l'année. Selon l'évaluation du promoteur, les populations de poissons dans le lac Kenogamisis ne seraient pas touchées, et les conditions sanitaires actuelles des poissons ne devraient pas changer à la suite du projet. Le promoteur a répondu que l'autorisation accordée en vertu de la Loi sur les pêches et le plan de compensation de l'habitat des poissons préciseront les critères de réussite de la surveillance et les éventuelles mesures à prendre pour veiller à ce que la production de poissons soit comparable aux conditions de référence dans un délai raisonnable (estimé à cinq ans ou moins). Si les mesures compensatoires pour les pêches ne fonctionnent pas à un niveau acceptable après ce délai, des mesures supplémentaires seront prises. |
L'Agence a examiné les effets du projet sur les poissons et leur habitat à la section 7.1 et elle est satisfaite de la réponse du promoteur. L'Agence note que le promoteur et Pêches et Océans Canada sont résolus à mobiliser les groupes autochtones qui pourraient être touchés, au cours du processus d'application de la Loi sur les pêches et de la réglementation. |
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland, Première Nation de Ginoogaming |
Le lac A-322 a été désigné comme site de frai des poissons, et on demande qu'il fasse l'objet d'une surveillance dédiée sur le plan de la qualité de l'eau et sur le plan biologique (benthos, poissons), tout comme les sites en amont et en aval. |
Dans son évaluation, le promoteur a indiqué qu'aucun écoulement ne devrait être rejeté de l'installation de gestion des résidus vers le lac A-322, de sorte qu'aucun effet sur le frai des poissons n'est prévu. Le promoteur s'est engagé à surveiller les eaux souterraines entre le lac A-322 et l'installation de gestion des résidus, ainsi que les eaux de surface dans l'affluent du ruisseau Goldfield en aval du lac A-322. |
L'Agence a examiné les effets du projet sur les poissons et leur habitat à la section 7.1 et elle est satisfaite de la réponse du promoteur. |
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland, Première Nation de Ginoogaming |
Demande d'inclure le lac Long et le lac Chipman dans la surveillance des eaux de surface, puisque toutes les eaux communiquent. Demande d'accroître la fréquence des programmes de surveillance aquatique pour confirmer les effets prévus ou pour évaluer les effets éventuels. |
Selon l'évaluation du promoteur, le projet n'aura pas de conséquence négative sur la qualité de l'eau, la quantité d'eau et l'habitat des poissons dans le lac Chipman ou le lac Long. Les deux lacs se trouvent à l'extérieur de la zone d'évaluation régionale et, bien que la surveillance de la qualité de l'eau du lac Chipman ne soit pas considérée étant possible, trois stations de surveillance sont situées en amont de la rivière Kenogami à Longlac et du barrage de retenue de Kenogami à l'extrémité nord-est de la zone d'évaluation régionale. Cela comprend une station sur la rivière Kenogami juste avant qu'elle ne coule dans le lac Long. Le promoteur a indiqué que des échantillonnages plus fréquents pourraient être requis en fonction des effets observés et de la gestion adaptative, et que l'effort d'échantillonnage pour un volet de surveillance particulier pourrait également être réduit si la surveillance avérée démontre que le projet n'a pas d'effet négatif sur ce volet. Le promoteur continuera de consulter les groupes au sujet de l'élaboration du plan de surveillance aquatique et de la gestion adaptative pendant la durée de vie du projet afin d'obtenir leurs observations et de clarifier l'approche à mesure qu'elle sera peaufinée. |
L'Agence a examiné les effets du projet sur les poissons et leur habitat à la section 7.1 et elle est satisfaite de la réponse du promoteur. L'Agence indique que le promoteur devra gérer la qualité de l'eau dans les effluents des mines afin de respecter le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants et dans tous les plans d'eau aux alentours du projet afin de respecter les exigences de la Loi sur les pêches, tout en tenant compte des Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement. |
| Oiseaux migrateurs | |||
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland, Première Nation de Ginoogaming |
Demande au promoteur d'effectuer une évaluation complète de l'exposition et des effets cumulatifs du bassin à l'installation de gestion des résidus sur la santé et les populations de sauvagine et d'oiseaux migrateurs en période de rassemblement, de cerner les effets de ces changements sur l'utilisation traditionnelle et de déterminer toute autre mesure visant à dissuader la sauvagine de se rassembler dans l'installation de gestion des résidus. |
Dans son évaluation, le promoteur a indiqué que l'installation de gestion des résidus présente un risque négligeable pour les populations de sauvagine et d'oiseaux migrateurs en période de rassemblement en raison de la possibilité d'exposition limité, car il est peu probable que le bassin de l'installation de gestion des résidus abrite des populations d'invertébrés benthiques, de plantes aquatiques ou de poissons dont ces oiseaux se nourrissent. Le promoteur convient que la gestion adaptative, y compris la surveillance de l'utilisation faite par la sauvagine et de l'eau du bassin de décantation, fournira un mécanisme efficace pour déterminer si des mesures dissuasives supplémentaires seraient nécessaires pendant l'exploitation. |
L'Agence a examiné les effets du projet sur les oiseaux migrateurs en raison de l'exposition aux contaminants dans les éléments du projet comportant des eaux libres à la section 7.2.1 du présent rapport. L'Agence recommande d'inclure dans les conditions de la décision de la ministre les mesures de programme de suivi indiquées à l'encadré 7.2-2 pour surveiller l'utilisation de l'installation de gestion des résidus par les oiseaux migrateurs pendant toutes les phases du projet. Compte tenu de l'application des mesures du programme de suivi, l'Agence est d'avis que les répercussions sur les oiseaux migrateurs et les modifications des milieux environnants relativement à l'utilisation traditionnelle ne seraient pas importants. |
| Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles | |||
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland, Première Nation de Ginoogaming, Nation métisse de l'Ontario |
On demande la tenue d'une discussion plus vaste sur la valeur de la zone de développement du projet d'un point de vue culturel, comme les effets sur les sites patrimoniaux, de même que l'élaboration de mesures d'adaptation particulières par le promoteur en vue de protéger les ressources patrimoniales ou de compenser la perte de terrains d'enseignement importants pour les activités traditionnelles d'utilisation des terres et des ressources. |
Le promoteur s'est engagé à partager continuellement l'information avec les groupes autochtones à toutes les étapes du projet. Le promoteur est ouvert à l'idée de recevoir d'autres connaissances traditionnelles pour déterminer si des mesures d'atténuation supplémentaires sont nécessaires en ce qui a trait au plan conceptuel de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales ainsi qu'à d'autres plans de gestion et de surveillance de l'environnement. |
L'Agence a examiné les effets du projet sur les aspects culturels de l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, le patrimoine naturel et culturel ainsi que les droits ancestraux et issus de traités aux sections 7.3, 7.5 et 9. L'Agence a indiqué les principales mesures d'atténuation aux encadrés 7.3-1 et 7.5-1, ainsi que les mesures du programme de suivi aux encadrés 7.3-2 et 7.5-2, et elle est satisfaite de la réponse du promoteur et de son engagement à collaborer continuellement avec les collectivités. |
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland, Première Nation d'Eabametoong, Première Nation de Ginoogaming, Nation métisse de l'Ontario |
Crainte que la perte de sites spirituels ou culturels et de zones privilégiées pour la récolte de plantes, la chasse et le piégeage pendant la durée du projet entraîne une perte de transfert des connaissances propres à ces sites et une perte de désir d'accéder au site après la désaffectation. On a demandé qu'à moins d'indication contraire d'un groupe, les lieux de campement soient considérés par prudence comme des endroits ayant une importance spirituelle. |
Le promoteur a déclaré qu'il a tenu compte du fait que connaissances sur les activités et les pratiques traditionnelles sont transmises d'une génération à l'autre, et qu'il est possible de le constater par la sélection de limites temporelles dans l'évaluation de l'utilisation des terres et des ressources traditionnelles, d'environ 1990 à aujourd'hui et dans un avenir raisonnablement prévisible. Le promoteur s'est engagé à offrir d'autres possibilités de consultation et à favoriser davantage le partage culturel afin d'aborder les effets intangibles. Le promoteur a dit reconnaître que les lieux de campement signalés peuvent avoir une grande importance sur le plan spirituel ou cérémoniel. |
L'Agence a examiné les effets du projet sur les aspects culturels de l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, le patrimoine naturel et culturel ainsi que les droits ancestraux et issus de traités aux sections 7.3, 7.5 et 9. L'Agence a examiné les sites portés à son attention au cours du processus d'évaluation environnementale, y compris les sites culturels et les sites que les Autochtones préfèrent utiliser dans la zone de développement du projet et la zone d'évaluation locale. À la lumière des observations reçues des groupes autochtones, l'Agence a indiqué les principales mesures d'atténuation et du programme de suivi aux encadrés 7.3-1, 7.3-2, 7.5-1 et 7.5-2. L'Agence est convaincue que des mesures suffisantes sont en place pour protéger les sites culturels et le maintien des pratiques culturelles pendant toutes les phases du projet. |
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland, Première Nation de Ginoogaming, Nation métisse de l'Ontario, Nation indépendante métisse de Red Sky |
Préoccupations concernant l'introduction possible d'espèces terrestres envahissantes dans la zone de développement du projet et la région environnante en raison des déplacements de véhicules dans la grande zone de développement du projet et en provenance de l'extérieur. Les espèces envahissantes peuvent perturber l'équilibre naturel des écosystèmes et, par conséquent, nuire indirectement à l'usage courant des terres et des ressources. On craint que l'utilisation de méthodes chimiques de gestion de la végétation ne devienne une voie d'exposition aux contaminants par l'ingestion d'aliments traditionnels. Les plantes médicinales ne devraient pas être touchées par les herbicides. S'il est impossible de les éviter, il faudrait informer les collectivités du moment et de l'endroit où ceux-ci seraient utilisés afin que les membres puissent les éviter. |
En réponse aux préoccupations, le promoteur a proposé des mesures d'atténuation pour réduire les effets éventuels de la propagation de ces espèces envahissantes sur les communautés végétales, comme l'utilisation de matériaux de remblayage propres et grossiers pour le nivellement et la sélection d'espèces indigènes pour la revégétalisation. Dans la mesure du possible, le promoteur utilisera également des pratiques mécaniques d'enlèvement de la végétation pour éviter l'utilisation d'herbicides, et le recours à de tels produits serait localisé. Les contrôleurs environnementaux et le comité consultatif de l'environnement peuvent contribuer à informer les collectivités des moments où les zones de récolte doivent être évitées. |
L'Agence est satisfaite de la réponse du promoteur. L'Agence a indiqué les principales mesures d'atténuation et de programme de suivi liées à la remise en état progressive aux encadrés 7.2-1 et 7.3-1. L'Agence s'attend à ce que, dans le cadre des comptes rendus réguliers aux groupes autochtones, le promoteur fournisse un résumé de la fréquence et de l'emplacement des applications de substances chimiques afin de rassurer les utilisateurs autochtones quant à la réalisation de cet engagement. |
| Première Nation d'Eabametoong |
Crainte que le fait de pallier la perte de zones de récolte de plantes en offrant la possibilité de récolter des plantes avant la construction ne soit pas une mesure satisfaisante pour la Première Nation d'Eabametoong, car la récolte de petits fruits est une activité annuelle. |
Le promoteur a déclaré que l'habitat végétal perdu représente une petite partie de l'habitat végétal disponible dans la zone d'évaluation régionale. La mesure d'atténuation a été établie en raison de l'intérêt de groupes autochtones, mais tous les groupes n'ont pas à tirer parti de cette occasion. |
L'Agence est satisfaite de la réponse du promoteur et a examiné les effets du projet ainsi que les mesures d'atténuation à la section 7.3 et à l'encadré 7.3-1. L'Agence a examiné les effets sur la cueillette de végétaux à la section 7.3 et a recommandé comme principales mesures d'atténuation à l'encadré 7.3-1 que les groupes autochtones aient la possibilité de récolter des plantes à des fins traditionnelles avant la construction et que les espèces végétales d'intérêt pour les collectivités autochtones soient intégrées à tout plan de revégétalisation de la zone de développement du projet. L'Agence est d'avis que, grâce aux mesures d'atténuation proposées, l'effet sur l'utilisation par les Autochtones ne sera pas important. |
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland, Première Nation de Ginoogaming |
Crainte que la perte d'habitat de l'orignal attribuable aux activités et à la construction du projet fasse davantage diminuer la population d'orignaux dans la région. Il faudrait donc surveiller et analyser ces populations afin de prévoir les tendances après le début du projet. Les collectivités autochtones aimeraient participer à la surveillance de la santé de l'orignal afin d'avoir la certitude que les aliments sauvages qu'elles consomment ne sont pas contaminés. |
Dans son évaluation, le promoteur a prédit que le projet ne poserait pas de risque pour la santé de l'orignal. En réponse aux préoccupations, le promoteur a suggéré qu'une étude sur les tissus d'orignal soit menée en collaboration avec le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario ainsi que les groupes autochtones, et il continuera de participer à la planification d'une telle étude au fur et à mesure de l'avancement du projet. |
L'Agence a examiné les effets du projet sur les poissons et leur habitat à la section 7.3.1 et ses effets cumulatifs sur la santé humaine à la section 8.4.2, et convient avec le promoteur que le projet n'aura pas d'effets importants sur l'habitat de l'orignal. |
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland, Première Nation de Ginoogaming, Nation métisse de l'Ontario |
Crainte que le bruit persistant des activités minières et de traitement constitue une nuisance et détériore la qualité des terres utilisées à des fins traditionnelles, récréatives, spirituelles, culturelles et de récolte. Les collectivités autochtones devraient être préalablement avisées des activités de dynamitage, qui devraient être limitées pendant les périodes cruciales d'utilisation des terres. |
Dans son évaluation, le promoteur a prédit qu'il n'y aurait pas de dépassement des lignes directrices provinciales applicables en matière de bruit aux lieux prévus d'utilisation des terres par les Autochtones. Le promoteur a également indiqué que le bruit et les vibrations causés par le dynamitage se produiront généralement bien en dessous du niveau du sol et ne dureront que quelques secondes, et que cela n'aura donc à peu près aucun effet sur les personnes pratiquant des activités traditionnelles. Le promoteur s'est engagé à fournir les détails du calendrier de dynamitage aux collectivités. |
L'Agence a examiné les effets du projet sur l'utilisation des terres et des ressources par les Autochtones à la section 7.3 et est d'avis que même si la qualité des expériences de pêche, de chasse et de piégeage pouvait être affectée par le bruit près de la limite de la zone de développement du projet, ces effets n'empêcheraient pas les groupes autochtones de pratiquer des activités traditionnelles dans la zone d'évaluation locale. L'Agence a indiqué les principales mesures d'atténuation et de programme de suivi aux encadrés 7.3-1 et 7.3-2. |
| Première Nation de Ginoogaming |
Questions au sujet des efforts de revégétalisation prévus, de leur succès et des effets sur la biodiversité. Ces effets seraient déterminants pour l'utilisation possible des terres par les Autochtones après la fermeture. |
Le promoteur s'est engagé à mener des essais de revégétalisation autour de l'installation de gestion des résidus et des haldes de stériles avant la revégétalisation afin de déterminer la méthode la plus efficace. À long terme, la végétation de l'installation de gestion des résidus ne devrait pas se développer en forêt, mais elle devrait fournir un habitat aux oiseaux qui nichent au sol. La végétation des stériles devrait se développer en forêt. |
L'Agence est satisfaite de la réponse du promoteur. L'Agence a proposé des mesures clés d'atténuation et du programme de suivi aux encadrés 7.3-1 et 7.3-2. |
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland, Première Nation de Ginoogaming |
Crainte que les terres remises en état n'aient pas la même valeur d'habitat faunique que les phases non perturbées de l'écosite sur lesquelles elles sont modélisées. |
Le promoteur a déclaré que la détermination de l'importance n'est pas fondée uniquement sur le succès de la revégétalisation, mais aussi sur la perte relative d'habitat dans la zone de développement du projet comparativement à la disponibilité restante d'habitat pour la faune dans l'ensemble de la zone d'évaluation régionale. |
L'Agence a examiné les effets sur l'habitat terrestre à la section 6.4 et sur l'utilisation par les Autochtones à la section 7.3 et elle est satisfaite de la réponse du promoteur. L'Agence recommande d'inclure dans les conditions de la décision de la ministre que le promoteur prenne des mesures, avec l'apport des groupes autochtones, pour restaurer la zone de développement du projet afin qu'elle retrouve le plus possible son état antérieur. |
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland, Première Nation de Ginoogaming, Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek, Bingwi Neyaashi Anishinaabek |
Préoccupations concernant la transformation de milieux humides en habitats de marais et de fourrés d'aulnes, et concernant ses possibles répercussions à long terme sur la disponibilité d'espèces traditionnellement importantes. Les marais et les milieux humides ont la plus grande perte d'étendue réelle et sont également considérés comme rares dans cette écorégion. Crainte que le fait de rétablir des zones pouvant soutenir les espèces végétales traditionnelles lorsque c'est possible ne soit pas l'équivalent de remplacer les plantes perdues que les Autochtones utilisent. |
Le promoteur a déclaré que les types de milieux humides qui seront éliminés pour le projet sont généralement courants et répandus dans la zone d'évaluation régionale. Le promoteur s'est engagé à surveiller les milieux humides dans le cadre du plan de gestion et de surveillance de la biodiversité. Les possibilités de rétablissement de milieux humides seront examinées au cours de la conception détaillée du canal de dérivation du ruisseau Goldfield et du plan de fermeture. |
L'Agence a examiné les effets sur l'habitat terrestre à la section 6.4 et sur l'utilisation par les Autochtones à la section 7.3 et elle est satisfaite de la réponse du promoteur. L'Agence recommande d'inclure dans les conditions de la décision de la ministre que le promoteur prenne des mesures, avec l'apport des groupes autochtones, pour restaurer la zone de développement du projet afin qu'elle retrouve le plus possible son état antérieur. L'Agence comprend également que les exigences relatives à la fermeture de la mine en vertu de la Loi sur les mines de l'Ontario prévoient la consultation des groupes autochtones susceptibles d'être touchés et tient compte de l'utilisation future des terres et des ressources. |
| Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek, Bingwi Neyaashi Anishinaabek |
Demande de renseignements sur la contamination potentielle au méthylmercure si des milieux humides sont inondés en raison de la dérivation de cours d'eau, étant donné que des activités de récolte ont lieu dans ces milieux humides. |
Dans son évaluation, le promoteur a indiqué qu'une augmentation de 0,0001 microgramme de méthylmercure par litre dans l'affluent du bras sud-ouest représente 1/40e du seuil de 0,004 microgramme par litre établi pour l'eau douce dans les Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique. Le promoteur s'est engagé à surveiller la présence de méthylmercure dans les plans d'eau susceptibles d'être touchés par le projet. |
L'Agence est satisfaite de la réponse du promoteur et recommande d'inclure dans les conditions de la décision de la ministre que le promoteur surveille la présence de méthylmercure dans l'affluent du bras sud-ouest. |
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland, Première Nation de Ginoogaming |
En compensation de la perte d'accès et des dommages irréversibles causés à leurs terres pendant la durée du projet, les collectivités demandent au promoteur de partager les avantages socioéconomiques du projet, comme l'énergie, afin de lutter contre la pauvreté énergétique régionale. |
Le promoteur a déclaré qu'il discute avec les collectivités en vue de négocier un accord de relations à long terme, mais que cet accord commercial ne fait pas partie du processus d'évaluation environnementale. |
L'Agence prend note de la réponse du promoteur. |
| Santé et conditions socioéconomiques | |||
| Première Nation de Ginoogaming |
Préoccupations concernant les effets de certains contaminants (arsenic, cyanure, mercure, phosphore, etc.) sur tous les animaux (poissons, orignaux, oies, etc.), les niveaux acceptables de contaminants dans l'eau, la surveillance de la faune et les risques pour la santé humaine (voie d'exposition par la consommation). |
Dans son évaluation, le promoteur a indiqué que les changements causés par le projet dans les risques pour la santé des mammifères, des oiseaux, des poissons, des plantes et des invertébrés du sol ont été jugés négligeables. Le promoteur a également prédit que les risques écologiques et sanitaires liés à la présence d'arsenic dans l'eau, les sédiments ou les tissus de poissons devraient diminuer grâce aux mesures de réhabilitation prévues pour remédier à la contamination antérieure. |
L'Agence a examiné les effets du projet sur les poissons à la section 7.1 et sur la santé humaine à la section 7.4 et elle est satisfaite de la réponse du promoteur. L'Agence a indiqué les principales mesures d'atténuation et de programme de suivi pour les poissons aux encadrés 7.1-1 et 7.1-2 et pour la santé aux encadrés 7.4-1 et 7.4-2. |
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland, Première Nation de Ginoogaming |
Si les concentrations de contaminants préoccupants dans l'environnement en venaient à dépasser les concentrations prévues dans l'évaluation des risques pour la santé humaine et écologique, les collectivités aimeraient qu'il y ait une stratégie de gestion adaptative, des consultations et des communications avec les groupes autochtones. Demande d'un système de surveillance de la qualité de l'air et de communication publique pour aviser les groupes autochtones en cas de dépassement des normes de qualité de l'air afin que les membres puissent respirer en toute sécurité. Cela permettrait également d'atténuer les préoccupations concernant les effets de la poussière sur les plantes, l'eau et la faune. |
Le promoteur s'est engagé à veiller à ce qu'Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland et la Première Nation de Ginoogaming aient des contrôleurs environnementaux au sein d'un comité consultatif de l'environnement qui seront en mesure d'informer régulièrement leurs collectivités de la performance environnementale. Le comité sera actif pendant toutes les phases du projet et examinera et recommandera des changements aux plans de gestion et de surveillance de l'environnement. Le promoteur envisagera la mise en place d'un système Web à mesure que le projet progressera. De plus, le promoteur s'est engagé à prendre des mesures d'atténuation pour éliminer la poussière, au besoin, et un plan de gestion et de surveillance de la qualité de l'air sera établi aux fins du projet, ce qui réduira les effets éventuels de la poussière à l'extérieur du site. |
Les conclusions générales de l'Agence sur la santé sont présentées à la section 7.4.1 du présent rapport. L'Agence a indiqué les principales mesures d'atténuation et de programme de suivi aux encadrés 7.4-1 et 7.4-2. De plus, l'Agence recommande d'inclure dans les conditions de la décision de la ministre que le promoteur soit tenu de discuter avec les groupes autochtones de la façon dont ils souhaitent être mobilisés à toutes les phases du projet et de respecter ces exigences. |
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland, Première Nation de Ginoogaming, Nation métisse de l'Ontario |
Crainte que les utilisateurs autochtones évitent les activités traditionnelles et les sites culturels de peur d'être contaminés ou à cause d'effets perçus sur la qualité de l'air, du bruit ou de perturbations de la qualité visuelle. L'impact sur le bien-être global de ces collectivités pourrait être dévastateur sur le plan de la santé (mentale et physique) et de la nutrition. Un programme de surveillance, en collaboration avec les collectivités autochtones, pourrait être utile à cet égard. |
Le promoteur a dit comprendre que des considérations personnelles peuvent déterminer quand, comment et où ont lieu les activités et les pratiques actuelles relatives à l'utilisation des terres et des ressources, et il a indiqué que certains utilisateurs locaux actuels évitent la zone puisque le site comprend des emplacements contaminés. Le promoteur s'est engagé à réduire au minimum l'empreinte du projet et à optimiser l'utilisation de la zone existante qui a été perturbée. Le promoteur a dit que le travail effectué avec les collectivités dans le cadre de la surveillance du projet devrait renforcer la confiance des collectivités et rassurer le public concernant l'atténuation des effets sur l'environnement et la performance environnementale. Le promoteur croit que l'adjectif « dévastateur » est exagéré pour qualifier un projet qui vise la remise en état d'une ancienne zone d'exploitation minière et qui occasionnera une importante réduction globale de la charge en arsenic dans le lac Kenogamisis par rapport à la situation actuelle, d'autant plus qu'une évaluation prudente et scientifiquement défendable des risques pour la santé humaine et l'écologie conclut que le projet présente un risque négligeable. |
L'Agence a examiné les effets du projet sur la santé humaine à la section 7.4.1 et sur la qualité de l'expérience à la section 7.3.3. Elle est d'avis que même si la présence de poussière, de bruit et de grands éléments de projet pouvait nuire à la jouissance des terres par les Autochtones et les dissuader d'utiliser ces terres, les mesures d'atténuation proposées pour limiter la poussière, le bruit et les perturbations visuelles permettraient de confiner les changements à un secteur près de la limite de la zone de développement du projet. En conséquence, l'Agence estime que ces effets ne seraient pas importants. |
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland, Première Nation d'Eabametoong, Première Nation de Ginoogaming |
Les groupes autochtones aimeraient qu'un programme de compensation soit élaboré pour les habitants locaux qui dépendent du lac Kenogamisis et de la zone d'évaluation locale pour y effectuer des récoltes, afin qu'ils puissent continuer d'exercer leurs droits et d'avoir accès aux aliments traditionnels. Préoccupations concernant les coûts accrus de la chasse dans des zones plus éloignées, car ils peuvent grandement nuire à la capacité d'une famille de récolter de la nourriture, et la perte de connaissances traditionnelles liées aux récoltes dans des zones spécifiques du site est inestimable. |
Le promoteur a conçu le projet de façon à limiter le plus possible sa taille globale. Le promoteur s'est engagé à maintenir l'accès au bras sud-ouest du lac Kenogamisis et au chemin Goldfield pendant la durée du projet. |
L'Agence a examiné les effets économiques découlant de la perte de disponibilité des ressources récoltées à la section 7.4.2 et est d'avis que même si une disponibilité réduite des aliments traditionnels pourrait entraîner une perte économique en raison d'un recours accru aux épiceries, cet effet ne sera pas important. Les mesures d'atténuation aux encadrés 7-3-1 et 7-4-1 aideront à veiller au maintien de la capacité de faire des récoltes dans la zone d'évaluation locale autour du lac Kenogamisis. |
| Patrimoine naturel et culturel | |||
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland, Première Nation de Ginoogaming |
Demande de plus amples renseignements sur les mesures qui seront prises pour éviter de perturber les nids avoisinants de pygargues à tête blanche. |
Le promoteur a déclaré qu'un habitat de nidification du pygargue à tête blanche a été repéré près de la zone de développement du projet. Le promoteur s'est engagé à établir un plan de protection des nids actifs de pygargues à tête blanche qui se trouvent à moins de 800 mètres du lieu de construction ou d'exploitation, lequel sera appliqué au cas par cas. |
Les conclusions générales de l'Agence relativement au patrimoine naturel et culturel sont présentées à la section 7.5 du présent rapport, et l'Agence a indiqué les principales mesures d'atténuation et du programme de suivi aux encadrés 7.5-1 et 7.5-2. L'Agence est satisfaite de la réponse du promoteur. |
| Effets déterminés en vertu du paragraphe 5(2) de la LCEE 2012 | |||
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland, Première Nation de Ginoogaming, Nation indépendante métisse de Red Sky |
On craint que la création du canal de dérivation du ruisseau Goldfield inonde la région et que la construction de la fosse à ciel ouvert réduise aussi la quantité d'eau souterraine. Dans l'ensemble, cela pourrait nuire à la capacité de croissance de la végétation et avoir une incidence sur la faune et l'usage courant des terres et des ressources. |
Le promoteur a indiqué que le nouveau canal sera constitué d'une plaine d'inondation construite variable qui aura entre 38 et 68 mètres de largeur. Dans la plaine inondable, des milieux humides isolés peuvent améliorer la diversité des habitats humides. Les mesures de contrôle du nivellement proposées le long de l'actuel affluent du bras sud-ouest sont conçues pour créer des étangs qui feront la transition entre les habitats existants de la plaine inondable et un environnement de marais plus ouvert. Le plan de dérivation du ruisseau Goldfield fournit un plan robuste pour les habitats aquatiques et a de fortes chances de réussir. |
L'Agence a examiné les effets du projet dus aux changements apportés aux milieux humides par le retrait de plans d'eau, ainsi que la modification de la qualité des eaux de surface découlant des activités du projet associées aux décisions fédérales à la section 7.7. L'Agence a conclu que le projet n'aurait pas d'effet important sur ces milieux humides. |
| Effets déterminés en vertu de l'article 19 de la LCEE 2012 | |||
| Effets cumulatifs | |||
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland, Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek, Bingwi Neyaashi Anishinaabek, Première Nation de Ginoogaming |
Demande que les dépôts proposés de Brookbank, de Viper, du Key Lake et de Kailey soient inclus dans l'évaluation des effets cumulatifs en tant que projets raisonnablement prévisibles, puisqu'ils pourraient tirer parti de certains éléments du projet de Hardrock. Demande de renseignements additionnels sur les effets cumulatifs d'anciennes exploitations ainsi que sur les poissons et leur habitat entre les projets de Brookbank et de Hardrock. Les groupes autochtones aimeraient mieux comprendre si ces effets s'accumuleront et rendront la pêche difficile ou dangereuse. |
Le promoteur a déclaré qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de plan de développement de ces propriétés. Les projets de Brookbank et de Viper sont inclus comme projets antérieurs pour tenir compte des travaux d'exploration. Les mesures d'atténuation et les programmes de suivi détaillés dans l'étude d'impact environnemental finale aideront à réduire l'apport du projet aux effets environnementaux cumulatifs. Le promoteur s'est engagé à partager des renseignements avec les collectivités au fil de la progression de ces projets éventuels. Le promoteur s'est engagé à informer les groupes locaux et à fournir tous les renseignements nécessaires à l'évaluation des effets éventuels d'un projet minier de Brookbank dans l'éventualité où il décidait d'élaborer un plan de mise en valeur pour un tel projet. Le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario publie des renseignements sur les limites de consommation de poissons, lesquelles ne devraient pas changer à la suite du projet. |
L'Agence est satisfaite de la réponse du promoteur. L'Agence note que le promoteur s'est engagé à tenir les groupes autochtones au courant de tout plan futur d'exploitation d'autres gisements lui appartenant dans la région. Elle fait également remarquer que si la ministre de l'Environnement et du Changement climatique autorise le projet avant que tout changement pouvant causer des effets environnementaux négatifs soit apporté, le promoteur serait tenu de fournir à l'Agence une description des effets environnementaux négatifs éventuels des changements proposés au projet, ainsi que les mesures d'atténuation et les exigences de suivi qu'il compte mettre en œuvre. Cela comprendrait notamment une exigence selon laquelle le promoteur doit consulter les groupes autochtones et fournir à l'Agence les résultats de la consultation. |
| Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek, Bingwi Neyaashi Anishinaabek |
Aux fins de la détermination de l'impact cumulatif de la perte permanente d'écosites rares comme les marais et milieux humides, on demande de tenir compte du fait que l'environnement existant a déjà été touché par la perte d'habitat humide en raison des activités d'exploitation passées et présentes. Le promoteur devrait envisager d'autres mesures d'atténuation pour le remplacement de l'habitat humide pendant la désaffectation et la fermeture. |
Le promoteur a déclaré que les types de milieux humides qui seront éliminés pour le projet sont généralement courants et répandus dans la zone d'évaluation régionale. Les conditions de référence sur lesquelles est basée l'évaluation des effets cumulatifs reflètent les conditions actuelles et tiennent donc compte des effets des autres activités d'exploitation passées et actuelles sur l'habitat humide. |
L'Agence recommande d'inclure dans les conditions de la décision de la ministre que le promoteur procède à la réhabilitation progressive des habitats secs et humides et qu'il effectue une surveillance des eaux de surface et des eaux souterraines. L'Agence comprend que les exigences relatives aux fermetures de mines en vertu de la Loi sur les mines de l'Ontario prévoient la consultation des groupes autochtones susceptibles d'être touchés et tient compte de l'utilisation future des terres et des ressources. |
| Accidents et défaillances | |||
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland, Première Nation de Ginoogaming |
Préoccupations concernant la façon dont les défaillances à l'installation de gestion des résidus seront évitées et dont on interviendra lorsque des défaillances se produiront dans les ouvrages de confinement de l'eau, et préoccupations à propos des mesures de conception de sécurité à l'intérieur de ces ouvrages. Les incidents pourraient avoir des effets négatifs sur l'environnement. |
Le promoteur a indiqué que la digue à résidus serait conçue pour contenir la crue centenaire sans déversement, et pour résister au séisme maximal le plus vraisemblable dans la région géographique. Le barrage excède les facteurs cibles de sécurité requis conformément aux Recommandations de sécurité des barrages de l'Association canadienne des barrages et aux Recommandations de sécurité des barrages aux barrages miniers, ainsi qu'aux exigences du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario ou du ministère de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines de l'Ontario, selon le cas. |
L'Agence a examiné les accidents et les défaillances à la section 8.2 et est d'avis que le promoteur a tenu compte des risques d'accidents et de défaillances dans la conception du projet afin de réduire au minimum la probabilité de défaillance d'une digue de l'installation de gestion des résidus. L'Agence est d'avis que, bien que la rupture d'une digue de l'installation de gestion des résidus puisse avoir des effets néfastes importants sur l'habitat aquatique, il est peu probable qu'un tel événement se produise compte tenu des mesures de prévention que le promoteur s'est engagé à prendre. |
| Première Nation de Ginoogaming |
Crainte que l'augmentation de la circulation locale due au projet n'entraîne une augmentation du nombre d'accidents de la circulation, ce qui pourrait causer des blessures aux animaux qui traversent la route et aux conducteurs. |
Le promoteur a déclaré que la circulation le long des principales routes locales comme la route 11 est faible (moins de 2 000 véhicules par jour) et que toute augmentation de la circulation attribuable au projet serait conforme à la capacité de la route. |
L'Agence est satisfaite de la réponse du promoteur. |
| Nation métisse de l'Ontario |
Préoccupations soulevées au sujet des effets des déversements et de la contamination pour mieux comprendre les répercussions sur les droits et les intérêts des Autochtones. |
L'évaluation du promoteur comprenait un plan conceptuel de prévention et d'intervention en cas de déversement qui décrit les mesures à prendre pour éviter ceux-ci. De plus, selon le promoteur, tout déversement sera contenu dans la zone d'évaluation locale pour l'utilisation autochtone. |
L'Agence est satisfaite de la réponse du promoteur. L'Agence a examiné les accidents et les défaillances à la section 8.2 du présent rapport et a conclu que le projet n'est pas susceptible d'avoir des effets néfastes importants sur l'environnement découlant d'accidents ou de défaillances. |
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland, Première Nation de Ginoogaming |
Demande au promoteur d'adopter intégralement le protocole de sensibilisation et de préparation aux urgences à l'échelle locale du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) aux fins de l'élaboration de ses plans de préparation aux situations d'urgence et d'intervention d'urgence. |
Le promoteur a déclaré que les dispositions du protocole seront prises en considération dans la prochaine version du plan d'intervention d'urgence. Les collectivités autochtones auront l'occasion de formuler des observations sur le plan au fil de son élaboration. |
L'Agence prend note de la réponse du promoteur. L'Agence a examiné les accidents et les défaillances à la section 8.2 du présent rapport. |
| Processus de révision et consultation de l'évaluation environnementale | |||
| Première Nation d'Eabametoong, Nation métisse de l'Ontario |
Demande de renforcement des capacités et de consultations plus significatives, transparentes et continues. Demande d'évaluations individuelles des droits et intérêts des groupes autochtones. Les collectivités peuvent éclairer les discussions sur les effets en décrivant leurs problèmes et leurs préoccupations relativement au projet. On aimerait participer à la sélection des emplacements pour la surveillance. On aimerait valider les données de référence (c.-à-d. mettre à l'essai les zones où l'information de base a été recueillie). On mentionne que les mesures d'atténuation devraient être élaborées avec l'apport des groupes autochtones touchés. |
Le promoteur est convaincu que ses activités de mobilisation ont respecté les exigences énoncées. Le promoteur a également répondu aux questions soulevées par les collectivités au sujet du projet. Le promoteur a tenu compte, le cas échéant, des connaissances traditionnelles. Le promoteur a donné l'occasion aux collectivités de donner leur avis sur les programmes de référence, et aucune observation n'a été formulée au sujet des puits de surveillance. Le promoteur s'est engagé à consulter continuellement les collectivités au fil de la progression du projet. |
L'Agence a mené sa propre consultation pour éclairer son évaluation des répercussions possibles sur les groupes autochtones et a tenu compte de toutes les informations disponibles, y compris les études sur l'utilisation traditionnelle des terres et les connaissances traditionnelles qui étaient accessibles. L'Agence recommande d'inclure dans les conditions de la décision de la ministre que le promoteur consulte et mobilise les groupes autochtones tout au long de la durée du projet, d'une façon appropriée pour eux. |
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland, Première Nation de Ginoogaming |
Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, la Première Nation d'Aroland et la Première Nation de Ginoogaming aimeraient pouvoir participer à l'élaboration du plan de gestion adaptative, du plan de gestion de l'environnement, du plan de préparation et d'intervention et du plan de protection de l'environnement pour qu'on tienne compte des préoccupations des collectivités. |
Le promoteur s'est engagé à verser le financement nécessaire à la dotation de postes de contrôleurs environnementaux de chaque collectivité et à maintenir un comité consultatif de l'environnement dont ceux-ci seraient membres. Tout au long du projet, le comité examinera et recommandera des changements à apporter aux plans de gestion et de surveillance de l'environnement conformément au cadre de gestion adaptative qui est décrit. |
L'Agence recommande d'inclure dans les conditions de la décision de la ministre que le promoteur consulte et mobilise les groupes autochtones tout au long de la durée du projet, d'une façon appropriée pour eux. |
| Première Nation de Ginoogaming |
La Première Nation de Ginoogaming veut s'assurer qu'un contrôleur environnemental appartenant à celle-ci et faisant partie d'un programme de surveillance environnementale communautaire sera toujours employé et actif sur le site du projet afin de protéger les droits et intérêts de ses membres. La Première Nation de Ginoogaming a besoin de discussions en langage plus clair sur la façon dont on rajustera les activités sur le site du projet si les répercussions sont pires que prévu (c.-à-d. sur la façon dont les mesures correctives seront mises en œuvre). |
Le promoteur s'est engagé à verser le financement nécessaire à la dotation d'un poste de contrôleur environnemental et à maintenir un comité consultatif de l'environnement dont celui-ci serait membre. Le promoteur a présenté une approche pour expliquer comment ses plans de gestion et de surveillance seront examinés et ajustés au besoin en fonction des renseignements environnementaux recueillis pendant la construction et l'exploitation afin que, s'il y a lieu, les activités puissent être modifiées pour atténuer davantage les effets. |
L'Agence est satisfaite de la réponse du promoteur et recommande d'inclure dans les conditions de la décision de la ministre que le promoteur consulte et mobilise les collectivités tout au long de la durée du projet, d'une façon adéquate pour les groupes autochtones. |
| Première Nation de Ginoogaming |
Questions sur les rôles des gouvernements fédéral et provincial dans l'application des résultats de cette évaluation environnementale. On demande également qui sera responsable du site après le départ du promoteur lorsque le projet sera terminé. Crainte que les mesures d'assainissement prises après la réalisation du projet ne soient pas appliquées ou suivies. |
Le promoteur a indiqué qu'il est responsable de la fermeture de la mine et du respect des exigences du plan de fermeture. Un programme de surveillance sera exécuté pour vérifier que les objectifs et les critères de fermeture ont été atteints et pour confirmer que le projet peut passer à l'état de clôture définitive. Le promoteur a aussi indiqué qu'il est tenu de fournir une garantie financière au ministère de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines de l'Ontario avant le début des travaux de construction, afin de couvrir les coûts de fermeture de la mine. |
L'Agence fait remarquer que, si le projet allait de l'avant, elle serait responsable de l'application des conditions indiqués dans la décision de l'évaluation environnementale fédérale, tandis que le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario serait responsable de l'application des conditions d'approbation provinciales. De plus, l'Agence sait que, si le projet devait être mis en œuvre, un plan de fermeture serait requis en vertu de la Loi sur les mines de l'Ontario. Ce plan énoncerait des conditions de fermeture et de surveillance du site. L'Agence comprend que les exigences relatives aux fermetures de mines en vertu de la Loi sur les mines de l'Ontario prévoient la consultation des groupes autochtones susceptibles d'être touchés et tient compte de l'utilisation future des terres et des ressources. |
| Droits ancestraux ou issus de traités et consultations | |||
| Nation métisse de l'Ontario |
Crainte que les répercussions de la construction et de l'exploitation sur les droits et sur l'usage courant des terres et des ressources n'aient pas été évaluées adéquatement. Il faut aussi tenir compte des aspects économiques, et culturels des droits ancestraux et y être sensible pour se faire une idée précise des effets possibles. On demande que les intérêts et les droits particuliers des Métis soient pris en considération individuellement afin d'évaluer adéquatement les effets, que les droits des Métis soient pris en compte dans la détermination des emplacements de surveillance et des zones d'essai lors de la collecte des renseignements de référence. |
Le promoteur a déclaré que les effets sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis, ont été examinés dans l'évaluation des utilisations traditionnelles des terres et des ressources. Ces utilisations englobent les activités, les pratiques, les ressources, les zones et les sites traditionnels liés à la chasse, au piégeage, à la pêche, à la cueillette de plantes ou de matériaux, et les activités concrètes associées à l'utilisation traditionnelle (c.-à-d. les déplacements et la navigation, l'utilisation de l'habitation ainsi que les lieux culturels et spirituels). Cette approche reconnaît la correspondance entre les droits fondés sur la pratique et l'utilisation traditionnelle des terres et des ressources. L'étude d'impact environnemental tient pleinement compte des citoyens métis titulaires de droits. Le promoteur s'est engagé à consulter continuellement la Nation métisse de l'Ontario au fil de la progression du projet. |
Dans son évaluation, l'Agence a tenu compte de l'incidence tant sur les droits que sur l'utilisation des terres par les Autochtones. L'Agence a examiné séparément chaque groupe autochtone et ses droits. De plus, l'Agence a pris en considération l'information précise soumise par les groupes quant aux possibles répercussions du projet sur eux. Les conclusions de l'Agence, décrites aux sections 7.3, 7.4, 7.5 et 9 du présent rapport, sont qu'avec l'application des mesures d'atténuation et d'adaptation décrites par le promoteur ainsi que les recommandations de l'Agence pour la décision de la ministre, le projet n'aura probablement pas d'incidence importante sur les groupes autochtones. |
| Autres observations | |||
| Première Nation de Ginoogaming |
Déception occasionnée par la perte d'utilisation du club de golf de Kenogamisis ou de la baisse de la qualité de l'expérience là-bas, puisque le golf était une activité récréative en plein essor dans la Première Nation de Ginoogaming. |
Le promoteur a déclaré que l'accès aux neuf trous avant du terrain de golf et du pavillon ainsi que leur utilisation seront maintenus. Dans l'éventualité où l'installation de gestion des stériles A/C devient nécessaire pendant le projet, ce qui exigera le retrait des neuf trous avant, le promoteur discutera de ses exigences avec la municipalité de Greenstone. |
L'Agence prend note de la réponse du promoteur. |
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland, Première Nation de Ginoogaming |
On demande une analyse des problèmes sociaux et sanitaires actuels afin de comprendre la situation socioéconomique des collectivités, de même qu'une évaluation des répercussions du projet sur celle-ci. Demande de mesures d'atténuation pour toutes les répercussions cernées. |
Le promoteur a fait remarquer qu'il avait examiné les avantages et les répercussions socioéconomiques du projet. Pour certaines questions, comme la circulation et l'élimination des eaux usées, le promoteur a eu des discussions avec la municipalité locale. Pour d'autres questions, le promoteur est d'avis que la Couronne a un rôle à jouer, par exemple en ce qui concerne la prestation de services sociaux aux groupes autochtones. Dans l'ensemble, le promoteur estime que le projet aura des retombées socioéconomiques positives nettes en raison des emplois directs connexes, des possibilités accrues de formation et des occasions offertes aux entreprises avoisinantes. |
L'Agence prend note de la réponse du promoteur. Bien que la LCEE 2012 exige bel et bien un examen des répercussions socioéconomiques, les répercussions évaluées sont directement liées aux changements environnementaux et sont abordées à la section 7.4.2. |
| Première Nation de Ginoogaming |
La Première Nation de Ginoogaming aimerait que le promoteur offre de la formation et des emplois aux groupes autochtones locaux. |
Le promoteur a déclaré qu'un de ses engagements consiste à offrir de la formation et de l'aide à la recherche d'emploi aux travailleurs autochtones locaux. Le promoteur a également indiqué qu'il négocierait des ententes avec les groupes autochtones individuels sur de nombreux sujets, y compris la formation. Le promoteur informe actuellement les collectivités de toute offre d'emploi. |
L'Agence prend note de la réponse du promoteur. |
| Première Nation de Ginoogaming |
Crainte que l'accroissement de la population due au projet exerce une forte pression sur les services sociaux et les ressources traditionnelles et entraîne une augmentation des activités illégales. On demande que la situation soit surveillée de près, surtout par le gouvernement provincial. Demande de contrôle des prises de poissons et d'autres animaux sauvages par les non-Autochtones, si nécessaire. |
Le promoteur s'est dit résolu à cerner les éventuelles répercussions du projet sur les services et l'infrastructure et à agir en conséquence, ainsi qu'à aider les organisations responsables à planifier l'évolution de la demande découlant du projet, à s'y adapter ou à en tirer parti. Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario gérera la chasse et la pêche récréatives dans la région. |
L'Agence prend note de la réponse du promoteur, et note que le gouvernement de l'Ontario est aussi au courant. |
Annexe E – Sommaire des observations sur le rapport provisoire d'évaluation environnementale
Cette annexe présente un résumé des principales observations reçues concernant la version provisoire du présent rapport. Les observations de nature rédactionnelle ou relevant des erreurs factuelles ont été traitées dans le rapport et ne sont pas mentionnées dans le tableau.
| Source | Objet | Commentaire ou préoccupation | Réponse de l'Agence | Modifications apportées au rapport définitif d'évaluation environnementale | Modifications apportées aux conditions proposées |
|---|---|---|---|---|---|
| Greenstone Gold Mines | Qualité de l'air | Le promoteur a indiqué que le rapport provisoire ne justifie pas la surveillance du dioxyde d'azote. Il a remis en question la justification du respect de la Norme canadienne de qualité de l'air ambiant mise à jour pour le dioxyde d'azote lorsqu'elle a été annoncée après la présentation de l'étude d'impact environnemental. Il a fait remarquer que le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario n'a pas donné d'orientation quant à l'adoption de la Norme canadienne de qualité de l'air ambiant mise à jour pour le dioxyde d'azote. | Comme il est indiqué à la section 6.1.1 et à la section 7.4.1 du présent rapport, les activités du projet, comme le dynamitage et l'utilisation de véhicules diesel, libéreront du dioxyde d'azote et les concentrations augmenteront dans certaines parties de la zone d'évaluation locale. Étant donné qu'une utilisation par les Autochtones est prévue dans la zone d'évaluation locale, l'Agence est d'avis que des mesures clés d'atténuation et de suivi doivent être en place pour protéger la santé humaine. L'Agence est d'avis, de concert avec Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada, que la mise à jour de la Norme canadienne de qualité de l'air ambiant pour le dioxyde d'azote est un objectif approprié à atteindre, mais elle précise que la mesure proposée du programme de suivi consiste à vérifier que les concentrations de dioxyde d'azote prévues par le promoteur sont respectées. | Les sections 6.1.1 et 7.4.1 ont été mises à jour. | Aucune modification apportée. |
|
Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland et Première Nation de Ginoogaming Greenstone Gold Mines |
Qualité de l'air |
Les groupes autochtones ont demandé la modification de la mesure du programme de suivi et de la condition proposée pour la surveillance des particules totales en suspension afin d'y inclure l'analyse des métaux à l'état de traces. Le promoteur a demandé la modification de la mesure du programme de suivi et de la condition proposée pour la surveillance à des endroits dans les zones utilisées par les groupes autochtones à des fins traditionnelles ou dans des endroits qui seront représentatifs de la qualité de l'air dans les zones d'utilisation traditionnelle des terres, étant donné que l'implantation de systèmes de surveillance dans des zones forestières éloignées ou des lacs pourrait être impossible à réaliser et pourrait perturber l'environnement local. |
L'Agence est d'accord avec ces modifications. L'Agence est d'avis que la surveillance proposée dans la mesure du programme de suivi devrait indiquer si la qualité de l'air aux endroits où on s'attend à ce que l'utilisation par les Autochtones continue répond aux prévisions faites dans l'évaluation environnementale. |
L'encadré 7.4-2 a été mis à jour. |
La condition 5.2.1 (maintenant 5.3.1 et 5.3.2) a été mise à jour. |
|
Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland et Première Nation de Ginoogaming Greenstone Gold Mines |
Qualité de l'air |
Les groupes autochtones ont demandé la modification de la mesure du programme de suivi et de la condition proposée pour la surveillance du benzène et du benzo[a]pyrène en suspension dans l'air pendant les cinq premières années d'exploitation (au lieu des deux premières années). Le promoteur a demandé la suppression de la mesure du programme de suivi et de la condition proposée pour la surveillance du benzène et du benzo[a]pyrène en suspension dans l'air, car la contribution du projet pour ces contaminants à des endroits où on s'attend à une utilisation par les Autochtones ne devrait représenter qu'une petite partie des critères provinciaux de qualité de l'air. |
L'Agence est d'avis qu'une mesure du programme de suivi visant à surveiller le benzène et le benzo[a]pyrène en suspension dans l'air est nécessaire pour vérifier la prévision de l'évaluation environnementale selon laquelle les niveaux globaux élevés (arrière-plan plus contribution au projet) de benzène et de benzène/benzo[a]pyrène sont attribuables à une estimation très prudente des conditions de référence. L'Agence est également d'avis que la surveillance pendant la construction et les deux premières années d'exploitation serait appropriée pour établir la validité de l'hypothèse pour les conditions de référence et la contribution initiale du projet aux niveaux globaux de benzène et de benzo[a]pyrène. La condition proposée exige également que le promoteur consulte les groupes autochtones et les autorités compétentes après les deux premières années d'exploitation pour déterminer si une surveillance supplémentaire est nécessaire. |
Aucune modification apportée. |
Aucune modification apportée. |
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland, Première Nation de Ginoogaming et Nation métisse de l'Ontario, et public | Anciens résidus | Les intervenants ont soulevé des préoccupations au sujet du stockage des anciens résidus et de la lixiviation éventuelle des anciens résidus dans les plans d'eau environnants. | L'Agence fait remarquer qu'elle a établi des mesures d'atténuation clés et des conditions proposées qui obligeraient le promoteur à intercepter et à recueillir l'eau de contact de tout endroit où les anciens résidus excavés sont entreposés temporairement, et aussi à intercepter et à recueillir l'eau de contact de l'installation de gestion des résidus où les anciens résidus excavés seraient entreposés comme emplacement final. Le promoteur serait également tenu de gérer les anciens résidus non excavés afin de protéger la qualité de l'eau dans les plans d'eau environnants et de réhabiliter les parties exposées des anciens résidus non excavés dès que l'excavation est techniquement faisable. | Aucune modification apportée. | Aucune modification apportée. |
| Environnement et Changement climatique Canada | Qualité de l'eau | Le Ministère a indiqué que le promoteur devrait poursuivre les études géochimiques en cours pour valider les prévisions de l'évaluation environnementale et mettre en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires au besoin. | L'Agence est d'avis que les mesures proposées du programme de suivi pour la surveillance des écoulements et de la qualité des eaux souterraines, et les mesures proposées du programme de suivi pour la surveillance de la qualité des eaux de surface, ainsi que l'engagement du promoteur à poursuivre les études géochimiques des résidus pendant le projet, permettraient la validation des prévisions de l'évaluation environnementale, et des mesures d'atténuation supplémentaires pourraient être créées au besoin. | Les points de vue exprimés à la section 6.3.1 ont été ajoutés. | Aucune modification apportée. |
| Environnement et Changement climatique Canada | Qualité de l'eau | Le Ministère a soulevé des préoccupations au sujet des fossés de collecte de l'eau de contact, qui devraient être maintenus après l'exploitation, si l'effluent dans la zone d'étude du projet n'a pas encore atteint un critère de rejet acceptable. | L'Agence a modifié les principales mesures d'atténuation et les conditions proposées relatives aux poissons et à leur habitat afin d'exiger que le promoteur maintienne les fossés de collecte de l'eau de contact après l'exploitation et, au besoin, qu'il se conforme au Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants et aux dispositions de prévention de la pollution de la Loi sur les pêches. | L'encadré 7.1-1 a été mis à jour. | La nouvelle condition 3.8 a été ajoutée. |
| Environnement et Changement climatique Canada | Qualité de l'eau | Le Ministère a soulevé des préoccupations au sujet des sols à proximité immédiate du site historique de l'usine de Hardrock et de l'ancien site de l'usine de MacLeod-Mosher, qui dépassent généralement les critères provinciaux pour l'arsenic, et le Ministère a noté l'engagement du promoteur de séparer et de surveiller toute la terre végétale présentant des concentrations élevées de métaux (arsenic et antimoine). | L'Agence a mis à jour les principales mesures d'atténuation et les conditions proposées pour exiger la gestion des sols contaminés à proximité des sites historiques des usines de Hardrock et de MacLeod-Mosher de manière à protéger la qualité de l'eau dans les plans d'eau environnants. | L'encadré 7.1-1 a été mis à jour. | La condition 3.5.1 (maintenant 3.11.2) a été mise à jour. |
| Greenstone Gold Mines | Qualité de l'eau | Le promoteur a précisé qu'avec le plan de dérivation, l'eau détournée dans l'affluent du bras sud-ouest sera de meilleure qualité par rapport aux conditions de référence, et qu'il s'attend à une certaine amélioration de la qualité de l'eau. | L'Agence reconnaît ce point et a modifié le texte de la section 6.3.2 pour tenir compte de l'évaluation du promoteur. | La section 6.3.2 a été mise à jour | Aucune modification apportée. |
| Greenstone Gold Mines | Qualité de l'eau | Le promoteur a indiqué que les principales mesures d'atténuation et les conditions proposées devraient permettre de diriger l'excédent d'eau de l'installation de gestion des résidus vers l'usine de traitement de l'eau, puis vers le lieu de rejet des effluents, comme mesure d'urgence pendant une année humide ou un événement météorologique. | L'Agence a modifié les principales mesures d'atténuation et les conditions proposées afin que tout excès d'eau puisse être traité et rejeté dans le lieu de rejet de l'effluent. L'Agence est d'avis que, pour se conformer à la nouvelle condition 3.4, qui exige la conformité au Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants et aux dispositions sur la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches, le promoteur devra traiter l'excès d'eau avant de l'évacuer. | L'encadré 7.1-1 a été mis à jour. | La condition 3.4 a été mise à jour. |
| Première Nation no 58 de Longlac | Habitat des poissons | La Première Nation no 58 de Longlac a indiqué que comme mesure d'urgence au plan de compensation actuel de l'habitat des poissons, elle aimerait que l'on considère le lac Long comme un endroit où l'habitat de compensation serait souhaitable. | L'Agence a transmis ce point à Pêches et Océans Canada pour qu'il l'examine dans le cadre de la consultation sur l'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches. | Aucune modification apportée. | Aucune modification apportée. |
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland et Première Nation de Ginoogaming | Poissons | Les groupes autochtones ont demandé la modification de la principale mesure d'atténuation et de la condition proposée afin d'exiger la participation directe des groupes autochtones à la récupération et à la réinstallation des poissons avant d'entreprendre toute activité exigeant l'élimination de leur habitat. | L'Agence accepte cette modification. | L'encadré 7.1-1 a été mis à jour. | La condition 3.1 (maintenant 3.1.1) a été mise à jour. |
| Environnement et Changement climatique Canada | Oiseaux migrateurs | Préoccupations soulevées au sujet du risque accru de collisions entre des oiseaux migrateurs et des véhicules en raison du projet. | L'Agence a considéré le risque accru de collisions entre les oiseaux migrateurs et les véhicules comme un effet résiduel du projet et a proposé une mesure d'atténuation clé visant à imposer une limite de vitesse sur les routes du site, ainsi qu'un programme de suivi pour surveiller les collisions dans la zone d'étude du projet et mettre en œuvre des mesures correctives en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, si des collisions avec des oiseaux migrateurs sont enregistrées dans cette zone. | La nouvelle section 7.2.2 a été ajoutée, les encadrés 7.2-1 et 7.2-2 et l'annexe B ont été mis à jour. | La condition 6.8 a été renumérotée pour devenir la condition 4.5, et la nouvelle condition 4.7.4 a été ajoutée. |
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland et Première Nation de Ginoogaming Greenstone Gold Mines | Oiseaux migrateurs | Les groupes autochtones ont demandé la modification de la mesure du programme de suivi et de la condition proposée, pour effectuer des relevés annuels des oiseaux migrateurs pendant les cinq premières années (plutôt que pendant les trois premières années) suivant la fin des travaux de construction. Le promoteur a demandé la modification de la mesure du programme de suivi et des conditions proposées pour évaluer les changements de l'utilisation de la zone d'étude du projet par les oiseaux migrateurs (au lieu de l'évaluation des populations d'oiseaux migrateurs). | L'Agence est d'accord avec les modifications proposées. | L'encadré 7.2-2 a été mis à jour. | La condition 4.5.1 (maintenant 4.6.1) a été mise à jour. |
| Greenstone Gold Mines | Oiseaux migrateurs | Le promoteur a demandé une modification de la mesure du programme de suivi et de la condition proposée afin de n'exiger des moyens de dissuasion de l'utilisation des eaux libres par les oiseaux migrateurs que si la qualité de l'eau des eaux libres ne répond pas aux critères de qualité de l'eau applicables. | L'Agence est d'accord avec la modification proposée. | L'encadré 7.2-2 a été mis à jour. | La condition 4.4.3 (maintenant 4.6.1) a été mise à jour. |
| Greenstone Gold Mines | Oiseaux migrateurs | Le promoteur a demandé une modification de la mesure du programme de suivi et de la condition proposée, de sorte que la surveillance de l'efficacité de la remise en état progressive soit assujettie à une gestion adaptative plutôt qu'à une surveillance tous les cinq ans, ce qui semblait être trop vague. | L'Agence est satisfaite de la fréquence proposée de la surveillance, et cette surveillance devrait se poursuivre jusqu'à ce que les objectifs de réhabilitation soient confirmés. L'Agence a apporté des changements rédactionnels à la condition proposée. | Aucune modification apportée. | La condition 4.5.2 (maintenant 4.7.2) a été mise à jour. |
| Nation métisse de l'Ontario | Habitat des espèces sauvages | La Nation a soulevé des préoccupations au sujet des activités du projet qui peuvent causer la dégradation et la fragmentation de l'habitat, ainsi que des modifications indirectes éventuelles de la qualité et de la fonction de l'habitat. On craint que le déplacement perturbé de la faune ne prenne des décennies avant d'être rétabli dans la région. | L'Agence est d'avis que les principales mesures d'atténuation proposées qui exigent la restauration de la zone d'étude du projet dans des conditions aussi proches que possible des conditions qui existaient avant le projet, l'intégration des espèces végétales d'intérêt pour les groupes autochtones de manière à créer de futures activités de récolte et les principales mesures d'atténuation proposées concernant les poissons et leur habitat et la qualité de l'air minimiseront les perturbations de l'habitat des espèces sauvages pendant et après le projet. | Les points de vue exprimés ont été ajoutés à la section 6.4.2. | Aucune modification apportée. |
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland et Première Nation de Ginoogaming | Revégétalisation progressive | Les groupes autochtones ont demandé une modification de la principale mesure d'atténuation et de la condition proposée pour préciser que la revégétalisation dans le cadre de la remise en état progressive inclurait les espèces végétales indigènes de la région ou ayant une importance traditionnelle pour les groupes autochtones (p. ex. plantes médicinales, comestibles, rituelles) et convenant à la création d'un habitat pour les oiseaux migrateurs et aux activités de récolte futures. | L'Agence est d'accord avec la modification proposée. | L'encadré 7.3-1 a été mis à jour. | La condition 4.2 a été mise à jour. |
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland et Première Nation de Ginoogaming | Usage courant | Les groupes autochtones ont demandé une modification de la principale mesure d'atténuation et de la condition proposée pour donner accès à la zone d'étude du projet aux groupes autochtones avant la construction, dans la mesure où cet accès est sécuritaire, afin de chasser, pêcher et récolter les plantes traditionnelles. | L'Agence est d'avis que cette condition visait à permettre la récolte de plantes traditionnelles avant qu'elles ne soient perdues en raison du défrichage. Les groupes autochtones ont déjà le droit de chasser et de pêcher dans la zone d'étude du projet, et les poissons et autres animaux sauvages ne seraient pas perdus une fois la construction commencée, bien qu'ils puissent être déplacés. | Aucune modification apportée. | Aucune modification apportée. |
| Première Nation no 58 de Longlac | Usage courant | La Première Nation a demandé une modification à la condition proposée pour obliger le promoteur à donner un préavis d'au moins 120 jours avant le défrichage, au lieu de 90 jours, de sorte que l'avis permet l'accès pendant la saison de croissance active des plantes traditionnelles à récolter. | L'Agence est d'accord avec la modification proposée. | Aucune modification apportée. | La condition 6.7 a été mise à jour. |
| Nation métisse de l'Ontario | Usage courant – santé | La Nation a soulevé des préoccupations au sujet de l'évaluation environnementale, car celle-ci ne tient pas compte spécifiquement des effets sur les zones ou les sites qui peuvent avoir une importance historique et traditionnelle pour l'exercice des droits et du mode de vie des Métis, ou sur les habitudes alimentaires et les niveaux de consommation distincts des citoyens de la Nation métisse de l'Ontario. La Nation métisse de l'Ontario craint que ses citoyens ne soient plus en mesure d'accéder à leurs emplacements préférés et que leurs activités de récolte soient limitées ou modifiées. | L'Agence est d'avis que l'évaluation environnementale a tenu compte des effets propres à chaque groupe autochtone dans l'évaluation de l'utilisation par les Autochtones décrite à la section 7.3, et que l'évaluation de la santé humaine décrite à la section 7.4.1 était suffisamment prudente pour englober les habitudes alimentaires de tous les groupes autochtones. | Précision apportée à la section 7.3.2. | Aucune modification apportée. |
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland et Première Nation de Ginoogaming Greenstone Gold Mines | Usage courant – dynamitage | Les groupes autochtones ont demandé la modification de la principale mesure d'atténuation et de la condition proposée afin d'empêcher le dynamitage lors des journées culturelles importantes déterminées lors de consultations avec les groupes autochtones. Le promoteur a demandé la modification de la principale mesure d'atténuation et de la condition proposée pour permettre le dynamitage après 16 h, ou les jours fériés, dans des circonstances particulières, et s'est engagé à fournir des avis spéciaux aux groupes autochtones; il a également demandé des modifications à la principale mesure d'atténuation et à la condition proposée, étant donné qu'il pourrait être impossible de donner un préavis de 48 heures avant le dynamitage. | L'Agence a modifié une mesure du programme de suivi et une condition proposée pour que le promoteur élabore, dans le cadre de son plan de communication et de mobilisation, des procédures pour communiquer les dates et les heures de dynamitage habituelles, ainsi que des procédures pour informer les groupes autochtones de tout changement à court préavis du calendrier de dynamitage lorsque le dynamitage serait requis avant 10 h, après 16 h, ou les jours fériés ou d'importance culturelle. L'Agence comprend que le moment précis du dynamitage peut être sujet à changement à court préavis, en raison des conditions météorologiques changeantes ou d'autres circonstances inévitables, mais cette mesure fournirait aux groupes autochtones des renseignements supplémentaires pour planifier les activités traditionnelles à proximité de la zone d'étude du projet. | La section 7.3.3 et l'encadré 7.3-1 ont été mis à jour. | La condition 6.3.2 (maintenant 6.3 et 6.4.2) a été mise à jour. |
| Nation métisse de l'Ontario | Santé | La Nation métisse de l'Ontario craint que le promoteur ne surveille que certaines parties des tissus du poisson, et non le poisson entier ou certains organes qui sont consommés par ses citoyens. | L'Agence fait remarquer que le promoteur s'était engagé à surveiller le poisson entier dans le cadre du projet. Cet engagement a été précisé à la section 7.4.1 du rapport. L'Agence a proposé des conditions qui obligeraient le promoteur à consulter les groupes autochtones et les autorités compétentes au sujet de la méthode d'échantillonnage des aliments prélevés dans la nature. | Précision apportée à la section 7.4.1 | Aucune modification apportée. |
|
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario Greenstone Gold Mines |
Santé |
La province a indiqué qu'elle ne dirigerait pas une étude sur la santé de l'orignal, mais qu'elle collaborerait avec le promoteur et les groupes autochtones. Le promoteur a indiqué que la gestion d'une étude sur la santé de l'orignal est le rôle du gouvernement. |
L'Agence est satisfaite de la conclusion du promoteur selon laquelle les charges de contaminants dans l'orignal sont peu probables en raison du projet, et fait remarquer en outre qu'en raison des tendances migratoires de l'orignal, il serait difficile d'attribuer directement au projet les changements dans les niveaux de contaminants chez l'orignal. L'Agence reconnaît l'engagement du promoteur à participer à une étude sur la santé de l'orignal. |
La section 7.4.1 et l'encadré 7.4-2 ont été mis à jour. |
La condition 5.4 (maintenant 5.6) a été mise à jour. |
| Greenstone Gold Mines | Qualité de l'eau et santé | Le promoteur a indiqué que la durée de la mesure du programme de suivi et de la condition proposée liée à la surveillance du mercure et du méthylmercure devrait être raccourcie et faire l'objet d'une gestion adaptative, et que la fréquence et la durée devraient être réduites si aucun problème n'est décelé. | L'Agence a modifié la mesure du programme de suivi et la condition proposée pour exiger la surveillance du mercure et du méthylmercure dans l'affluent du bras sud-ouest pour la construction et les cinq premières années d'exploitation, après quoi le promoteur déterminera, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et en fonction des résultats de la surveillance, si une surveillance supplémentaire est nécessaire. | L'encadré 7.4-2 a été mis à jour. | Les conditions 5.3.1 et 5.3.2 (maintenant 5.4.1 et 5.4.2) ont été mises à jour. |
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland et Première Nation de Ginoogaming | Santé | Les groupes autochtones ont demandé une modification de la mesure du programme de suivi et de la condition proposée pour exiger la surveillance des aliments prélevés dans la nature au moins une fois par année et pour inclure la queue à tache noire et la sauvagine comme aliments prélevés dans la nature à surveiller. | L'Agence a modifié la mesure du programme de suivi et la condition proposée pour exiger une surveillance semestrielle pour les six premières années d'exploitation, après quoi le promoteur déterminera, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et en fonction des résultats de la surveillance, si une surveillance supplémentaire est nécessaire. L'Agence est d'avis que les groupes peuvent proposer au promoteur, dans le cadre de leur consultation sur la surveillance des aliments prélevés dans la nature, des espèces indicatrices comme la queue à tache noire, en plus du doré jaune, pour les analyses de contamination des poissons. L'Agence est également d'avis qu'il serait difficile d'attribuer les changements aux tissus de la sauvagine au projet et que les conditions proposées limiteraient l'exposition de la sauvagine aux eaux libres dans la zone d'étude du projet. | L'encadré 7.4-2 a été mis à jour. | Les conditions 5.4.1 et 5.4.2 (maintenant 5.5.1 et 5.5.2) ont été mises à jour. |
| Première Nation no 58 de Longlac | Patrimoine naturel et culturel | Le groupe autochtone a indiqué que le promoteur devrait envisager d'autres travaux archéologiques lorsque des sites d'intérêt archéologique ont été étudiés, validés et discutés avec des intérêts autochtones. | L'Agence prend acte du commentaire et est d'avis qu'une surveillance suffisante serait assurée par la Loi sur le patrimoine de l'Ontario. | Aucune modification apportée. | Aucune modification apportée. |
| Ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario | Habitat du pygargue à tête blanche | Le Ministère a indiqué que la principale mesure d'atténuation de l'encadré 7.5-1 visant à imposer des restrictions sur la préparation du site à moins de 200 mètres des nids de pygargues à tête blanche actifs pendant la période de reproduction critique devrait être portée à 400 mètres afin de respecter les normes de l'Ontario. | L'Agence a modifié la principale mesure d'atténuation et la condition proposée pour l'harmoniser avec les normes de l'Ontario. | L'encadré 7.5-1 a été mis à jour. | La condition 7.1.2 a été mise à jour. |
| Nation métisse de l'Ontario | Habitat de nidification du pygargue à tête blanche | La Nation métisse de l'Ontario a indiqué qu'il faudrait solliciter d'autres observations auprès d'elle au sujet de sa participation aux relevés de l'habitat de nidification et de la surveillance du pygargue à tête blanche, et de l'élaboration du plan de protection décrit à l'encadré 7.5-1. | L'Agence a proposé des conditions qui obligent le promoteur à élaborer, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un plan de protection du pygargue à tête blanche qui comprend la réalisation de relevés des nids actifs du pygargue à tête blanche dans la zone d'étude du projet et à moins de 800 mètres de la zone d'étude du projet. | Clarification faite à la vue exprimée à la section 7.5.1. | Aucune modification apportée. |
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland et Première Nation de Ginoogaming | Habitat de nidification du pygargue à tête blanche | Les groupes autochtones ont demandé une modification de la principale mesure d'atténuation et de la condition proposée afin que, si le promoteur constate que des pygargues à tête blanche ont disparu de la zone d'évaluation locale, le promoteur, en consultation avec les groupes autochtones, conçoive un programme de rétablissement et de réintroduction des populations de pygargues à tête blanche dans la zone d'évaluation locale aux conditions de référence. | L'Agence prend acte du commentaire et note que le promoteur examinerait les possibilités d'encourager les rapaces à se rendre dans la zone d'étude du projet après l'exploitation, en utilisant des caractéristiques qui seraient construites à partir des composantes du projet. | Vue exprimée ajoutée à la section 7.5.1. | Aucune modification apportée. |
| Environnement et Changement climatique Canada | Espèces en péril | Le Ministère a indiqué que la fermeture de toutes les ouvertures des anciens puits de mine de Hardrock et MacLeod-Mosher avant les travaux de rabattement serait une mesure préventive importante pour réduire les effets négatifs sur la petite chauve-souris brune et la chauve-souris nordique. | L'Agence a proposé une nouvelle condition exigeant la fermeture des puits de mine avant le rabattement, comme mesure préventive pour réduire les effets négatifs sur la petite chauve-souris brune et la chauve-souris nordique. | Renseignements ajoutés à la section 8.1. | La nouvelle condition 8.1 a été ajoutée. |
| Nation métisse de l'Ontario | Effets cumulatifs | La Nation métisse de l'Ontario a indiqué que les répercussions des activités minières historiques et la possibilité d'interaction avec d'autres projets miniers peuvent contribuer aux effets cumulatifs d'une nature additive sur les droits des générations futures d'utiliser continuellement la zone. | L'Agence prend acte de l'observation et estime, comme l'indique la section 8.4.2, que la qualité des ressources utilisées par les Autochtones est abondante dans la zone d'évaluation régionale. | Aucune modification apportée. | Aucune modification apportée. |
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland et Première Nation de Ginoogaming | Surveillance | Les groupes autochtones croient qu'une condition liée à l'établissement d'un Comité consultatif de l'environnement doit être incluse dans la recommandation de l'Agence au ministre, afin que les promesses faites à ces groupes soient respectées par le promoteur et la Couronne. Le Comité consultatif de l'environnement servirait de mécanisme principal pour les examens, les activités, les observations, la gestion adaptative et la prise de décision concernant l'ensemble du cycle de vie du projet, et de mécanisme important pour aborder les questions et préoccupations en suspens. On préparerait un mandat qui donnerait à ces groupes suffisamment de pouvoirs pour influencer et prendre des décisions qui répondent à leurs questions et préoccupations par un suivi et une gestion adaptative. Le Comité consultatif de l'environnement permettrait à ces groupes de jouer un rôle actif dans le contrôle et la surveillance du projet et servirait de point central pour les efforts visant à demeurer engagés avec le gouvernement fédéral pendant les phases de délivrance de permis et de suivi fédéral du projet. Un Comité consultatif de l'environnement qui fonctionne bien est un aspect essentiel du consentement de ces groupes au projet, car il s'agit du mécanisme le plus important dont ils disposent pour vérifier les prévisions faites dans le cadre du processus d'évaluation environnementale fédérale. | L'Agence note que le promoteur s'est engagé à financer un contrôleur environnemental représentant chaque groupe autochtone et à maintenir un Comité consultatif de l'environnement pour ces trois groupes autochtones, dont ces contrôleurs seraient membres. L'Agence est satisfaite que la condition 2.8 exige que le promoteur, lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'un programme de suivi, discute avec chaque groupe autochtone des possibilités de participer à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris l'analyse des résultats du suivi et la question de savoir si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires. L'Agence note que la condition 6.9 exige que le promoteur doive, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, élaborer un programme de suivi pour vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui a trait aux effets environnementaux négatifs du projet sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles. L'Agence vérifiera si les mesures d'atténuation et les exigences de suivi nécessaires ont été mises en œuvre et pourra consulter les groupes autochtones au moment d'entreprendre la vérification de la conformité. | Aucune modification apportée. | Aucune modification apportée. |
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland et Première Nation de Ginoogaming | Surveillance | Les groupes autochtones ont demandé une nouvelle condition selon laquelle, si le projet n'est pas mis en chantier dans les cinq ans suivant l'approbation du ministre, le promoteur devra recommencer à rassembler l'information de base recueillie dans l'étude d'impact environnemental. | L'Agence est d'avis que cette condition est inutile, car rien n'indique que le promoteur a l'intention d'attendre cinq ans avant de commencer les activités de construction. | Aucune modification apportée. | Aucune modification apportée. |
| Ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario | Parc provincial MacLeod | Le Ministère craint que l'évaluation environnementale fédérale n'ait pas tenu compte des effets du projet sur les utilisateurs du parc provincial MacLeod. | L'Agence estime que les effets sur le parc provincial MacLeod seraient réduits ou éliminés grâce aux principales mesures d'atténuation et à celles du programme de suivi qui sont indiquées dans le rapport. | Aucune modification apportée. | Aucune modification apportée. |
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland et Première Nation de Ginoogaming | Effets socioéconomiques (hors de la portée de la LCEE 2012) | Les groupes autochtones ont demandé une nouvelle condition selon laquelle le promoteur devrait surveiller les effets socioéconomiques du projet, y compris les effets associés à l'arrivée de travailleurs dans la région pendant les phases de construction, d'exploitation et de désaffectation du projet. Cela devrait comprendre la surveillance des taux de comportement criminel sur le site ou à l'extérieur du site, comme le harcèlement, la violence, les agressions sexuelles et les crimes haineux (p. ex. le racisme). Le promoteur devrait collaborer avec les autorités compétentes pour surveiller les tendances en matière de comportement criminel. | L'Agence est d'avis que ces effets seraient hors de la portée de l'évaluation environnementale en vertu de la LCEE 2012. | Aucune modification apportée. | Aucune modification apportée. |